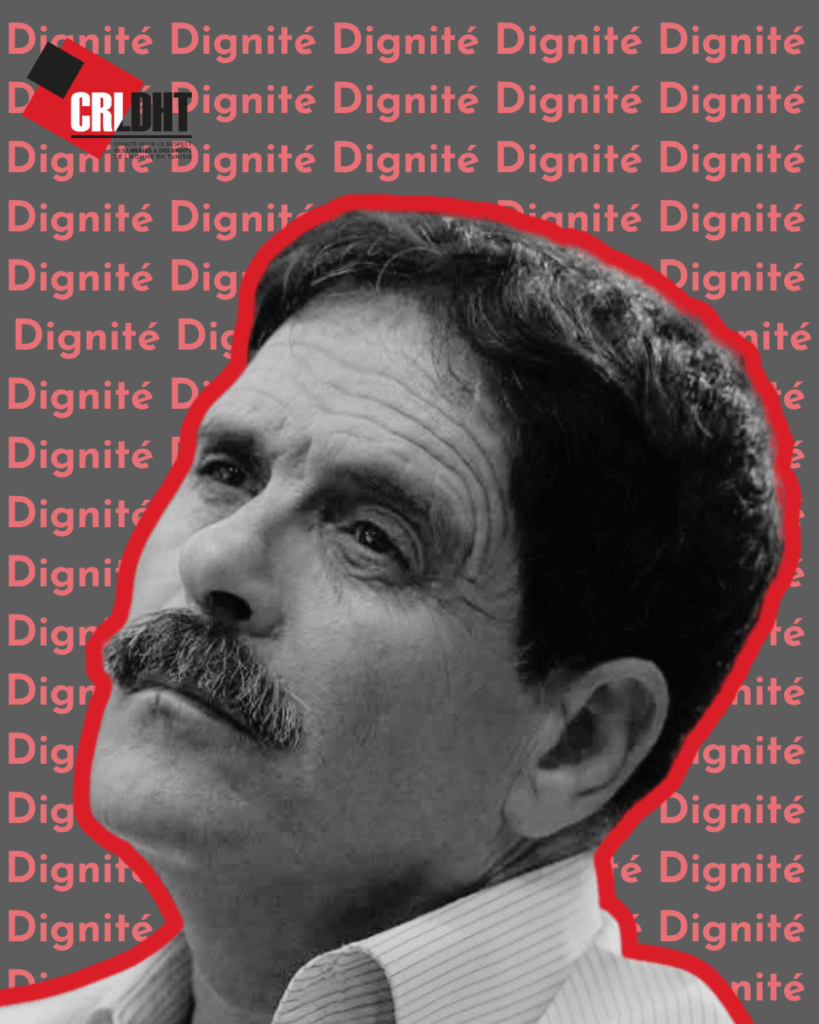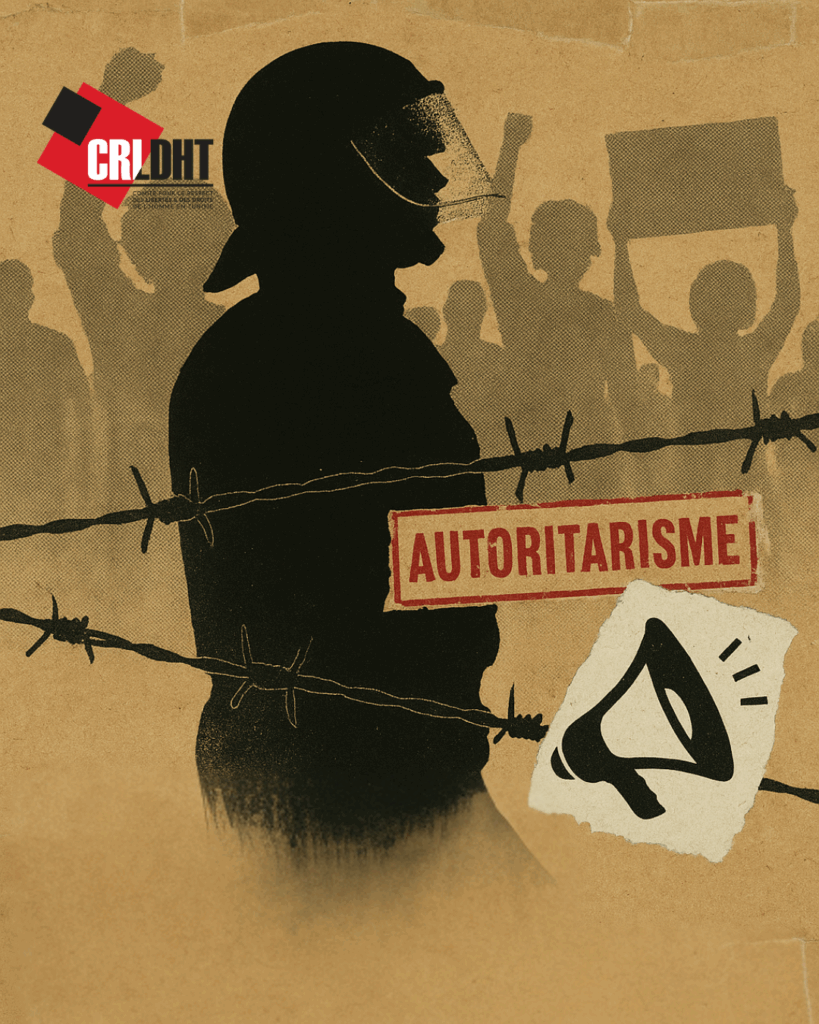Le 6 avril 2025, Adel Dridi, homme d’affaires controversé au cœur d’un vaste scandale financier, est retrouvé mort dans sa cellule à la prison de Mornaguia. Son corps découvert par ses codétenus au petit matin, a été transféré sur ordre du Parquet vers l’Institut médico-légal afin d’élucider les causes du décès. Dridi purgeait une peine de dix ans pour escroquerie après avoir été initialement condamné à 32 ans dans l’affaire retentissante de la chaîne de Ponzi « Yosr Développement », qui avait ébranlé la Tunisie post-révolutionnaire. Officiellement, il était en détention depuis 2013. Mais au-delà du cas de Dridi, sa mort soulève une fois encore des interrogations majeures sur la réalité des conditions de détention en Tunisie.
Une prison pour mourir ?
La disparition de A.Dridi n’est pas un cas isolé. Elle survient quelques semaines à peine après celle de l’homme d’affaires Fadhel Ghedamsi, décédé dans des circonstances opaques, après une longue grève de la faim en protestation contre sa détention préventive prolongée. La répétition de ces décès au sein des établissements pénitentiaires interroge : les prisons tunisiennes sont-elles devenues des mouroirs où l’on abandonne à leur sort des individus – qu’ils soient condamnés ou non – sans soins, sans dignité, sans justice ?
Pourquoi cet homme, incarcéré depuis plus de dix ans, meurt-il ainsi, sans que ni les autorités pénitentiaires, ni le système judiciaire n’aient anticipé ou prévenu sa dégradation physique et mentale ? Le simple fait que sa mort ait été découverte par des codétenus témoigne d’un abandon quasi total.
Des conditions carcérales alarmantes
La Tunisie est régulièrement pointée du doigt par les instances internationales pour ses conditions de détention. Surpopulation, insalubrité, manque d’accès aux soins, violences entre détenus, pressions psychologiques voire tortures… En 2024, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Plus récemment, plusieurs ONG ont dénoncé l’absence de mécanismes de contrôle indépendants, la faiblesse de la médecine carcérale et l’instrumentalisation politique des détentions.
La détention préventive prolongée, souvent utilisée comme arme d’intimidation contre des opposants, s’accompagne aussi d’un déni de leurs droits fondamentaux : accès aux soins, à un procès équitable, à une dignité minimale. Les grèves de la faim – comme celle en cours de Sonia Dahmani – sont devenues un mode d’expression ultime des détenus pour dénoncer leur sort.
Adel Dridi : escroc ou bouc émissaire ?
Adel Dridi ne laisse pas une image limpide. Pour certains, il reste le “Madoff tunisien”, responsable de l’une des plus grandes arnaques financières du pays, avec plus de 60 000 victimes. Pour d’autres, c’est aussi un homme qui dérangeait le système bancaire et politique, notamment en raison de ses liens présumés avec des figures islamistes, son opposition au pouvoir économique dominant et sa capacité à drainer des millions en dehors des circuits traditionnels. Certaines associations ont dénoncé , à l’époque, un acharnement judiciaire.
Quelle que soit l’opinion qu’on ait du personnage, sa mort en prison sans transparence, sans communication officielle, sans enquête indépendante, est indigne d’un État de droit. Ce décès appelle à une vigilance particulière, tout comme celui de F.Ghedamsi : la prison ne doit pas devenir un espace de vengeance politique, sociale ou judiciaire.
Rompre le silence , faire la lumière
La répétition de décès suspects en détention, qu’ils touchent des figures controversées ou des opposants politiques, impose une réponse institutionnelle claire. Il est urgent de :
- Réaliser une autopsie publique et indépendante du corps de Adel Dridi, avec accès pour ses proches, ses avocats et les organisations de défense des droits humains ;
- Publier les rapports médicaux et judiciaires sur les circonstances exactes de sa mort ;
- Mettre en place un mécanisme indépendant d’enquête sur les conditions de détention et de traitement des détenus dans les prisons tunisiennes – ou à défaut, saisir et renforcer le rôle du Mécanisme national de prévention de la torture (INPT), mis en place en 2016 mais souvent empêché de remplir pleinement sa mission par des obstacles administratifs, un manque de coopération des autorités carcérales, voire des restrictions d’accès aux lieux de détention ;
- Renforcer le contrôle parlementaire et judiciaire sur l’administration pénitentiaire, en facilitant l’accès aux établissements pour les ONG, les familles et les journalistes ;
- Faire cesser les détentions arbitraires et les pratiques de déshumanisation en prison, notamment envers les prisonniers d’opinion ou les figures jetées en pâture dans les médias.
L’État tunisien ne peut continuer à répondre à ces décès par le silence ou des communiqués laconiques. Cette inertie institutionnelle consacre l’effondrement moral de l’État, la faillite de son appareil judiciaire et le reniement absolu du principe de la dignité humaine.