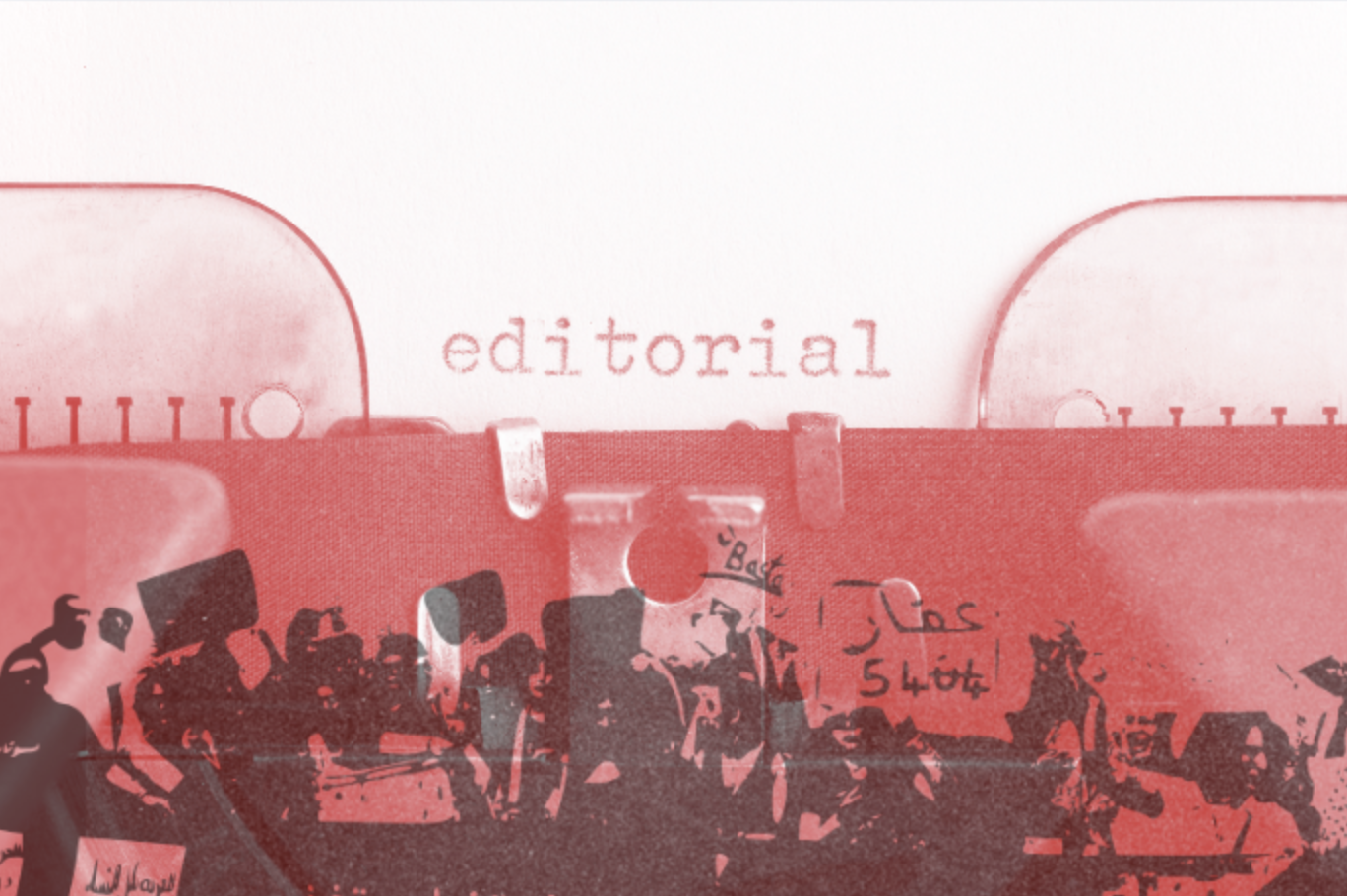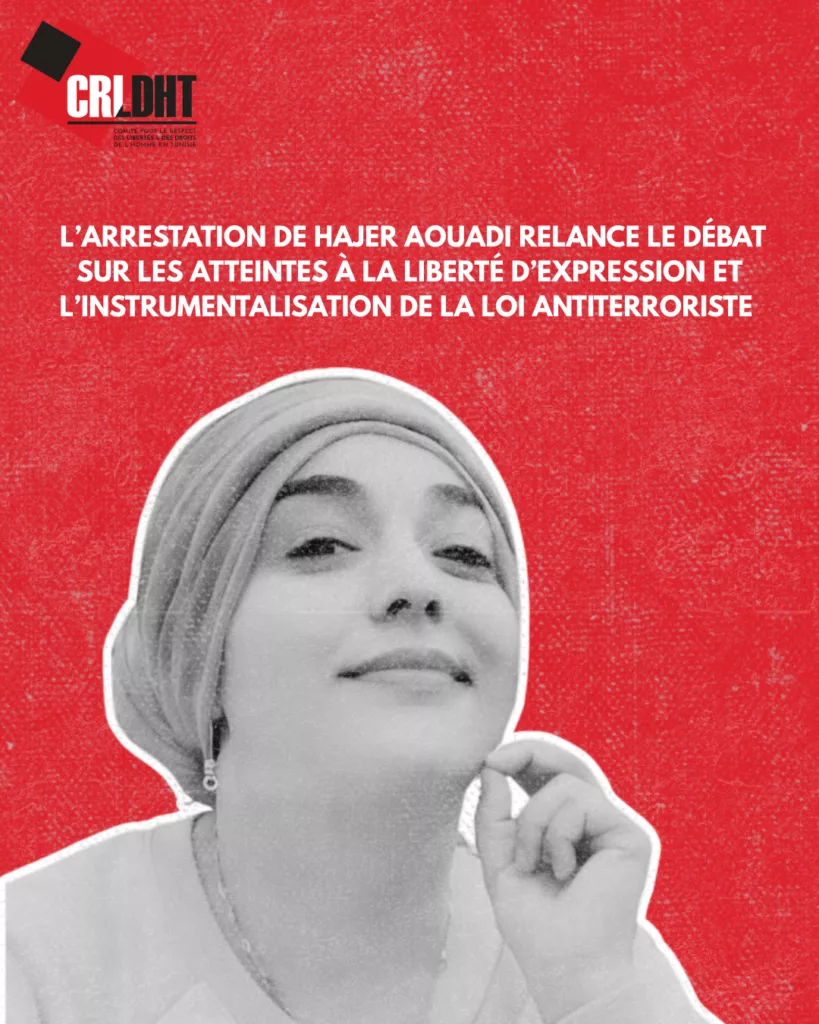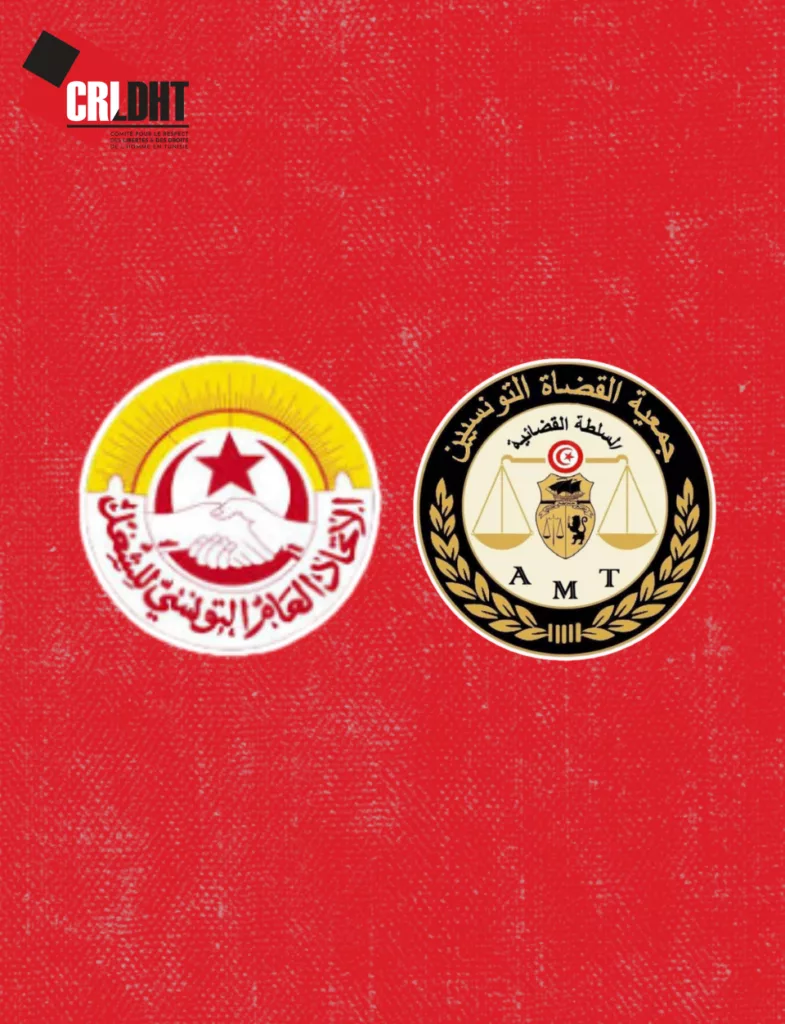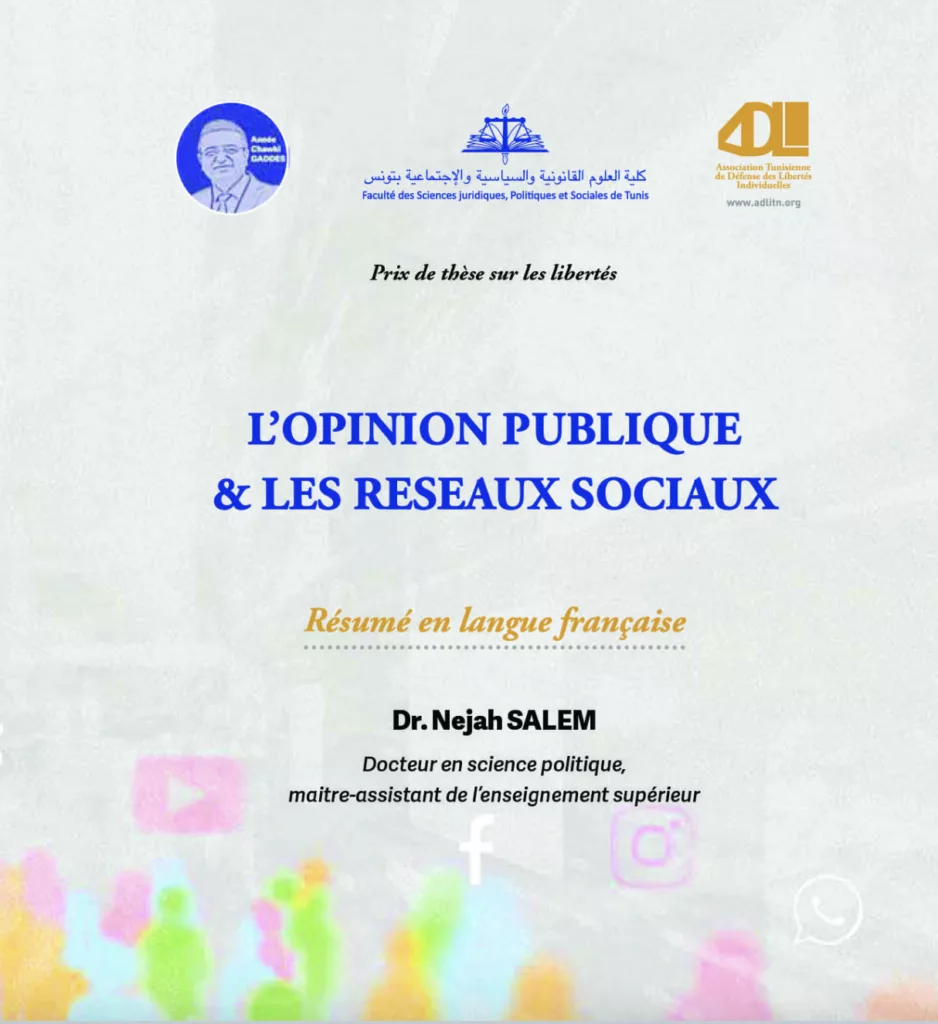Chaque jour, des dizaines de cas d’asphyxie sont recensés à Gabès. Les dispensaires, saturés, n’arrivent plus à accueillir tous les patients victimes d’évanouissements, de maladies respiratoires, dermatologiques et pulmonaires en forte hausse. L’air, le sol et l’eau y sont gravement pollués, la pêche artisanale est en déclin, et des dizaines d’espèces marines meurent quotidiennement, rejetées sans vie sur les plages.
La ville de Gabès vit une véritable catastrophe environnementale. Les fuites de gaz provenant du complexe chimique dégagent des substances toxiques — soufre, ammoniaque — tandis que d’immenses quantités de phosphogypse sont déversées en mer. En 2023, le gouvernement du président Kaïs Saïed avait pourtant décrété que cette matière n’était « ni radioactive ni dangereuse pour la santé », ignorant délibérément les études scientifiques alertant sur sa nocivité, ainsi que les preuves visibles à l’œil nu des dépôts massifs qui souillent les plages et les eaux côtières.
Même Kaïs Saïed, d’ordinaire adepte des formules ampoulées et des métaphores grandiloquentes, avait reconnu il y a quelque temps qu’il s’agissait d’un « véritable assassinat de la santé et de l’environnement à Gabès », qualifiant ce qui s’y déroule de « crime d’État ». Mais lorsque les habitants sont descendus dans la rue pour dénoncer cette catastrophe, la réponse du pouvoir fut la répression : arrestations de dizaines de personnes, usage massif de gaz lacrymogène touchant quartiers et habitations.
Cette brutalité n’a pas entamé la détermination des habitants. Le 21 octobre 2025, un mouvement de grève générale décrété par l’Union régionale du travail — soutenu par de nombreuses organisations civiles et professionnelles — a rassemblé plus de cent mille personnes, exigeant le démantèlement des unités polluantes du complexe chimique.
La crise de Gabès — et, plus largement, celle de la Tunisie — n’est pas seulement écologique: elle est aussi politique et morale. Le discours officiel du pouvoir est devenu objet de moquerie, notamment sur les réseaux sociaux et dans l’espace public, tant il est déconnecté des réalités. Le ministre de l’Équipement a ainsi expliqué que la mise à l’arrêt du dispositif antipollution du complexe était due à une pièce de rechange coûtant… 15 000 dinars (environ 4 000 euros). Quant au ministre de la Santé, il a proposé comme « solution » la construction d’un hôpital pour les malades du cancer à Gabès, afin d’y accueillir les victimes de la pollution.
Mais c’est encore une fois Kaïs Saïed qui s’est distingué. Après les grandes mobilisations du 21 octobre 2025, il a convoqué sa cheffe du gouvernement au petit matin. Assise devant lui, soumise, elle l’écoutait déblatérer : il parla de tout — des poètes satiriques arabes, d’un héros national exécuté par le colonialisme, des jeunes de la « génération Z » qu’il tourna en dérision —, sauf du drame de Gabès. Comme à son habitude, il s’en est pris aux « traîtres » et « comploteurs » que « le peuple a vomis » et qu’il promet de « châtier ». Mais quel rapport tout cela entretient-il avec l’empoisonnement quotidien des habitants de Gabès ? Qu’a-t-il entendu des cris de détresse de ses concitoyens ? Quelles mesures concrètes propose-t-il pour mettre fin à la catastrophe ou, à tout le moins, en limiter les effets ?
Les réponses, nous les connaissons. Depuis le début de son règne solitaire, Kaïs Saïed a montré une constance : lorsqu’il se révèle incapable de résoudre les crises politiques, économiques ou sociales — ce qui est désormais la norme —, il détourne l’attention par des accusations de complot, des menaces contre les opposants et des discours confus, remplis de métaphores creuses et d’invectives contre des ennemis imaginaires. En face, il invoque un « peuple » abstrait censé l’accompagner dans un « processus » dont chacun perçoit désormais l’issue désastreuse pour la Tunisie.
Ce que vit aujourd’hui le pays n’est pas seulement une nouvelle forme d’autoritarisme : c’est une crise profonde de gouvernance. Un président isolé du réel, concentrant tous les pouvoirs, dirige un État paralysé et des institutions réduites à l’impuissance. La Tunisie a déjà connu la dictature, la corruption, la répression et le dévoiement de l’État de droit. Mais jamais elle n’avait affronté un tel vide politique : un pouvoir à la fois impuissant, rancunier et coupé du monde réel.