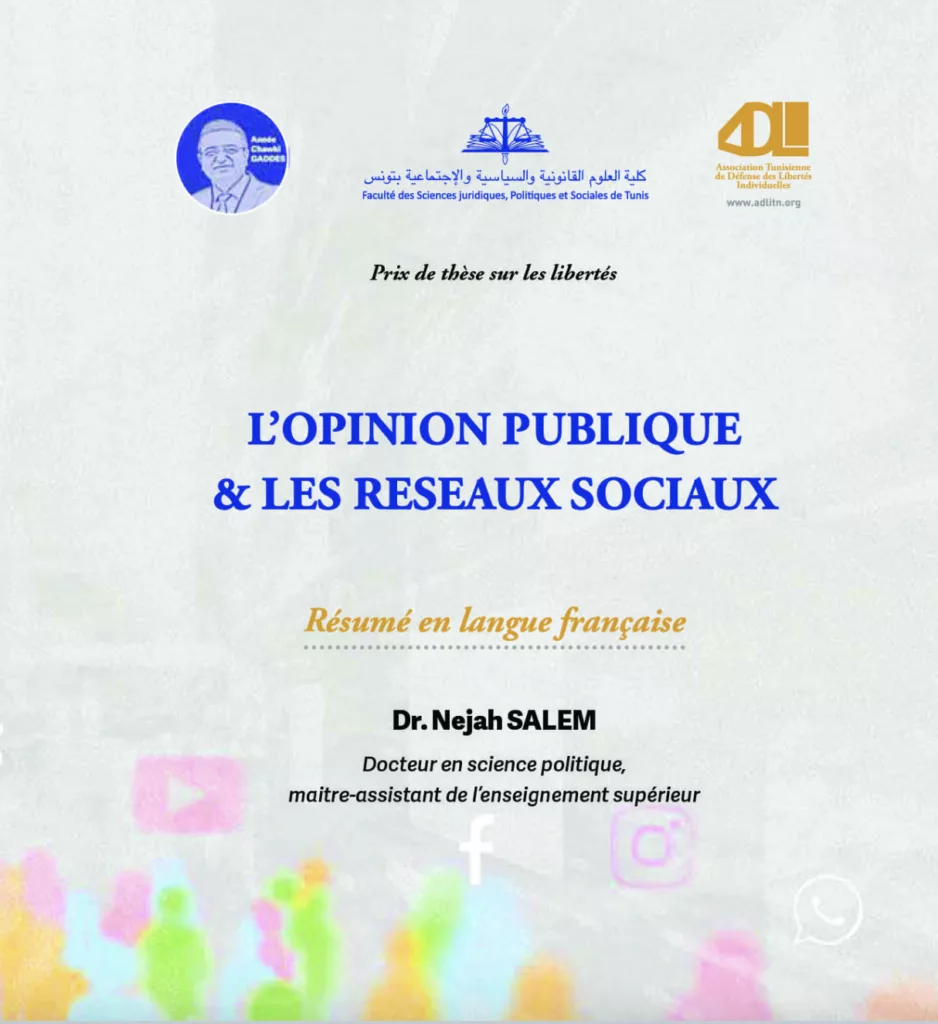La décision d’inscrire au tableau de l’Ordre des avocats de Tunisie un magistrat révoqué par le décret présidentiel n°516/2022 du 1er juin 2022 constitue une première. Elle a suscité de nombreuses réactions sur les pages des avocats, entre ceux qui remercient le Conseil de l’Ordre d’avoir enfin offert cette garantie, susceptible d’encourager l’indépendance de la magistrature en proposant une alternative au juge qui se rebelle contre les instructions et les immixtions de plus en plus systématiques du régime, et ceux qui, au contraire, font écho au dit régime en dénonçant cette décision, y voyant une concurrence déloyale et un défi inutile au pouvoir, et exprimant ainsi un corporatisme excessif, un populisme et une superficialité incompatibles avec les principes de la robe noire et son histoire en Tunisie. Certains vont même jusqu’à réclamer l’application d’un principe de réciprocité, comme s’il s’agissait de relations entre États.
La décision a été saluée par l’Association des magistrats tunisiens, qui y voit un important revirement dans la jurisprudence administrative de l’Ordre, renouant avec son rôle national dans la protection des libertés et des droits, ainsi que dans la défense de l’indépendance de la magistrature conformément aux normes internationales, en particulier dans une période où les magistrats subissent l’arbitraire d’un pouvoir cherchant à mettre la main sur l’autorité judiciaire et à lui nier toute garantie, notamment par des révocations opérées hors de tout cadre légal ou disciplinaire. Dans son communiqué du 18 décembre 2025, l’Association a exprimé l’espoir que tous les magistrats révoqués qui en feront la demande soient inscrits, et que le travail commun entre l’Association et l’Ordre se poursuive afin de rétablir les fondements de l’indépendance de la magistrature et de préserver l’État de droit.
De quoi s’agit-il ?
Après avoir décrété la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et instauré son propre conseil provisoire par le décret-loi présidentiel n°11/2022 par lequel il s’arrogeait déjà le dernier mot en matière de nominations et de cursus professionnel des juges, cela ne suffisait manifestement pas à celui qui avait déclaré, le 25 juillet 2021 présider le ministère public avant de se rétracter, tactiquement bien sûr. Le 1er juin 2022, il modifie l’article 20 de son décret-loi n°11/2022 par le décret-loi n°35/2022 et s’arroge, cette fois, le droit de révoquer tout magistrat par simple décret présidentiel, sans aucune procédure préalable, sans contradictoire et sans la moindre garantie du droit de défense.
Le décret de révocation n’est pas motivé et le magistrat concerné est automatiquement et impérativement traduit devant la justice pénale. Il est, en outre, privé du droit de contester sa révocation avant qu’un jugement pénal, rendu en dernier ressort et insusceptible de pourvoi, ne soit prononcé — de facto après plusieurs années. Le président Kaïs Saïed ne s’est pas privé de l’exercice de ces nouvelles prérogatives : le soir même, après avoir fustigé les magistrats par toutes sortes d’accusations, il décrète la révocation de 54 magistrats, décision publiée le jour même avec le décret-loi n°35/2022.
La dénonciation de ce véritable carnage visant notamment et surtout des magistrats ayant refusé les instructions de l’exécutif, a été nationale et internationale. Saisi, le Premier président du Tribunal administratif a ordonné un sursis à exécution pour certains d’entre eux, mais les autorités en place ont refusé d’obtempérer et ont poursuivi leur acharnement judiciaire contre ces magistrats.
La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, saisie de demandes de mesures provisoires dans l’affaire portée par les magistrats Hamdi Rahmani, Makram Hssouna, Sami Houidi et Khira Ben Khlifa, a ordonné, le 3 octobre 2024, de surseoir à l’application du décret-loi présidentiel n°35/2022 et du décret présidentiel n°516/2022.
La jurisprudence du Conseil de l’Ordre présidé par le bâtonnier Mziou
Comme cela a toujours été le cas historiquement, les magistrats révoqués ont cherché refuge au sein de l’Ordre des avocats.
Saisi des demandes d’un certain nombre de magistrats révoqués en 2022, le Conseil de l’Ordre, présidé par le bâtonnier Mziou, a déclaré ne nourrir aucun préjugé et vouloir traiter les dossiers au cas par cas. Il s’est toutefois écoulé plus d’un an avant qu’un refus collectif ne soit opposé à l’ensemble des demandes, dans un calendrier pour le moins douteux. En effet, ce refus est intervenu après une rencontre avec la ministre de la Justice et la libération de Maître Mehdi Zagrouba, victime de torture et de détention arbitraire. Si nul ne peut établir l’existence d’un quelconque accord, la suspicion demeure néanmoins légitime s’agissant d’un Conseil de l’Ordre qui a osé affirmer, dans un communiqué public, que le succès du processus du 25 juillet 2021 constituait une priorité pour l’Ordre — une position inédite pour une structure d’avocats, même si le Conseil de l’Ordre qui l’avait précédé, présidé par Bouderbala, incarnait déjà un véritable makhzen dans l’histoire de la profession.
Les pourvois en appel formés contre les décisions de refus ont révélé que, pour ce Conseil de l’Ordre, les magistrats révoqués demeuraient des magistrats, en dépit de leur révocation publiée au Journal officiel et du versement de leurs indemnités de révocation. Les refus ont été motivés par le dépôt des demandes auprès des sections et non directement auprès de l’Ordre, par l’existence de poursuites pénales à l’encontre des intéressés et par le fait qu’ils seraient toujours magistrats au regard des décisions de sursis à exécution rendues par le Premier président du Tribunal administratif.
Il est évident qu’il ne s’agissait là que de prétextes. La section est une composante de l’Ordre, et les demandes ont toujours été reçues par son intermédiaire. Au-delà de cet argument futile, le motif tiré de l’existence de poursuites pénales constitue un déni manifeste de la présomption d’innocence, l’un des principes juridiques les plus élémentaires, que le Conseil de l’Ordre n’a pas hésité à méconnaître, jetant ainsi l’opprobre sur l’ensemble de la profession. Quant au sursis à exécution, ces décisions ont une portée et des effets strictement relatifs : elles ne sauraient produire d’effet sur le statut juridique des intéressés, et encore moins à l’égard de tiers tels que le Conseil de l’Ordre, tant qu’elles n’ont pas été exécutées, notamment par le respect du principe du parallélisme des formes et par la publication de la réintégration au Journal officiel.
Le Conseil de l’Ordre ne peut être excusé de l’ignorance de ces règles élémentaires, d’autant plus que son pouvoir en matière d’inscription au tableau relève d’un pouvoir dit « lié », c’est-à-dire qu’il se limite à constater l’existence ou non des conditions requises et à statuer en conséquence, sans marge d’appréciation ni recherche de proportionnalité.
Il va sans dire qu’il s’agit d’une décision éminemment politique, relevant d’une logique d’allégeance au régime en place, et qui a été de facto désavouée l’Assemblée générale élective de l’Ordre des avocats. Celle-ci avait pourtant tranché sans ambiguïté, dès le premier tour, la course au bâtonnat en faveur du bâtonnier Boubaker Bethhabet, lequel s’était montré on ne peut plus clair sur la nécessité de revenir aux principes fondamentaux de la profession sur la question de l’inscription des juges révoqués. Toutefois, ce changement n’a pas, à ce stade, eu d’impact sur les affaires pendantes en appel contre les décisions de refus : l’Ordre demeure représenté par des avocats agissant de leur propre initiative, désignés par le bâtonnier Mziou pour défendre ses positions personnelles, et non celles de l’Ordre.
Peut-on parler de revirement ?
Le 12 décembre 2025, lors de la réunion du Conseil de l’Ordre appelée à statuer sur les dossiers d’inscription, un dossier présentait un caractère singulier. En effet, Monsieur Taher Khantech, magistrat victime du décret présidentiel n°516/2022, a introduit une demande de révision de la décision de refus prise par le précédent Conseil de l’Ordre. Le fondement de cette demande résidait dans le changement de statut du demandeur, devenu retraité, et qui sollicitait, à ce titre, son inscription sur le fondement de l’article 3 in fine du décret n°79/2011 portant organisation de la profession d’avocat.
Désireuse, semble-t-il, de marquer un changement de position, la majorité des membres du Conseil de l’Ordre a opté pour une réponse favorable à cette demande. Monsieur Taher Khantech est ainsi devenu le premier magistrat inscrit parmi les victimes du décret présidentiel n°516/2022.
Cependant, malgré ce changement de fait, la solution retenue n’est pas réellement conforme à la légalité, bien qu’elle soit pleinement légitime. On pourrait être tenté de raisonner en termes de parallélisme des violations de droit, consistant à réparer une violation par une autre, mais une telle logique ne saurait être celle des avocats, et encore moins celle du Conseil de l’Ordre, lequel se doit d’être légaliste et exemplaire.
En effet, sans remettre en cause la noblesse de la cause ni le mérite du Conseil de l’Ordre des avocats, il convient de rappeler qu’aucune procédure de demande de révision n’est prévue par la loi. Le Conseil de l’Ordre, comme exposé supra, ne dispose en la matière que d’un pouvoir lié et ne peut, a fortiori, créer de nouvelles procédures, ce qui relève indiscutablement de la compétence du pouvoir législatif. Cette initiative, inspirée par une juste cause, est certes louable, même si elle ne concerne qu’un seul cas, mais elle demeure juridiquement vulnérable : la décision n’est pas à l’abri d’un pourvoi en appel susceptible d’être formé par le procureur général près la Cour d’appel, lequel pourrait, à bon droit, en solliciter l’annulation, hypothèse juridiquement plausible nonobstant l’absence d’indépendance de la justice en Tunisie.
Ce n’est d’ailleurs pas le seul obstacle procédural auquel sont confrontés les magistrats révoqués. La solution consistant à introduire une nouvelle demande d’inscription demeure possible, mais elle suppose, une fois encore, le paiement de frais d’inscription s’élevant à 20 000 dinars, une somme considérable pour des personnes privées d’emploi depuis désormais trois ans. Il convient de rappeler que, dans plusieurs cas, les premiers frais d’inscription correspondaient purement et simplement à l’indemnité de révocation. Or, la loi ne prévoit pas la restitution de ces frais en cas de refus, sauf si le Conseil de l’Ordre décidait d’appliquer des frais d’inscription symboliques, comme cela a été fait discrètement en 2021 pour une centaine de demandeurs, pratique aujourd’hui contestée devant la Cour d’appel de Tunis et susceptible, à terme, de donner lieu à des poursuites pénales.
Le retrait serait la solution la plus adéquate
Le Conseil de l’Ordre peut parfaitement demeurer fidèle aux positions dûment et clairement exprimées par la majorité écrasante des avocats lors de l’Assemblée générale, notamment à travers les urnes de l’élection bâtonnale, sans avoir à recourir à la création de procédures exceptionnelles ou juridiquement inexistantes.
À cette fin, le Conseil de l’Ordre peut s’appuyer sur la technique du retrait, qu’il convient d’exposer brièvement avant d’en démontrer l’adéquation au cas d’espèce.
Il importe, bien entendu, de distinguer le retrait de la révocation. Dans les deux hypothèses, il s’agit de revenir sur une décision administrative ; toutefois, on parle de retrait lorsque la décision administrative individuelle, génératrice de droits subjectifs, a été notifiée à l’intéressé.
Le retrait est ainsi l’acte par lequel une autorité administrative compétente décide d’annuler une décision administrative qu’elle a déjà prise et publiée ou notifiée. Par cet acte, la décision est anéantie : elle ne peut plus produire d’effets, ni pour l’avenir ni rétroactivement. Cette technique est consacrée en droit administratif tunisien sous l’influence du droit français, qui avait posé le principe dès 1922 avec l’arrêt Dame Cachet, avant que la jurisprudence française ne connaisse de nombreuses évolutions puis une consécration législative.
En Tunisie, bien que le retrait soit également reconnu, la norme est demeurée essentiellement jurisprudentielle. C’est le Tribunal administratif, par une jurisprudence constante — non sans quelques hésitations initiales — qui en a confirmé le principe. L’arrêt de principe illustrant de manière définitive le choix de ce mécanisme et de son régime juridique en droit administratif tunisien est l’arrêt Moncef Chebil contre le ministre de l’Éducation nationale n°374 du 14 mai 1980, par lequel le Tribunal administratif confirme le principe du retrait et en fixe deux conditions s’agissant des actes administratifs individuels générateurs de droit : premièrement, que l’acte soit entaché d’un vice ou mal fondé, de nature à le rendre susceptible d’annulation juridictionnelle ; deuxièmement, que le retrait intervienne dans les délais de recours contre cet acte, sauf dans l’hypothèse où le Tribunal administratif qualifierait l’acte d’inexistant. Le Tribunal précise, en outre, que l’administration peut recourir au retrait sans qu’aucune partie n’en fasse la demande.
La jurisprudence de la Cour d’appel de Tunis a d’ailleurs consacré ce principe et son régime juridique, conformément à l’arrêt Moncef Chebil, tant en matière disciplinaire qu’en matière d’inscription au tableau des avocats, dans des dizaines de décisions rendues depuis 2019.
En revenant au cas d’espèce, à savoir celui des magistrats révoqués, le recours au retrait demeure possible dès lors que ces deux conditions peuvent être réunies. La première condition est largement satisfaite, compte tenu des vices ayant entaché les décisions du précédent Conseil de l’Ordre, notamment la violation de la présomption d’innocence, du principe du parallélisme des formes et du principe de neutralité de l’administration, entre autres.
La seconde condition peut, à première vue, sembler faire défaut au regard de la date de notification des décisions objet du retrait, dans la mesure où le délai de recours contre une décision non disciplinaire du Conseil de l’Ordre des avocats est d’un mois à compter de la notification de la décision ou de l’expiration du délai imparti pour son adoption, conformément à l’article 75 auquel renvoie l’article 74 du décret-loi n°79/2011. Toutefois, se limiter à ce délai revient à méconnaître une autre voie de recours expressément prévue par le Code de procédure civile et commerciale, à savoir l’appel incident, lequel encadre la question des délais de recours en appel. À cet égard, le Code dispose que :
« L’appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance. Jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d’appel. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf dans le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un désistement. »
Il s’ensuit que rien ne s’oppose légalement à ce que le Conseil de l’Ordre se fonde sur les délais de l’appel incident, lesquels ne sont pas encore expirés, dès lors que les magistrats révoqués ont porté les décisions devant la Cour d’appel, toujours saisie de ces affaires. Les délais de recours par appel incident demeurent ainsi ouverts, rendant ce type de pourvoi pleinement recevable.
Si la volonté de respecter et d’appliquer correctement la loi anime toujours la majorité du Conseil de l’Ordre, celui-ci peut donc procéder au retrait des décisions de refus d’inscription, solliciter de la Cour d’appel de Tunis la clôture des affaires pendantes pour extinction de leur objet, puis se ressaisir des dossiers afin de statuer à nouveau, au cas par cas, soit en procédant à l’inscription de chaque demandeur, soit en fondant un éventuel refus sur des motifs strictement juridiques prévus par la loi et dûment établis par les pièces du dossier.