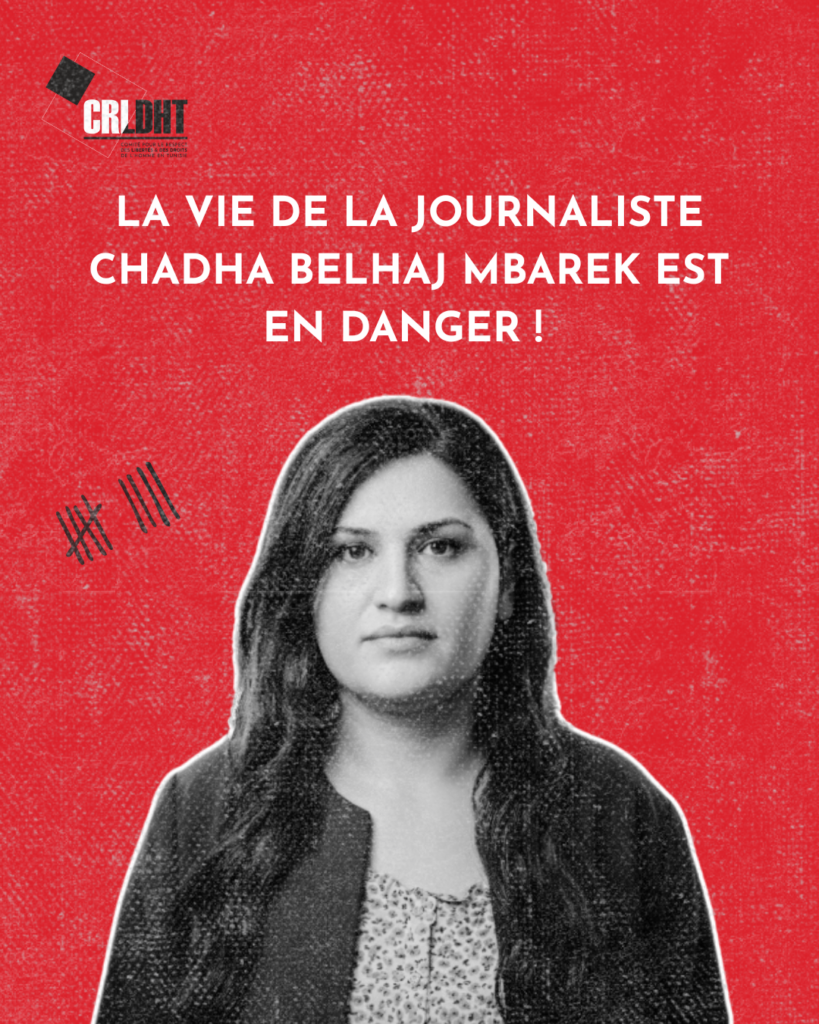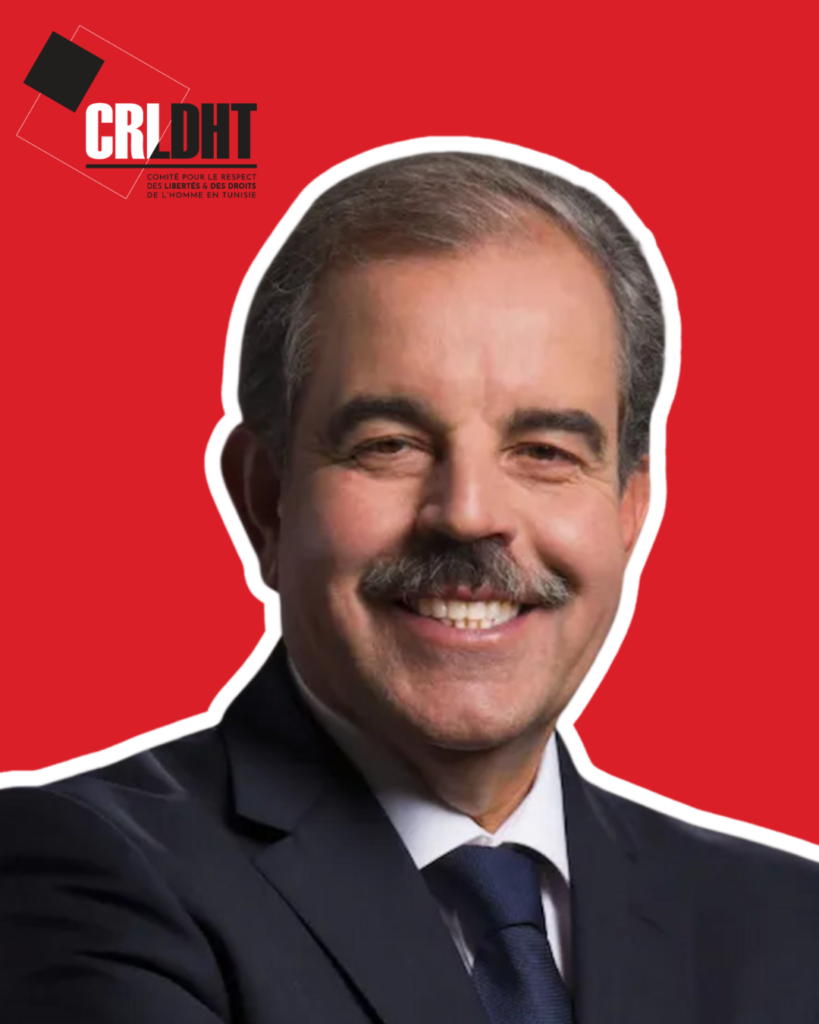Maroc, Algérie, Tunisie : trois trajectoires nationales, une fragmentation régionale
Dans un contexte mondial en mutation, où les logiques multilatérales sont supplantées par des rapports de force bruts, le Maghreb se présente comme une région en ébullition. Mais que recouvre réellement cette « ébullition » ? Est-elle le signe d’une instabilité politique généralisée, d’un basculement des alliances, ou d’un affaiblissement structurel des projets régionaux ? Ou encore, une manifestation d’un désajustement profond entre les ambitions étatiques, les attentes sociales et les nouveaux équilibres géopolitiques ?
Les ingérences étrangères jouent un rôle structurant dans ces dynamiques. Qu’elles soient israéliennes, émiraties, françaises, américaines, russes ou iraniennes, elles participent à complexifier les rapports de force internes, à exacerber les tensions interétatiques et à renforcer la fragmentation du Maghreb. Ces interventions extérieures, loin d’être homogènes, révèlent une géopolitique fragmentée : soutien sécuritaire au Maroc, appui énergétique à l’Algérie, instrumentalisation migratoire en Tunisie.
Par ailleurs, les alliances historiques héritées de la guerre froide évoluent. Le Maroc a consolidé ses partenariats traditionnels avec les États-Unis, l’Union européenne, la France, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, tout en développant des liens renforcés avec la Chine et la Russie. L’Algérie tente d’ouvrir un dialogue stratégique avec les États-Unis, malgré un tropisme russe ancien. La Tunisie, quant à elle, oscille entre alignements ponctuels, isolement croissant et dépendances multiples, sans vision stratégique lisible.
- Le Maroc : entre ambitions africaines, soft power et fractures internes
Le Maroc cherche activement à s’imposer comme puissance régionale à travers une stratégie articulée autour de trois axes : la reconnaissance internationale de la « marocanité du Sahara occidental », une diplomatie économique tournée vers l’Afrique subsaharienne, et une politique religieuse de soft power promouvant un « islam du juste milieu » face aux courants salafistes financés par d’autres puissances du Golfe.
Ce soft power s’illustre par la formation d’imams, la diffusion d’un islam modéré, le financement de mosquées, les investissements bancaires et commerciaux, ainsi qu’une stratégie médiatique offensive. Il s’accompagne de grands projets d’infrastructures comme le port de Tanger Med — pleinement opérationnel depuis plusieurs années — et celui de Dakhla, encore au stade de projet. Le développement de l’industrie automobile, les partenariats technologiques et les succès de l’OCP dans la vente d’engrais en Afrique et en Asie complètent cette stratégie.
Cependant, cette politique étrangère, pensée comme vitrine, ne masque pas les failles internes : pauvreté persistante, inégalités criantes, services publics dégradés, exode rural massif. Le sillage du séisme dans les villages de l’Atlas a mis en lumière les limites de la redistribution territoriale et sociale. Le PIB par habitant reste modeste au regard des ambitions affichées.
La question du Sahara occidental reste une obsession de l’État marocain. Si elle continue à fédérer l’opinion publique dans un réflexe nationaliste, le troc opéré en 2020 (normalisation avec Israël contre reconnaissance américaine du Sahara) a suscité un rejet moral, notamment en raison de l’attachement populaire à la cause palestinienne et du rôle spirituel du roi en tant que Commandeur des croyants et président du Comité Al-Qods.
Cette stratégie a néanmoins produit des effets diplomatiques : Rabat a obtenu le soutien explicite de plusieurs membres du Conseil de sécurité (États-Unis, Espagne, France, Royaume-Uni) pour son administration du territoire saharien, malgré le droit international et les résolutions onusiennes.
Comme l’a dit joliment le poète Abdellatif Laâbi, « le Maroc est malade de son Sahara ». Cette formule exprime bien la centralité presque pathologique de cette question dans la politique extérieure et intérieure du royaume.
Toutefois, la montée en puissance régionale du Maroc se déroule dans un climat de répression croissante, de verrouillage de la presse, et de rivalités internes attisées par l’affaiblissement du roi. L’expression de « fin de règne » évoque ici moins une succession politique qu’un ralentissement dans la prise de décision et une guerre larvée entre conseillers d’influence.
Reste une interrogation de fond : cette diplomatie africaine, aussi visible soit-elle, repose-t-elle sur une influence réelle ou sur un activisme circonstanciel ? Le Maroc a pris ses distances avec le Maghreb. Mais que fera-t-il de cette autonomie ?
- Algérie : une souveraineté défensive et un reflux d’influence
L’Algérie souffre d’un isolement croissant, malgré sa posture de souveraineté revendiquée. Sa diplomatie, centrée sur la rivalité avec le Maroc, manque d’initiatives. Le soutien au Polisario, invariable depuis des décennies, n’est pas accompagné d’une stratégie alternative ou d’un projet mobilisateur pour les Sahraouis.
La perte d’influence de l’Algérie est visible dans plusieurs sphères : retrait du Sahel, affaiblissement de son rôle dans l’Union africaine, marginalisation vis-à-vis de l’Union européenne. L’Algérie n’a pas seulement du mal à être un médiateur, elle ne l’est tout simplement plus. Que ce soit en Libye, au Mali ou au Niger, elle est souvent accusée d’ingérence et parfois même écartée des processus de médiation.
Ses tentatives de constituer un axe régional alternatif (avec la Tunisie et la Libye) peinent à convaincre. La Mauritanie s’en est tenue éloignée, et les résultats concrets font défaut.
Le système politique algérien reste prisonnier de son passé. Le personnel au pouvoir est issu d’une génération figée, fonctionnant selon les réflexes des années 1970. Il n’existe ni projet économique mobilisateur, ni récit social unificateur. La jeunesse, majoritaire dans le pays, est en rupture avec l’État. L’autoritarisme persiste, sans perspective de réinvention de la vie politique.
Plus grave encore : l’Algérie semble renoncer à ses propres fondamentaux. Son rôle de médiateur régional s’est estompé. Son engagement pour la cause palestinienne s’est affaibli. Sa politique sociale redistributive, pilier de sa légitimité historique, s’effrite.
La politique étrangère algérienne devient ainsi réactive plus que proactive, incapable de transformer sa souveraineté défensive en puissance d’influence. L’obsession anti-marocaine ne suffit plus à masquer le vide stratégique.
- Tunisie : diplomatie fragmentée, dépendances croisées
La Tunisie post-25 juillet 2021 évolue dans une forme de repli stratégique, entre souverainisme proclamé et réalités d’un isolement diplomatique profond. La politique étrangère est désormais pilotée par le Palais, sans contre-pouvoir ni expertise institutionnelle.
La dépendance vis-à-vis de l’Algérie est manifeste : gaz, aides budgétaires informelles, levier touristique (touristes algériens), couverture sécuritaire. En retour, la Tunisie a renoncé à sa neutralité historique sur le Sahara occidental.
D’autres influences pèsent aussi sur l’équation tunisienne : soutien actif des Émirats arabes unis à la réorientation autoritaire du pouvoir, marginalisation du Qatar, rumeurs persistantes de pénétration iranienne. Ces jeux d’influence, encore mal documentés, reflètent la vulnérabilité tunisienne dans un contexte de crise institutionnelle.
Sur le plan migratoire, la Tunisie est devenue un sous-traitant zélé de la politique européenne. L’Italie, notamment, finance des programmes de contrôle et de rétention. L’UE, globalement, ferme les yeux sur la dérive autoritaire en échange d’un contrôle renforcé des départs. Des chiffres sur les expulsions, les financements, et les accords sécuritaires seraient nécessaires pour mesurer l’ampleur de cette délégation sécuritaire.
Le souverainisme proclamé du président Kaïs Saïed ne se traduit par aucune autonomie réelle. Il s’agit d’un nationalisme verbal, sans base économique, diplomatique ni populaire solide. La diplomatie tunisienne est devenue erratique, transactionnelle, sans ancrage régional ou africain. L’illusion de puissance masque une perte totale d’influence.
Diplomaties d’appareil, aspirations populaires évacuées
Ce qui ressort de la conférence organisée par le CRLDHT, c’est le paradoxe d’une région en recomposition permanente mais sans projet partagé. Dans les trois pays, la politique étrangère est instrumentalisée pour servir des logiques de régimes et de survie politique, au détriment des intérêts populaires et de l’intégration régionale.
Les ambitions, lorsqu’elles existent, sont limitées : obtenir une reconnaissance déjà acquise (Sahara pour Rabat), contenir l’adversaire (Maroc pour Alger), maintenir le pouvoir (Tunisie). L’Union du Maghreb arabe n’est plus qu’un reliquat historique. Les sociétés sont exclues des débats stratégiques. L’autoritarisme se consolide. Les élites tournent en circuit fermé.
La question centrale devient alors : pour qui et pourquoi les diplomaties sont-elles pensées ? Quels peuples sont concernés ? Quelle légitimité sociale ou démocratique ces stratégies prétendent-elles incarner ?
Le défi est immense : reconstruire un horizon politique régional, réinventer des formes de solidarité, refonder une diplomatie maghrébine émancipée des injonctions extérieures et ancrée dans les aspirations populaires. Cela suppose un renversement des priorités : penser les peuples avant les régimes, la coopération avant la compétition, la souveraineté collective avant les allégeances croisées.
Cet article s’appuie sur la rencontre “Perspectives géopolitiques au Maghreb” organisée par le CRLDHT.