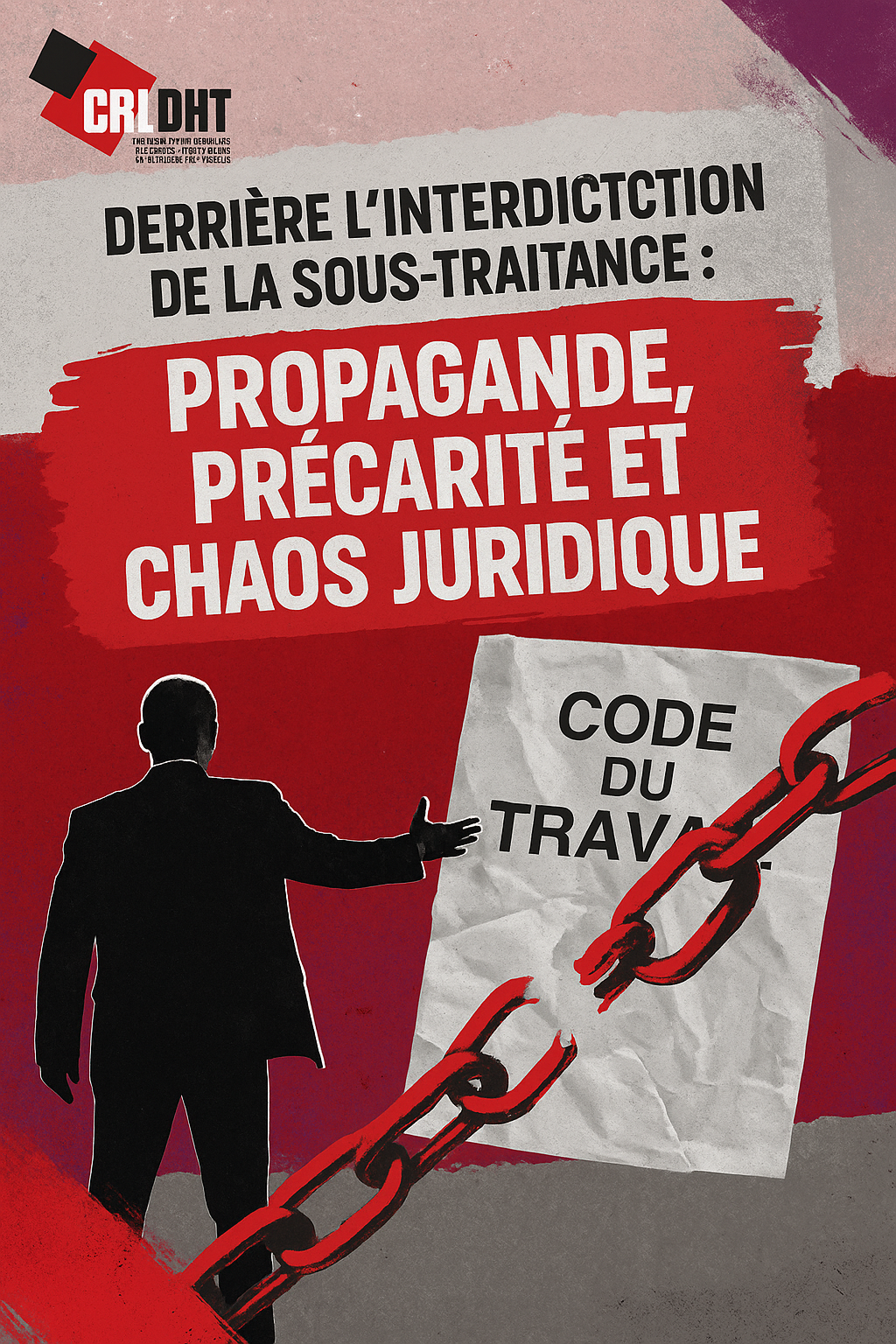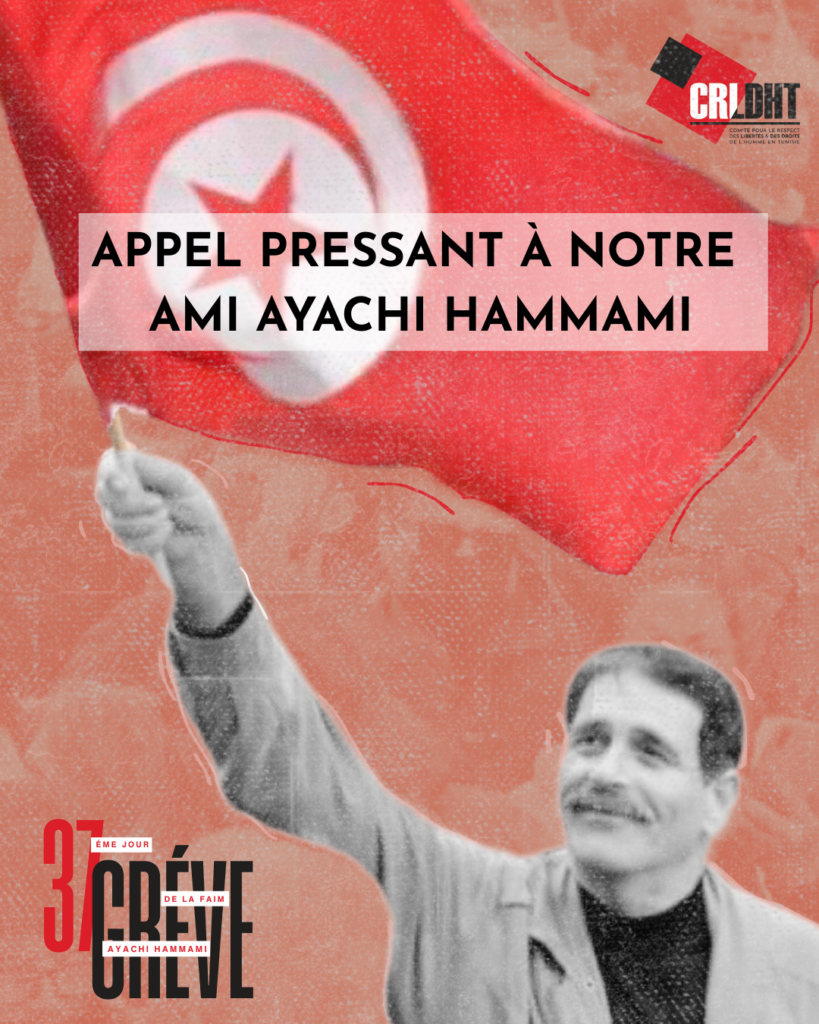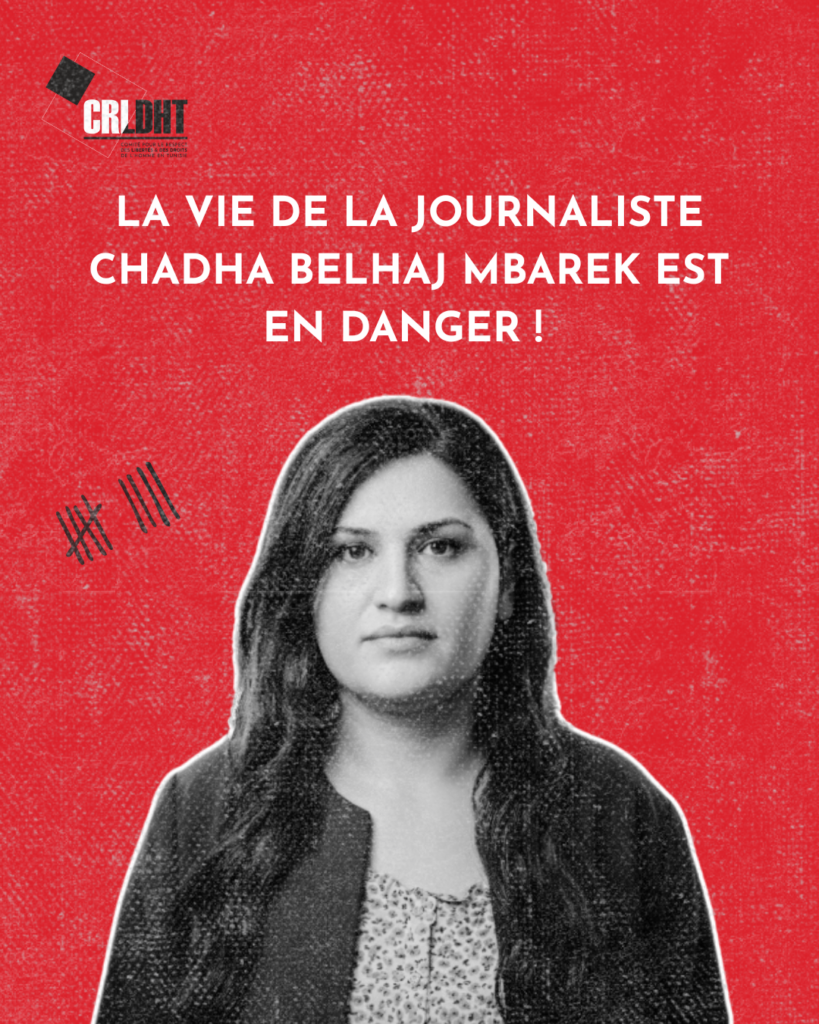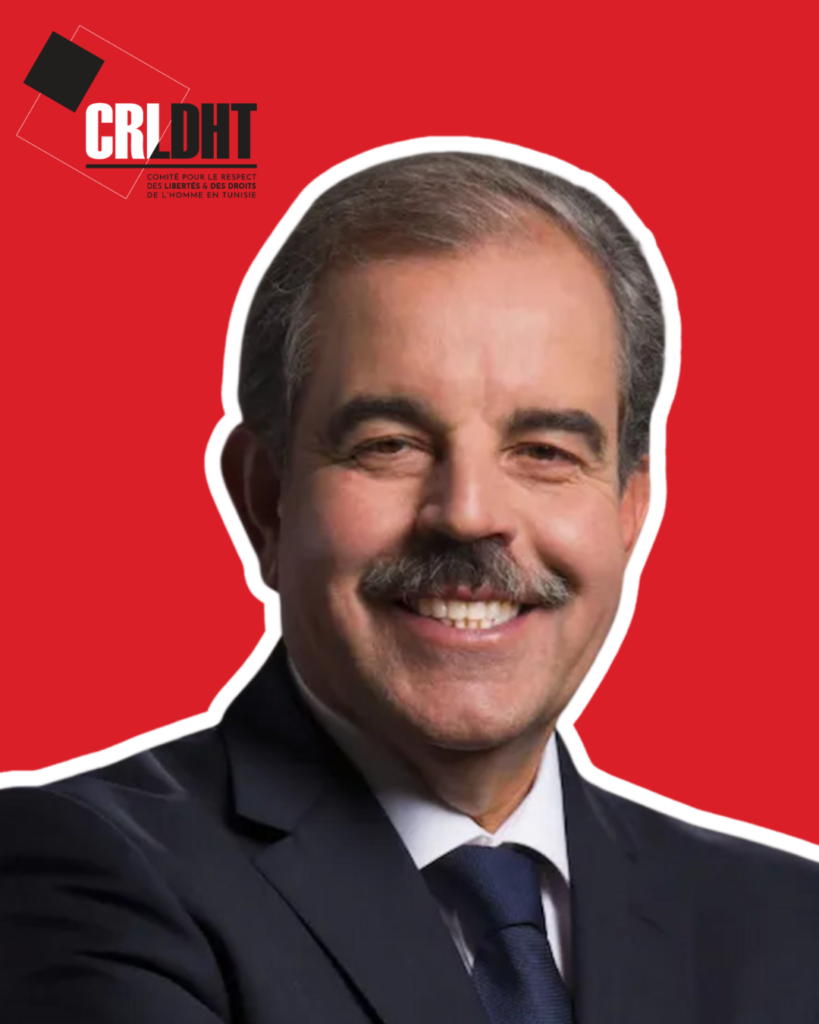Il s’agit de la loi n°9/2025 relative à l’organisation de trail et à l’interdiction de la sous-traitance, publiée au JORT du 23 mai 2025, votée le 21 mai 2025 à l’aube, conformément à la tradition présidentielle, portant modification du Code du travail. C’était un projet présidentiel donc prioritaire, non seulement sur le plan procédural, comme l’impose la Constitution, mais aussi sur le fond : sur 125 représentants de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), 121 ont voté pour le texte et 4 se sont abstenus. Bien sûr, aucun vote contre : l’ARP est plus que jamais un simple bureau d’ordre des lois présidentielles.
TENEUR
Le Contrat de travail à durée déterminée (CDD) n’est plus une option : c’est une exception au principe, qui devient celui du contrat à durée indéterminée (CDI). Ce principe est consacré dans plusieurs législations comparées, mais ce sont les cas tolérés de cette exception qui peuvent faire débat sur l’opportunité de ces mesures.
En effet, le recours aux CDD ne peut désormais être légal que s’il s’agit de :
- Une augmentation anormale du volume des services ou travaux ;
- Une suppléance provisoire pour un employé titulaire absent ou dont le contrat est expiré ;
- Des travaux saisonniers ;
- D’autres cas que le CDI ne peut contenir.
Le CDD ne peut être établi que par écrit, avec les mentions obligatoires déjà existantes. La nouveauté est l’obligation d’indiquer le cas d’exception motivant le recours au CDD. À défaut, le contrat se convertit en CDI.
Cette réforme pourrait être acceptable — elle semble d’ailleurs s’inspirer des choix du droit du travail français — mais une disposition reste exorbitante et illogique : tous les CDD en cours qui ne correspondent pas aux nouvelles exceptions sont réputés être des CDI à compter de la publication du texte, y compris ceux résiliés avant le 14 mars 2025. La reconversion n’est pas en soi une technique nouvelle, mais c’est son aspect subit et général qui rend la disposition exorbitante.
Les employés recrutés par sous-traitance dans les offices, établissements publics à caractère industriel, commercial et agricole sont également réputés titularisés à partir de la publication.
La sous-traitance de main-d’œuvre est définie dans la nouvelle loi comme tout contrat ou convention passée entre une entreprise employeuse de main-d’œuvre et une entreprise bénéficiaire, pour laquelle la main-d’œuvre est « louée » et mise à disposition par l’entreprise employeuse. Le concept s’applique également aux travailleurs du gardiennage et du nettoyage.
La violation de ces normes est pénalisée :
- Amende de 10 000 dinars pour les personnes physiques,
- 200 000 dinars pour les personnes morales,
- 10 000 dinars pour les représentants légaux ou dirigeants de l’entreprise bénéficiaire.
En cas de récidive, la peine est une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois.
Mais il faut noter que dans ces cas d’infraction à la loi, l’employeur ne peut continuer à opérer. Le chômage devient donc l’alternative au travail précaire.
Les entreprises de fourniture de services ne peuvent plus intervenir dans l’activité principale de l’entreprise bénéficiaire. Les seules activités tolérées sont celles nécessitant des compétences professionnelles ou une spécialisation technique pointue.
Les entreprises bénéficiaires doivent veiller au respect des droits des travailleurs employés par des entreprises de services, devenant responsables de l’application de la législation du travail. Ce contrôle s’étend jusqu’à la vérification des obligations de déclaration de l’entreprise de services.
Du point de méthodologique de la réforme, la dite-loi — à supposer qu’il s’agisse d’une réforme — est sporadique et partielle. Elle place le législateur dans une posture de réaction et de rafistolage, plutôt que dans une démarche de construction.
Elle vise à mettre fin à la conception introduite dans les années 1990 dans le Code du travail tunisien, à savoir la notion d’intérêt de l’entreprise, une refonte alors intégrée dans une vision globale du modèle de développement et de réforme économique.
Quelles que soient les critiques à l’encontre de ces réformes passées, elles s’inscrivaient dans une conception cohérente. Le nouveau texte, en revanche, est parachuté par le président de la République sans débat social ni vision sociétale, sans réflexion économique, ni micro, ni macro. Aucune commission, aucune statistique, aucune étude d’impact. Un empirisme d’un autre âge, qui rappelle les monarchies médiévales et s’accorde avec le messianisme que Kaïs Saïed semble s’attribuer.
Du point de vue juridique et économique, l’intervention, formellement législative, piétine de nombreux principes.
- Le phénomène juridique, censé organiser une réalité sociale, peut aussi agir sur elle. Mais pour cela, il doit respecter les principes généraux du droit et les équilibres entre droits subjectifs — forcément contradictoires.
Concernant les principes généraux du droit
- La modification du Code du travail ignore le consensualisme contractuel et fait de la relation de travail une institution. Cela renforce en soi la protection du salarié, réputé partie faible d’un contrat d’adhésion.
- Mais en convertissant subitement les CDD en CDI, c’est la sécurité juridique qui est atteinte — pas seulement dans la relation de travail, mais dans la conception générale des contrats.
- L’imprévisibilité liée à la rétroactivité de la loi a des répercussions catastrophiques sur l’investissement, interne comme externe. Elle compromet ainsi la création de richesse, en l’absence d’alternatives concrètes, pourtant sans cesse invoquées par le président.
Concernant le déséquilibre des droits subjectifs
- Si le texte vise à remédier aux abus liés au CDD et à la sous-traitance, il crée de nouveaux déséquilibres.
- En voulant « rééquilibrer », le législateur généralise la précarité, sans prendre en compte la réalité économique des employeurs.
- Comparer les banques ou assurances à de petites ou moyennes entreprises luttant pour survivre est une erreur méthodologique monumentale.
- Aucun accompagnement n’est prévu pour les employeurs : ni assistance, ni ligne de crédit, ni évaluation de l’impact sur la performance ou la compétitivité — nationale ou internationale.
La conception retenue repose sur une lecture simpliste d’une relation entre deux parties — l’une oppressive, l’autre opprimée — attendant le sauveur présidentiel.
Aucune place n’est faite à l’intérêt de l’entreprise, pourtant au cœur de la réforme de 1996.
Dans cette loi, l’entreprise est réduite à une entité à surveiller, non plus génératrice de richesse ou d’emploi.
CONCLUSION
La quête de Kaïs Saïed pour des réalisations « sociales » l’emporte sur les considérations juridiques et économiques. Ce texte répond à des besoins propagandistes et populistes.
En prétendant lutter contre la précarité sociale, il risque de la généraliser à toutes les entreprises.
L’extension automatique aux entités publiques, en titularisant les travailleurs sous contrat précaire sans prévoir de budget — alors qu’elles sont déjà surendettées — démontre une nouvelle fois le caractère incantatoire et irresponsable de cette loi.
Elle risque d’engendrer des obstacles insurmontables pour les employeurs, de freiner l’investissement et de nuire à l’employabilité. Une fois encore, Kaïs Saïed semble vouloir miner le terrain pour ses successeurs — à moins qu’il ne pousse les employeurs vers la robotisation ou l’économie informelle.
Mais c’est plutôt le secteur parallèle qui en sortira renforcé. À moins d’un improbable rétropédalage du président — lui qui prétend que ce texte est une prouesse saluée par une liesse populaire.
Et même s’il a souvent modifié ses propres textes, il sera difficile de revenir en arrière à temps.
Dans les textes qu’il considère comme emblématiques et universels — comme la transaction pénale ou les sociétés communautaires — il reste fidèle à sa théorie du cheval mort : si ça ne marche pas, c’est qu’il y a des comploteurs dans l’ombre.
Et puisqu’il promet d’autres textes du même acabit, la mise en scène de la liesse populaire risque de durer encore un moment.