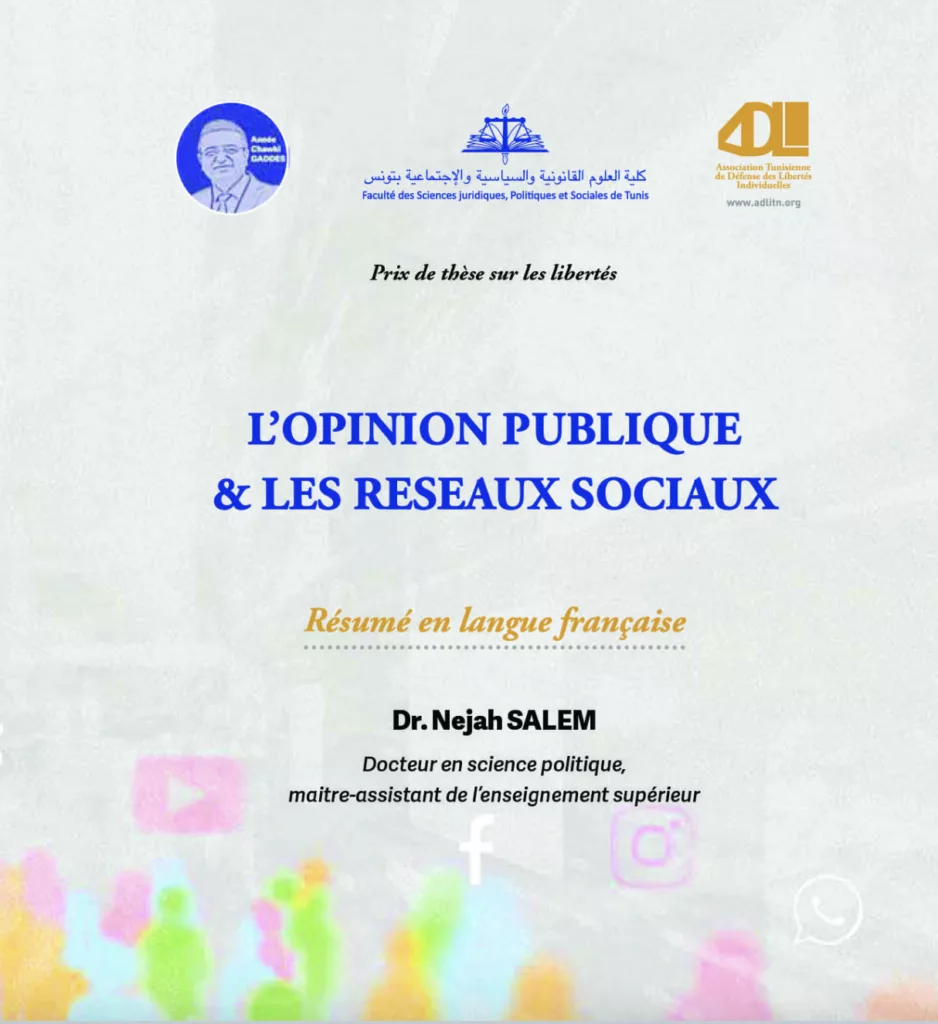Le 17 décembre 2025 n’a pas été une commémoration univoque. Il a été une journée de fractures, révélatrice d’une Tunisie traversée par des colères, des attentes et des usages opposés de la rue. Surtout, il s’inscrit dans une séquence politique précise : celle des quatre samedis consécutifs de manifestations réussies, à Tunis notamment, qui ont remis au centre du débat public les libertés, l’indépendance de la justice et la fin de l’arbitraire.
C’est cette dynamique que le pouvoir a cherché à enrayer, non pas par le dialogue ou des réponses politiques, mais par une opération inverse : fabriquer une démonstration de soutien, puis la transformer, par un glissement sémantique lourd de conséquences, en “mandat populaire” censé autoriser une accélération générale de l’action de l’État.
Or, ce glissement pose un problème politique majeur et, plus encore, un problème juridique fondamental.
Avant le 17 décembre : quatre samedis qui démentent le récit officiel
Les rassemblements du 17 décembre ne surgissent pas dans un vide politique. Ils sont précédés par quatre samedis successifs de mobilisations citoyennes, organisées malgré un climat de peur, d’intimidation judiciaire et de répression.
Ces marches, loin d’être marginales, ont montré :
- la réapparition d’une rue pluraliste, non encadrée par l’État ;
- la centralité de revendications claires : libertés publiques, libération des détenu·es d’opinion, indépendance de la justice ;
- une continuité qui contredit l’idée d’un peuple rallié ou silencieux.
Du point de vue du droit constitutionnel et international, ces mobilisations relèvent pleinement de l’exercice normal du droit de réunion pacifique, garanti aussi bien par la Constitution de 2022 que par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par la Tunisie. Aucune autorité ne peut donc, juridiquement, les disqualifier comme “désordre”, “trahison” ou “complot” sans violer ses propres engagements normatifs.
Le 17 décembre à Tunis : une manifestation transformée en « mandat »
Le pouvoir a déjà tranché par décret symbolique : consacrer le 17 décembre comme “date de la révolution”, au détriment du 14 janvier. Ce n’est pas un détail de calendrier : c’est une réécriture. Et le 17 décembre 2025 devient l’outil parfait : multiplier les images “d’unité” et noyer la pluralité des colères dans une seule narration.
Le 17 décembre, à Tunis, une manifestation de soutien à Kaies Saied et au processus issu du coup d’état constitutionnel du 25 juillet est organisée sur l’avenue Habib Bourguiba. Le caractère officiellement soutenu de cette mobilisation est assumé a posteriori par la présidence, qui la qualifie successivement de “صفعة”،(gifle) puis de “صفعة تاريخية( gifle historique) ”، avant d’y voir l’expression d’un “mandat populaire”.
C’est ici que la rupture juridique intervient.
1. Le « mandat populaire » n’existe pas en droit constitutionnel tunisien
Ni la Constitution de 2014 (désormais abrogée), ni celle de 2022 ne connaissent une catégorie juridique appelée “mandat populaire” issu d’une manifestation.
La souveraineté du peuple, dans l’ordre constitutionnel tunisien, s’exerce exclusivement selon des procédures déterminées : élections, référendums, institutions prévues par la Constitution.
Une manifestation — fût-elle massive — n’est pas un mécanisme de délégation de pouvoir, encore moins une autorisation générale de gouverner autrement, plus vite ou hors des garanties légales. En faire un “mandat” revient à substituer l’événementiel politique à la légalité constitutionnelle.
Autrement dit : ce que le pouvoir présente comme un fondement juridique n’est qu’un acte de communication politique, sans valeur normative.
2. la neutralité de l’administration : un principe violé
La polémique autour de la logistique (bus affrétés, moyens de transport publics ou parapublics, mobilisation des réseaux administratifs locaux) n’est pas anecdotique. Elle touche au principe constitutionnel de neutralité de l’administration et des services publics.
L’administration, selon la Constitution de 2022 elle-même, doit servir l’intérêt général dans l’égalité et la neutralité. Elle ne peut être mobilisée au profit d’un camp politique, encore moins pour fabriquer une démonstration de légitimité.
Si des moyens publics — directs ou indirects — ont été utilisés pour faciliter une manifestation de soutien, pendant que d’autres mobilisations font face à l’entrave, à la surveillance ou à la répression, alors il y a rupture d’égalité et détournement de la puissance publique.
Cette question engage aussi la responsabilité pénale et financière, notamment au regard des règles encadrant l’usage des ressources publiques et des entreprises publiques et du principe de non-affectation partisane des moyens de l’État.
Le même jour, d’autres rues, d’autres légitimités
Gabès : la rue pour vivre
À Gabès, le 17 décembre prend un sens radicalement différent. Des milliers de citoyennes et citoyens marchent pour exiger la fin de la pollution industrielle, le droit à un environnement sain et la dignité.
Ici, la rue n’est pas un décor de légitimation du pouvoir : elle est une interpellation directe de l’État, fondée sur des droits reconnus — droit à la santé, à la vie, à un environnement sain.
Juridiquement, ces revendications s’inscrivent dans les obligations positives de l’État tunisien, issues aussi bien de la Constitution que des conventions internationales ratifiées. Les ignorer, ou les reléguer derrière un discours de “سيادة” (souveraineté) abstraite, relève d’une défaillance de l’État de droit, non d’un choix politique neutre.
Kairouan : la colère contre l’impunité
À Kairouan, la journée est marquée par la colère suscitée par la mort de Naïm Briki, dans des circonstances impliquant des violences policières.
Les protestations qui s’ensuivent et les arrestations qui les accompagnent, posent une question centrale : celle de l’usage de la force, de la responsabilité des agents de l’État et de l’impunité.
Or, le droit tunisien, comme le droit international, impose :
- une enquête effective, indépendante et impartiale ;
- la proportionnalité dans le maintien de l’ordre ;
- la protection du droit de manifester, même dans un contexte de tension.
Là encore, parler de “mandat populaire” pendant que des familles réclament vérité et justice révèle un décalage brutal entre le discours officiel et la réalité juridique.
Effacer les quatre samedi : une tentative politiquement vaine, juridiquement infondée
En invoquant un “mandat populaire” issu du 17 décembre, le pouvoir cherche à produire un effet précis : effacer la séquence précédente, délégitimer les mobilisations critiques et justifier une phase de durcissement — annoncée par la formule de la “vitesse maximale”.
Mais juridiquement, cette tentative échoue sur tous les plans :
- une manifestation ne crée pas de mandat ;
- la “vitesse” n’est pas un régime constitutionnel ;
- aucune mobilisation, même massive, n’autorise la suspension des libertés, la neutralisation de la justice ou l’instrumentalisation de l’administration.
Même si les chiffres avaient été dix fois supérieurs, le raisonnement serait identique : l’État de droit ne fonctionne pas par acclamations.
Le 17 décembre révèle la vraie ligne de fracture
Le 17 décembre 2025 n’a pas prouvé l’unité du peuple. Il a révélé la profondeur du clivage :
- entre une rue mise en scène pour légitimer le pouvoir,
- et des rues qui réclament des droits, de la justice, de l’air, de la vie.
En droit comme en politique, la souveraineté ne se proclame pas, elle s’exerce dans des cadres précis, avec des limites claires.
Transformer une manifestation encadrée en “mandat populaire”, c’est franchir une ligne dangereuse : celle où la rhétorique prétend remplacer la Constitution.
Or l’histoire tunisienne est claire sur un point : chaque fois que le pouvoir a confondu la rue avec un blanc-seing, il a préparé non la stabilité, mais la crise suivante.