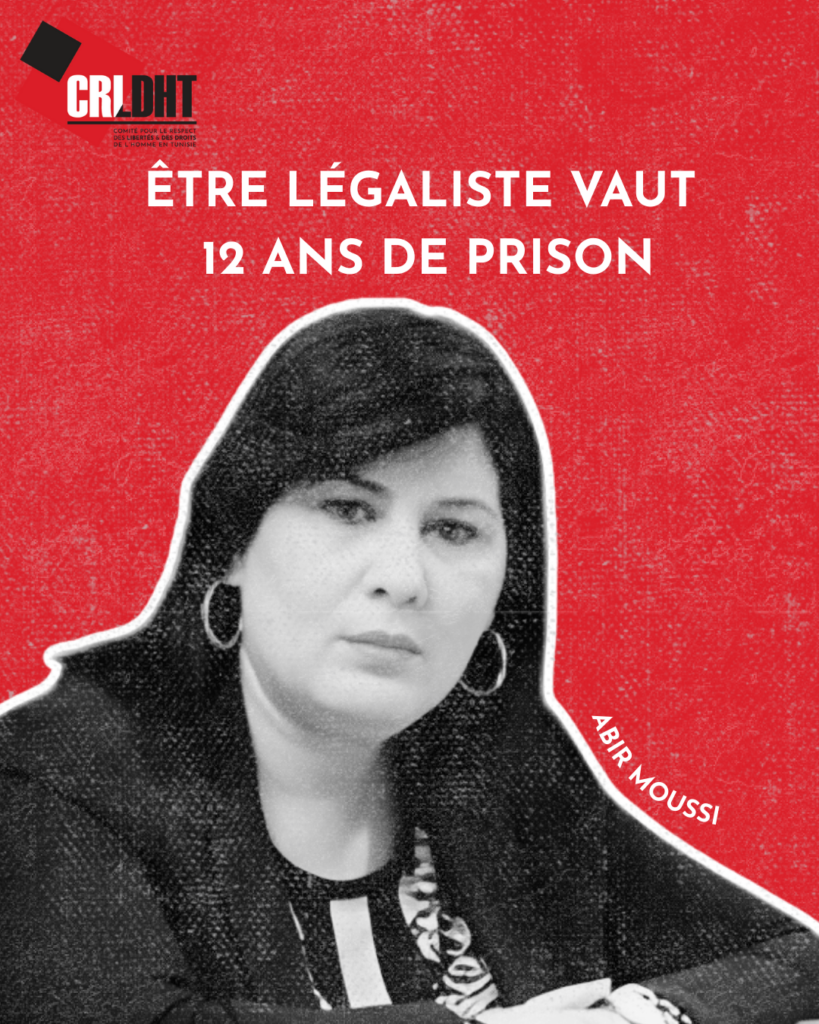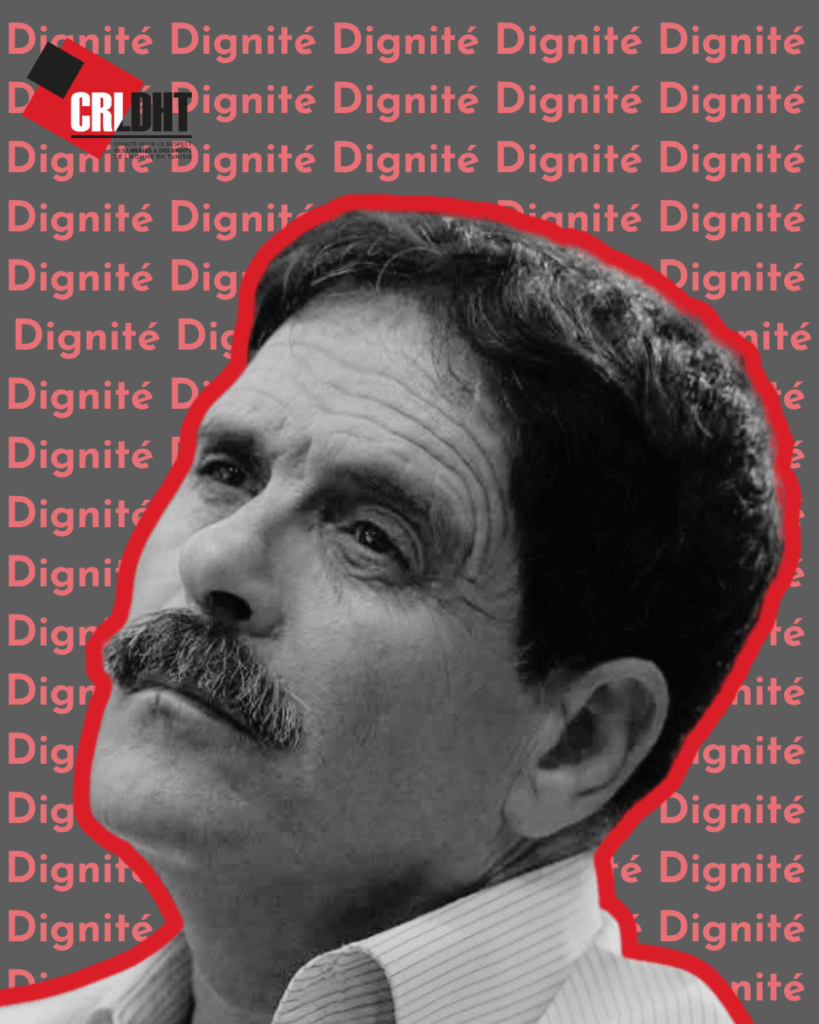- Les faits et le contenu de l’affaire jugée en première instance
Tayeb Rached, ancien omnipotent Premier président de la Cour de cassation tunisienne (2019) et ancien avocat général près la Cour d’appel de Tunis, a été le principal protagoniste d’un conflit très médiatisé et suivi depuis 2020. Il a été condamné le 27 octobre 2025 par le tribunal de première instance de Tunis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment pour corruption.
En examinant un dossier disciplinaire concernant deux magistrats de cassation, le Conseil supérieur de la magistrature a découvert qu’il ne s’agissait que de simples exécutants — de « petits poissons ». Il décida alors d’ordonner une enquête disciplinaire et une autre judiciaire afin de démasquer les auteurs d’un réseau bien rodé de corruption judiciaire.
Ce fut le point de départ de ce qu’on a baptisé « l’affaire des cassations sans renvois ».
Le Premier président de la plus haute cour judiciaire, Tayeb Rached, était soupçonné d’être intervenu — déjà lorsqu’il était avocat général — au profit d’hommes d’affaires dans une affaire criminelle à fort enjeu économique. Il aurait influencé la procédure afin que l’affaire soit close en cassation sans renvoi, moyennant le versement d’importantes sommes d’argent, causant ainsi des dommages considérables à l’État.
Ces faits n’étaient que l’arbre qui cachait la forêt : l’intéressé aurait orchestré un dispositif procédural rappelant le « couloir » du temps de Ben Ali, en constituant une chambre de cassation à la composition illégale (les deux juges condamnés disciplinairement au départ de l’affaire en faisaient partie), laquelle rendait des arrêts « à la demande » de Tayeb Rached.
Les enquêtes ont révélé d’autres faits et agissements passibles de lourdes peines pénales.
- Chronologie des événements clés
- 23 juin 2019 : la Direction générale de l’Inspection du ministère de la Justice est saisie d’un dossier portant sur des infractions procédurales dans plusieurs affaires de cassation sans renvoi.
- Novembre 2019 : l’Inspection générale transmet un premier rapport préliminaire confirmant l’existence de graves dépassements et irrégularités.
- Novembre 2019 : le dossier est officiellement transmis au Parquet pour ouverture d’une enquête judiciaire.
- Septembre 2020 : ouverture d’un dossier d’instruction et demande de levée d’immunité du Premier président de la Cour de cassation, Tayeb Rached.
- Novembre 2020 : levée effective de l’immunité par le Conseil supérieur de la magistrature.
- Décembre 2020 : gel de la qualité de membre de Tayeb Rached au sein du Conseil supérieur de la magistrature.
Cette séquence d’actes marque le basculement du dossier du plan disciplinaire vers le champ pénal, ouvrant la voie aux enquêtes approfondies et à la procédure judiciaire qui culminera par le jugement du 27 octobre 2025.
- Dispositif du jugement du 27 octobre 2025
Les accusés ont été condamnés, selon leurs rôles respectifs, pour corruption et enrichissement illicite, faux en écriture publique, abus de fonction, blanchiment d’argent et usage de documents falsifiés.
Abderrazak Bahouri et Marouane Tellili ont été condamnés pour faux en écriture publique, corruption passive, association de malfaiteurs à des fins d’enrichissement illicite et médiation pour corruption.
Les peines de prison sont lourdes : Tayeb Rached a été condamné à une trentaine d’années d’emprisonnement.
Des peines complémentaires ont également été prononcées : amendes considérables, confiscation de comptes et de titres fonciers et paiement solidaire d’un montant record de plus de 935 millions de dinars au profit de l’État, à titre de dédommagement, avec exécution immédiate.
- Le contexte judicaire et institutionnel : une justice sous tutelle présidentielle
Bien que les preuves publiées et médiatisées contre Tayeb Rached et les autres accusés soient accablantes, cela ne doit pas occulter le fait — ou plutôt la vérité — qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable.
Aussi évidente que soit la culpabilité, elle ne saurait priver les accusés de leurs droits fondamentaux. Or, le procès équitable, bien que consacré par la Constitution de Kaïs Saïed, est devenu impossible dans le contexte actuel.
Depuis le 25 juillet 2021, la justice tunisienne est devenue la cible méthodique du président, qui s’est arrogé tous les pouvoirs par le décret supraconstitutionnel n°117/2021, puis par une Constitution qu’il a lui-même rédigée.
En février 2022, le décret-loi n°11/2022 a dissous le Conseil supérieur de la magistrature élu, remplacé par un conseil provisoire dont les membres sont désignés par le président. La loi organique régissant le Conseil a été abrogée.
En juin 2022, le décret-loi n°35/2022 a encore renforcé le pouvoir présidentiel : le président peut désormais révoquer n’importe quel magistrat sans procédure disciplinaire ni contradictoire préalable. Le magistrat révoqué est automatiquement poursuivi pénalement, sans possibilité de recours avant jugement.
Dans la même nuit, 57 magistrats furent révoqués. Les décisions de sursis prononcées par le tribunal administratif, ainsi que l’arrêt provisoire de la Cour africaine des droits de l’homme ordonnant la suspension de ces révocations, n’ont pas été respectés.
Le dénigrement public et les menaces récurrentes du président à l’encontre des magistrats ont instauré un climat de terreur. Pour mieux les contrôler, il a omis de désigner de nouveaux membres au Conseil supérieur de la magistrature, désormais privé de quorum.
Les mutations et promotions se font désormais par simples notes de service de la ministre de la Justice, selon la docilité des intéressés.
Dans ces conditions, l’indépendance de la justice est irrémédiablement compromise. Tout accusé devient, dès le départ, victime d’une violation de ses droits fondamentaux.
La « guerre contre la corruption » menée par Kaïs Saïed se transforme ainsi en une fabrique de victimes : les coupables réels deviennent les victimes d’une justice illégitime, ce qui compromettra toute restauration future de l’État de droit.
- L’historique et le déroulement de l’affaire
L’affaire Tayeb Rached n’aurait sans doute pas éclaté sans la vigilance du Conseil supérieur élu de la magistrature, qui mit au jour un véritable iceberg de corruption.
Cependant, le Conseil, notamment le Conseil supérieur judiciaire, n’était pas unanime sur ce dossier, extrêmement clivant.
Malgré des éléments probants, Tayeb Rached ne fut suspendu de ses fonctions de Premier président de la Cour de cassation que le 20 août 2021, ce qui contribua à fragiliser le Conseil.
Son président, Youssef Bouzekher, et quelques membres ont néanmoins tenu bon pour que des enquêtes sérieuses soient menées.
Il faut également souligner le rôle décisif du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, dont l’enquête a révélé des faits accablants contre Tayeb Rached.
Cette affaire fut inédite à plus d’un titre. C’était la première fois dans l’histoire de la Tunisie :
- Qu’un Premier président de la Cour de cassation en exercice soit poursuivi pour corruption (trois poursuites pénales) ;
- Qu’un Premier président de la Cour de cassation voie son immunité levée ;
- Qu’il soit suspendu comme membre du Conseil supérieur de la magistrature tout en continuant à présider la Cour de cassation ;
- Qu’il continue à exercer alors que son immunité est levée et sa suspension prononcée ;
- Qu’une affaire pénale et disciplinaire de magistrats à ce niveau soit si médiatisée ;
- Qu’un Premier président de la Cour de cassation paraisse dans une émission télévisée pour plaider son innocence sur une chaîne appartenant à un bénéficiaire présumé de la corruption ;
- Qu’une question divise autant le Conseil supérieur élu, certaines décisions se prenant à une voix près.
La publication du réquisitoire et des documents du dossier (titres de propriété, contrats d’acquisition à des prix dérisoires) a donné à l’affaire une nouvelle dimension.
V. Analyse critique : contradictions et dérives
Les tactiques de défense de Tayeb Rached ont aussi amplifié l’affaire. Il documentait les anomalies et infractions commises par ses collègues, qu’il couvrait lui-même, afin d’exercer un chantage en cas de désaccord. Il imposait une omerta généralisée.
Sa défense a consisté à politiser l’affaire : il accusa Bachir El Akremi de terrorisme et de collusion avec Ennahdha, rallia des soutiens politiques et médiatiques, et transforma le dossier en un duel médiatique Rached vs Akremi.
Les magistrats qui avaient dénoncé le traitement de faveur accordé à Rached furent à leur tour pris pour cibles, comme Hamadi Rahmani, auteur de statuts et pétitions réclamant la suspension du Premier président.
Ironie du sort : le 30 octobre 2025, Rahmani a comparu devant la chambre correctionnelle du tribunal de Tunis, accusé de diffamation à la suite d’une plainte de Tayeb Rached.
Révoqué par le régime de Kaïs Saïed, il subit aujourd’hui un acharnement judiciaire, pour avoir défendu l’indépendance de la magistrature.
Autre contradiction : le sort réservé à Bechir Akremi, procureur de la République du tribunal de Tunis, dont la condamnation de Rached confirme en réalité l’intégrité.
Persécuté, torturé, arbitrairement détenu, Akremi a été l’un des premiers à dévoiler les infractions imputées à Rached.
Ainsi, la justice de Kaïs Saïed n’éprouve aucune gêne à condamner Tayeb Rached pour corruption tout en poursuivant Hamadi Rahmani pour avoir dénoncé cette même corruption.
C’est une justice qui nie le contradictoire et consacre la contradiction.
- Recommandations et enseignements
- Garantir l’indépendance de la justice
- Restaurer un Conseil supérieur de la magistrature élu, autonome, et doté de garanties constitutionnelles.
- Abroger les décrets-lois n°11/2022 et n°35/2022 qui ont placé le corps judiciaire sous la tutelle directe du président.
- Assurer le droit à un procès équitable
- Réinstaurer les garanties procédurales fondamentales (contradictoire, publicité, droit à la défense).
- Mettre fin à la justice d’exception et aux jugements rendus sous influence politique.
- Protéger les magistrats et lanceurs d’alerte
- Réhabiliter et indemniser les magistrats arbitrairement révoqués.
- Protéger les juges, avocats et procureurs qui dénoncent la corruption ou défendent l’État de droit.
- Réparer la crédibilité du système judiciaire
- Publier intégralement les jugements de l’affaire Tayeb Rached et les décisions afférentes pour restaurer la confiance du public.
- Établir une commission indépendante pour auditer les décisions de la Cour de cassation depuis 2018.
- Prévenir la “fabrique de victimes”
- Reconnaître que la lutte contre la corruption ne peut être crédible que dans un cadre d’État de droit.
- Rejeter toute instrumentalisation de la justice à des fins de règlement de comptes politiques.
Conclusion
Dieu nous préserve de l’équité de la « justice » de Kaïs Saïed.
L’affaire Tayeb Rached, dans toute sa complexité, révèle autant la profondeur de la corruption que la faillite d’un système judiciaire placé sous tutelle politique.
C’est un tournant historique qui doit servir d’avertissement et de fondement à une refondation démocratique de la justice tunisienne.