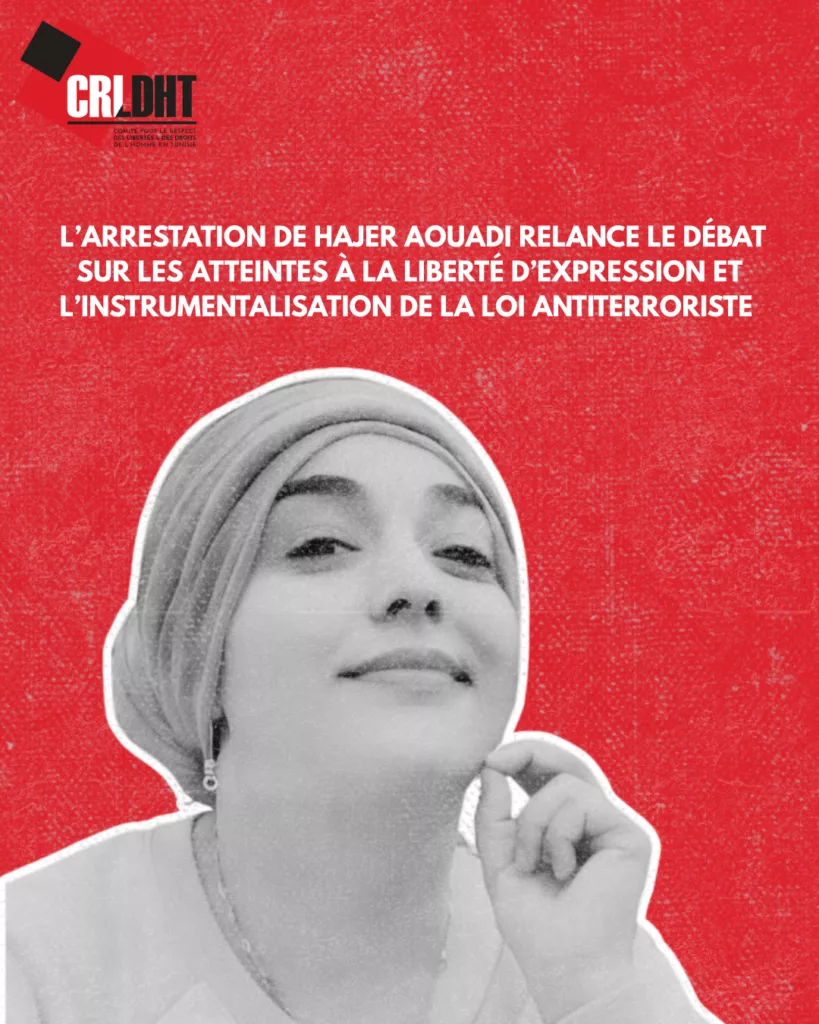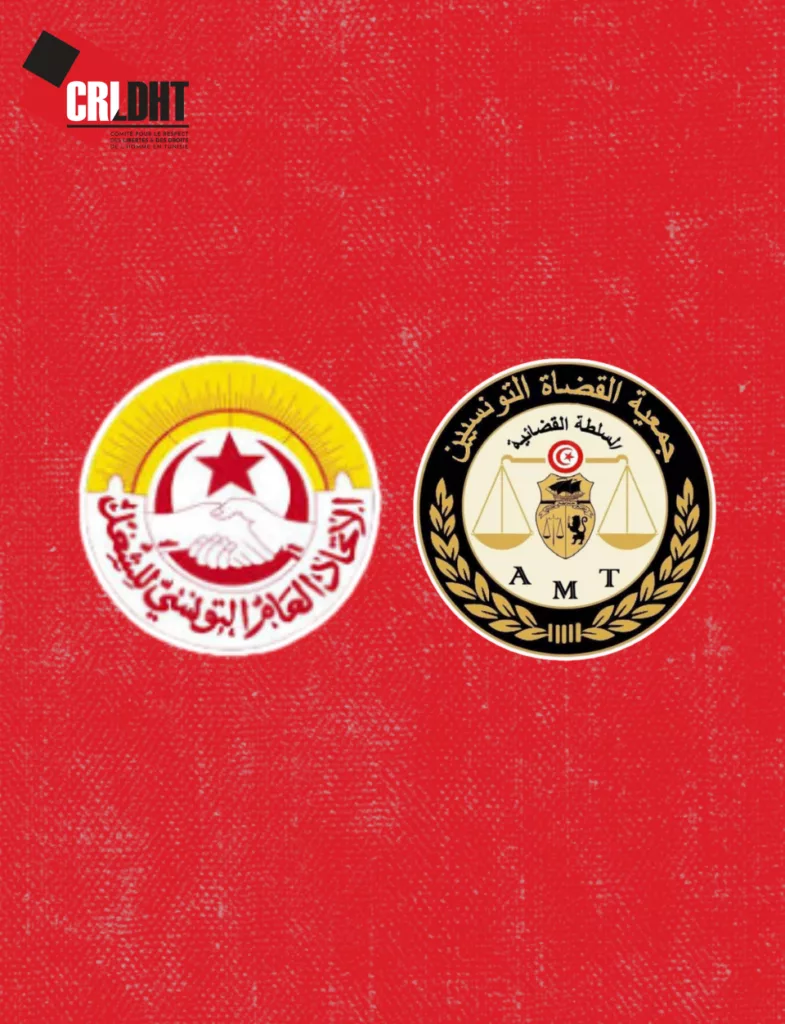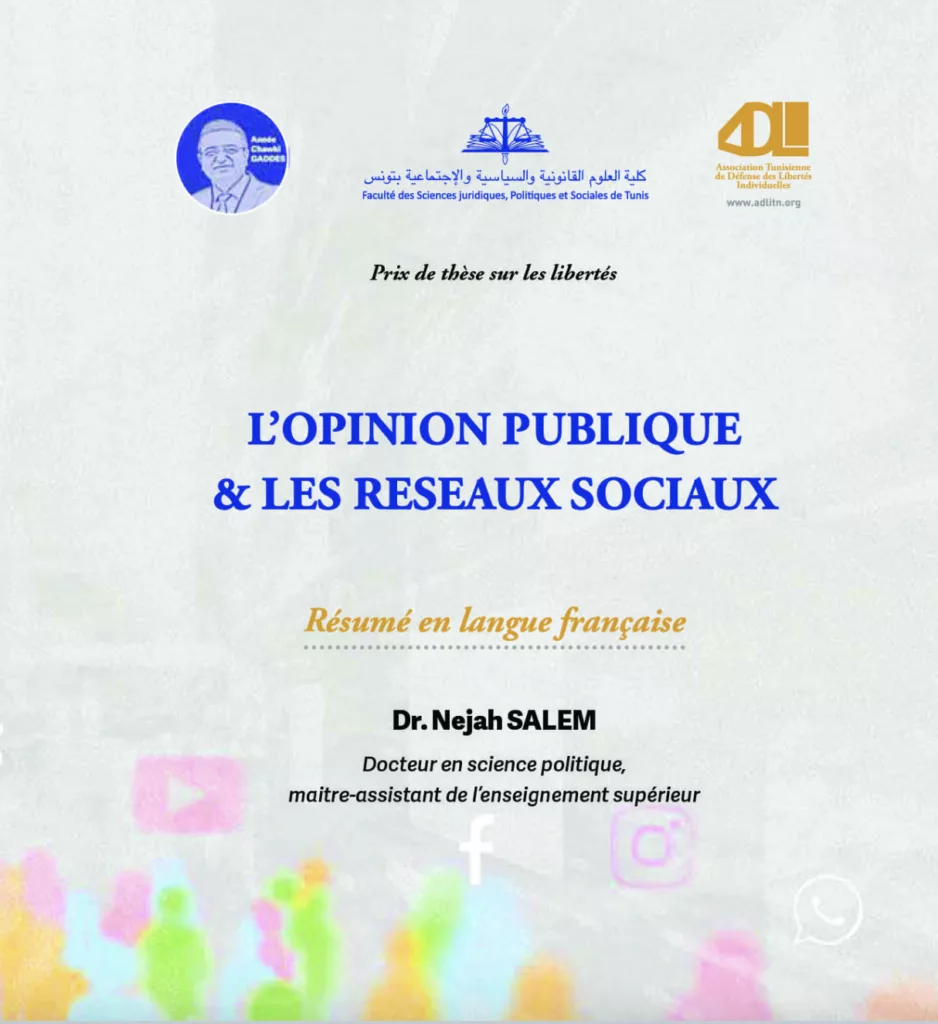Violence, structure discursive et solutions populistes
L’été et l’automne 2025 auront marqué un tournant dans la dynamique protestataire tunisienne. En trois mois seulement — juillet, août et septembre — 1 316 mouvements de protestation ont été recensés, soit près du double du nombre enregistré à la même période en 2023 et 2024.
Le mois de septembre, à lui seul, a connu 653 mobilisations, un record depuis le début de l’année.
Ces protestations ont pris des formes multiples, essentiellement de terrain (82 %) : sit-in, grèves, marches pacifiques, blocages de routes, grèves de la faim, jusqu’aux rassemblements devant le palais présidentiel. Les réseaux sociaux, eux, sont devenus l’autre espace de contestation : vidéos, photos et déclarations y dénoncent sans détour l’échec du modèle politique et économique imposé par Kaïs Saïed.
Sur le plan social, la mobilisation reste largement mixte : 1 164 actions communes, 129 portées par des hommes et 23 menées par des femmes.
Les causes d’une colère nationale
La vague protestataire s’explique par un enchevêtrement de facteurs politiques, sociaux et symboliques.
En septembre, plusieurs mobilisations ont coïncidé avec le départ de la flottille maghrébine et internationale de solidarité avec la Palestine, exigeant la libération des militants tunisiens arrêtés par l’armée israélienne. Dans le même temps, la confrontation entre le pouvoir et le mouvement syndical s’est intensifiée : l’UGTT a organisé une grande marche nationale le 21 août 2025, de la place Mohamed Ali à l’avenue Habib Bourguiba.
Ces protestations se déploient dans un climat où le régime de Kaïs Saïed poursuit sa politique de répression systématique des opposants politiques, des journalistes et des défenseur·es des droits humains. Le décret 54, devenu l’un des instruments centraux de cette répression, a déjà fait tomber de nombreuses voix, visibles ou invisibles.
Mais la racine du malaise tunisien est plus profonde.
La population fait face à un sentiment de désillusion et de trahison collective. Les politiques économiques et sociales du régime ont engendré précarité, chômage de masse, effondrement des services publics et aggravation de la pénurie d’eau. Les petits agriculteurs, les femmes et les enfants paient le prix fort d’une injustice environnementale et sociale devenue structurelle, symbole d’une idéologie populiste sans horizon.
À cela s’ajoute la fermeture du dernier exutoire : la migration.
La harga, ultime échappatoire, devient un mirage face au renforcement des dispositifs sécuritaires imposés par l’Europe. Cette politique conjointe a asphyxié les économies locales vivant du commerce transfrontalier — du côté libyen comme algérien. Même la contrebande de survie, jadis tolérée, est désormais criminalisée.
Dans ce contexte d’étouffement social, toutes les classes et régions du pays ont fini par converger vers une nouvelle séquence de luttes, cristallisée autour d’un symbole : la mobilisation de Gabès en octobre 2025.
Gabès : la colère populaire qui fissure la rhétorique populiste
Une étude menée à l’École nationale d’ingénieurs de Sfax a révélé que le phosphogypse, sous-produit de l’industrie chimique, contient des substances toxiques et radioactives. Selon la Commission européenne (2018), le complexe chimique tunisien déverse chaque année 5 millions de tonnes de ces déchets dans la Méditerranée, soit 40 000 m³ de rejets toxiques par jour.
Malgré ces données accablantes, le gouvernement a choisi le déni.
En retirant le phosphogypse de la liste des déchets dangereux, Kaïs Saïed a piétiné la science, méprisant les mobilisations écologistes et les alertes citoyennes. Ce choix illustre une logique extractiviste et rentière : exploitation sans vergogne des territoires (Gabès, Gafsa, Redeyef…) au profit d’entreprises liées à des intérêts transnationaux, pendant que les populations locales suffoquent dans la pollution et la misère.
L’étincelle de la révolte
Tout a basculé à Gabès le 10 octobre 2025, lorsqu’une fuite de gaz du complexe chimique a provoqué l’intoxication de plusieurs élèves au collège Chet Essalem. L’incident, loin d’être inédit, a agi comme le détonateur d’une colère accumulée.
Le 21 octobre, la ville s’est arrêtée : grève générale quasi totale, forte d’une mobilisation intergénérationnelle, syndicale et associative.
Les mouvements écologistes, présents depuis 2011, ont su transformer cette crise en moment fondateur de résistance collective.
La contre-offensive populiste
Face à cette mobilisation, le régime a réagi par le mépris et la peur.
Les médias alignés et les chroniqueurs pro-Saïed ont qualifié le mouvement de manipulé, financé de l’étranger, politisé.
Le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, est même allé jusqu’à évoquer à la télévision une “ingérence étrangère” et l’“implication de mineurs séduits par des forces externes”.
Parallèlement, la répression policière et judiciaire s’est intensifiée, cherchant à transformer une mobilisation citoyenne en simple “incident sécuritaire”.
Briser le mur de la peur
Mais cette fois, le récit officiel n’a pas tenu.
La mobilisation de Gabès a :
- Brisé la rhétorique de la peur et du complot utilisée pour disqualifier toute contestation ;
- Rétabli le courage civique, en rompant le silence imposé depuis le 25 juillet 2021 ;
- Rassemblé toutes les forces sociales, autour de l’UGTT régionale, pivot du mouvement ;
- Fait émerger un discours alternatif, fondé sur la raison, la justice et l’écologie ;
- Reçu un soutien citoyen et associatif massif, en Tunisie comme à l’étranger.
La veille de la grève, le Parlement a tenu une séance spéciale sur le dossier de Gabès, suivie d’une réunion entre Kaïs Saïed et sa cheffe de gouvernement, Sara Zaafrani.
Une nouvelle fois, le président a recyclé le même lexique populiste :
« réseaux corrompus », « comploteurs », « instrumentalisation de la souffrance ».
Aucune solution technique, politique ou écologique n’a été évoquée.
Une fissure dans le mur populiste
En s’attaquant frontalement au discours de la peur, la mobilisation de Gabès a ouvert une brèche dans le dispositif populiste de Kaïs Saïed.
Elle montre que la société tunisienne n’est pas résignée : malgré la répression, les blocages et la lassitude, le cycle protestataire continue, plus diffus, plus conscient, plus ancré.
De la rue de Gabès aux campagnes assoiffées, des usines fermées aux écoles saturées, la Tunisie gronde à nouveau — non pas pour un sauveur, mais pour reprendre la parole confisquée.