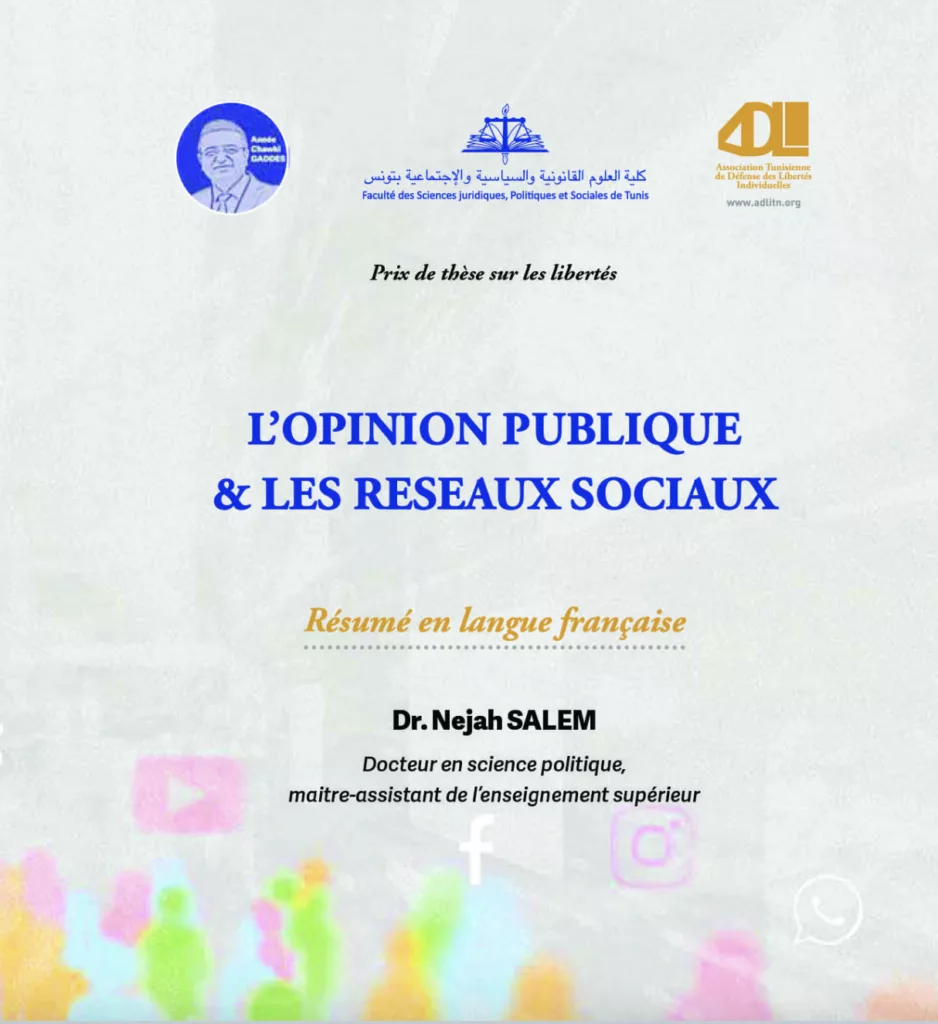Le communiqué publié par le ministère tunisien des Affaires étrangères le 10 décembre 2025, à l’occasion du 77ᵉ anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, relève d’un exercice désormais devenu suranné et anachronique. Le texte est parfaitement « exportable » : lexique universel, insistance sur l’indivisibilité des droits, promesse de justice sociale, références appuyées au multilatéralisme et à « l’État de droit international ». Il s’agit d’un message soigneusement calibré pour les chancelleries étrangères et les enceintes onusiennes.
Mais la même séquence politique — parfois les mêmes journées — raconte une tout autre réalité : procès politiques, détentions prolongées, criminalisation du travail associatif, intimidation de la presse, attaques répétées contre les avocats, entraves délibérées à la transparence. Autrement dit, la Tunisie parle le langage des droits humains à l’extérieur, tout en pratiquant la punition à l’intérieur.
Ce décalage n’est ni accidentel ni maladroit. Il constitue une véritable stratégie de double langage : un discours diplomatique policé destiné à masquer une réalité interne où l’appareil judiciaire et sécuritaire fonctionne comme un instrument de dissuasion par la peur.
Défendre le droit devient une faute : les cas d’ayachi Hammami et d’Ahmed Souab
Le symbole est sans détour. La condamnation et l’incarcération de l’avocat et défenseur des droits Ayachi Hammami, ainsi que les poursuites visant Ahmed Souab, autre figure du barreau et de la défense des libertés, ont suscité une réaction publique d’experts des Nations unies, qui se sont dits choqués par des décisions judiciaires explicitement liées à l’exercice du métier d’avocat, dans le cadre de l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État ».
Ces décisions s’inscrivent dans une séquence judiciaire marquée par des condamnations extrêmement lourdes. En appel, le 27 novembre 2025, trente-quatre accusés ont écopé de peines allant jusqu’à quarante-cinq ans de prison. Parmi les personnes condamnées figurent notamment : Jaouhar Ben Mbarek, Chaima Issa, Issam Chebbi , Ahmed Nejib Chebbi, Ridha Belhaj, Khayem Turki , Abdelhamid Jelassi, Kamel Letaief
À la suite de ces jugements, Chaima Issa, Ayachi Hammami et Ahmed Nejib Chebbi ont été arrêtés pour l’exécution de peines respectives de vingt ans, cinq ans et douze ans.
Le message implicite est limpide : le droit de défendre devient un risque pénal. Et lorsque l’acte de défense est assimilé à un « complot », c’est l’État de droit lui-même qui est renversé. On ne juge plus des faits, on punit des rôles — avocat, opposant, militant — dans un système où le discours juridique officiel, invoquant les garanties et les principes fondamentaux, apparaît désormais suranné et anachronique, vidé de toute portée réelle.
La parole comme infraction : le décret-loi 54 et la répression de la presse
La liberté d’expression n’est plus simplement restreinte : elle est désormais traitée comme un champ pénal. L’usage extensif de textes répressifs, au premier rang desquels le décret-loi 54, a permis, entre 2023 et 2025, de multiplier poursuites et condamnations visant journalistes, chroniqueurs et commentateurs de l’actualité.
La journaliste Chadha Hadj Mbarek a ainsi été condamnée à une lourde peine de prison dans une affaire devenue emblématique de la pression judiciaire exercée sur la presse. De même, des figures médiatiques et politiques comme Sonia Dahmani, Borhane Bsaies, Mohamed Boughaleb et Mourad Zghidi ont été poursuivies et condamnées pour leurs prises de position publiques, confirmant un schéma désormais récurrent : l’opinion est assimilée à une infraction et le commentaire politique devient un terrain de sanction.
Ce basculement atteint un seuil particulièrement préoccupant lorsque l’expression en ligne est requalifiée en atteinte à la sûreté de l’État, exposant des citoyens à des poursuites d’une extrême gravité pour de simples publications sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, la parole publique n’est plus un droit protégé, mais un risque pénal permanent.
Quand la parole est ainsi requalifiée en menace pour l’État, la société entière apprend à se taire.
La politique requalifiée de « crime majeur »
La condamnation d’Abir Moussi à douze ans de prison, le 12 décembre 2025, à la suite d’une simple démarche administrative et d’une contestation politique, a constitué un cas emblématique de disproportion et un jalon supplémentaire dans le glissement vers un pénal d’exception appliqué à l’action politique. Cette logique a atteint un seuil inédit lors de l’élection présidentielle de 2024 où la compétition électorale elle-même a été judiciarisée.
Plusieurs candidats déclarés ou potentiels à la magistrature suprême — parmi lesquels Zammel, Abdelatif Mraihi, Mondher Zenaidi et d’autres — ont été poursuivis, condamnés ou écartés par des décisions administratives et judiciaires controversées. Dans ce contexte, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), recomposée par le pouvoir exécutif, a systématiquement invalidé ou refusé des candidatures sérieuses, allant jusqu’à ignorer ou contourner des décisions du Tribunal administratif, pourtant juridiction suprême en matière électorale. Ce contournement du juge a transformé le processus électoral en mécanisme d’exclusion politique, où se porter candidat, contester les conditions du scrutin ou obtenir une décision judiciaire favorable devient un facteur aggravant sur le plan pénal ou administratif.
Dans ce contexte précisément, la répression visant les islamistes s’inscrit dans une stratégie globale de démantèlement du pluralisme politique. Depuis 2021, dirigeants et militants d’Ennahdha, ainsi que d’anciens responsables de l’État issus de ce courant, sont la cible d’une offensive judiciaire systématique, fondée sur la criminalisation de l’activité politique, l’usage extensif de qualifications liées à la sûreté de l’État et la négation répétée des garanties du procès équitable.
L’incarcération de Rached Ghannouchi, en dépit de son âge avancé et du caractère exclusivement politique de ses prises de position, vise à signifier la fin de toute légitimité acquise par la participation démocratique passée. De même, la condamnation d’Ali Laârayedh à trente-quatre ans de prison illustre un basculement particulièrement grave : gouverner devient un crime a posteriori, sur la base d’une lecture rétrospective, idéologique et punitive de l’action publique.
Ainsi, du filtrage des candidatures présidentielles à l’emprisonnement des responsables ayant gouverné par les urnes, une même logique est à l’œuvre : le droit pénal et l’administration électorale sont mobilisés pour refermer l’espace politique, neutraliser toute alternative crédible et vider de sa substance le principe même de souveraineté populaire.
Le travail associatif et humanitaire criminalisé
La même logique répressive s’applique désormais de manière systématique au champ associatif et humanitaire, perçu et traité comme une zone de délinquance potentielle, plutôt que comme un espace de solidarité ou de soutien aux droits fondamentaux. Les autorités tunisiennes ont multiplié les mesures administratives et judiciaires visant à étouffer la société civile : suspension d’associations reconnues, gel d’activités et de comptes, enquêtes financières et restrictions bancaires, créant ainsi un climat d’intimidation généralisé qui entrave l’existence même des organisations indépendantes. Entre juillet et novembre 2025, des centaines d’associations dont l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), Aswat Nissa, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Nawaat et la branche tunisienne de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), ont vu leurs activités suspendues pour des périodes allant jusqu’à trente jours, souvent sans avertissement préalable ou en dépit des corrections apportées aux observations administratives.
Sur le plan judiciaire, le procès de Terre d’Asile Tunisie, branche tunisienne de l’ONG française France Terre d’asile, est emblématique de cette escalade. Des membres de son personnel — Chérifa Riahi (ancienne directrice), Yadh Bousselmi (directeur) et Mohamed Joo (responsable administratif et financier) — ainsi que d’anciens employés municipaux partenaires, sont poursuivis depuis mai 2024 pour avoir fourni une aide essentielle à des réfugiés et migrants, et trois d’entre eux se trouvent en détention provisoire arbitraire depuis près de deux ans.
La poursuite et le maintien en détention de Saadia Mosbah, militante antiraciste et présidente de l’association M’nemti, marquent un tournant particulièrement grave : c’est désormais la lutte contre les discriminations et le racisme qui est assimilée à une infraction pénale. À travers M’nemti, c’est tout un travail de terrain en faveur de l’égalité, de la dignité et de la cohésion sociale qui se trouve placé sous suspicion.
Dans une société déjà fragilisée socialement et économiquement, cette offensive contre le tissu associatif revient à assécher les derniers mécanismes de protection des populations vulnérables, à démanteler les espaces de médiation citoyenne et à intimider l’ensemble de l’écosystème associatif. Elle confirme que la répression en Tunisie ne vise pas seulement la parole politique ou l’opposition partisane, mais toute forme d’action collective autonome, y compris humanitaire, sociale et antiraciste.
Parallèlement encore, d’autres organisations de défense des droits humains font face à des enquêtes pénales ou financières injustifiées, à des gels de comptes, à des difficultés bancaires persistantes, et à un harcèlement administratif constant visant à entraver leurs activités fondamentales, notamment dans les domaines de la migration, de l’égalité et des droits sociaux.
Le signal envoyé par l’ensemble de ces mesures est redoutable : solidarité égale suspicion, et toute initiative associant action humanitaire, défense des droits ou mobilisation citoyenne se retrouve exposée à des poursuites pénales, à des blocages administratifs ou à des sanctions financières. Dans une société déjà fragilisée, cela revient à assécher les derniers mécanismes de protection pour les plus vulnérables, à démanteler l’écosystème associatif et à intimider l’ensemble de la société civile, réduisant à néant les espaces d’expression, de soutien et de solidarité qui on
Transparence et contrôle citoyen : la fermeture des garde-fous
Le discours officiel continue d’invoquer, de manière incantatoire, la référence à l’« État de droit ». Mais derrière cette rhétorique, ce sont précisément les mécanismes de contrôle, de transparence et de redevabilité qui sont méthodiquement affaiblis, voire démantelés. Loin de renforcer l’État de droit, le pouvoir s’emploie à désactiver les contre-pouvoirs capables d’examiner, de documenter et de contester l’action publique.
La dissolution, en août 2025, de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), pilier institutionnel de la transparence instauré après 2011, illustre de manière exemplaire cette dérive. Cette instance ne constituait pas un simple organe technique : elle incarnait un droit fondamental, celui des citoyens, des journalistes et de la société civile à accéder à l’information publique, à interroger les décisions de l’administration et à exiger des comptes. Sa disparition marque un recul structurel de la redevabilité publique et une rupture assumée avec les principes de transparence issus du processus démocratique post-révolutionnaire.
Car fermer les canaux de l’information, ce n’est pas seulement réduire la circulation des données administratives ; c’est empêcher la preuve, entraver la documentation des abus, et rendre impossible tout contrôle effectif de l’action de l’État. Sans accès à l’information, il n’y a ni responsabilité, ni débat éclairé, ni capacité de contestation fondée sur des faits.
La démocratie ne s’éteint pas uniquement par des procès iniques ou des condamnations spectaculaires. Elle s’érode aussi, plus silencieusement, par l’opacité organisée, par la neutralisation des outils de contrôle et par la transformation de l’administration en zone fermée, inaccessible au regard citoyen. En s’attaquant à la transparence, le pouvoir ne se contente pas de gouverner sans contrôle : il organise l’impossibilité même de toute reddition de comptes, condition pourtant essentielle de tout État de droit réel.
Les prisons comme zones fermées : l’entrave à l’observation indépendante
La question carcérale concentre aujourd’hui l’ensemble des dérives du pouvoir. C’est dans les prisons que se retrouvent opposants politiques, journalistes, avocats, militants associatifs et défenseurs des droits humains. C’est donc aussi là que l’État cherche le plus activement à réduire les regards extérieurs, à limiter l’observation indépendante et à refermer l’espace de contrôle.
Depuis des décennies, la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) joue pourtant un rôle central dans la surveillance des lieux de détention, la documentation des violations, l’alerte sur les conditions carcérales et la défense des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Cette mission s’inscrit dans une tradition ancienne, reconnue, et constitue l’un des rares mécanismes non étatiques de protection contre les abus, les mauvais traitements et l’arbitraire pénitentiaire.
Or, en décembre 2025, la controverse autour des visites de prisons par la LTDH a mis en lumière une évolution préoccupante. À la suite d’échanges publics entre le ministère de la Justice et la Ligue, il est apparu que l’accès de cette organisation indépendante aux établissements pénitentiaires était restreint, retardé, conditionné ou purement refusé, sous couvert de justifications administratives, sécuritaires ou procédurales. Cette situation ne relève pas d’un simple différend technique : elle traduit une volonté politique de limiter le contrôle citoyen sur l’un des espaces les plus sensibles de l’action de l’État.
Refuser ou entraver les visites de la LTDH dans les prisons, ce n’est pas seulement bloquer une organisation ; c’est organiser l’opacité carcérale. C’est priver les détenus d’un relais indépendant, empêcher la documentation des conditions de détention, rendre invisibles les pratiques abusives et affaiblir les garanties minimales contre la torture, les mauvais traitements et les violations de la dignité humaine. Dans un contexte de multiplication des détentions politiques et des poursuites arbitraires, cette fermeture des prisons au regard indépendant prend une signification particulièrement grave.
Au-delà des prisons elles-mêmes, ce refus d’accès s’inscrit dans une logique plus large : la neutralisation des contre-pouvoirs et des mécanismes de contrôle issus de la société civile. Là où la transparence devrait être renforcée, le pouvoir choisit le repli, là où la vigilance est indispensable, il impose le silence..
L’outil silencieux ; interdictions de voyage et harcèlement diffus
À côté des arrestations spectaculaires et des procès politiques, le pouvoir recourt à des formes de répression plus discrètes, moins visibles médiatiquement, mais redoutablement efficaces. Il s’agit de restrictions de mouvement, d’interdictions de voyage, de pressions administratives multiples et de mesures coercitives appliquées sans décision judiciaire claire, sans notification formelle et sans possibilité réelle de recours.
Ces interdictions, souvent découvertes au dernier moment à un poste-frontière ou dans un aéroport, fonctionnent comme des sanctions informelles. Elles ne reposent pas sur une condamnation, ni même sur une inculpation, mais sur un soupçon, une inscription administrative ou une instruction opaque. Le droit de circuler librement, pourtant fondamental, devient ainsi conditionnel et révocable, soumis à l’arbitraire de l’appareil sécuritaire.
Ce mode opératoire permet de punir sans juger, de restreindre sans assumer publiquement la répression, et de contourner les garanties procédurales. Il vise en particulier les opposants politiques, les défenseurs des droits humains, les journalistes, les avocats et les militants associatifs, entravant leur capacité à se déplacer, à participer à des rencontres internationales, à témoigner, à plaider ou simplement à mener une vie professionnelle normale.
L’effet recherché n’est pas seulement individuel. Ces mesures produisent une usure lente et profonde, qui touche aussi les familles, fragilise les situations économiques, isole socialement et érode la capacité d’organisation collective. Elles installent une pression permanente, faite d’incertitude et de peur diffuse, où chacun comprend que l’arbitraire peut s’abattre à tout moment, sans justification ni échéance.
Cette technique est éprouvée : elle ne crée pas de martyrs visibles, n’appelle pas de grandes audiences judiciaires, mais neutralise durablement les acteurs critiques, en les immobilisant, en les épuisant et en les dissuadant d’agir. Elle complète ainsi les poursuites pénales et les détentions arbitraires par un arsenal de contraintes silencieuses, qui transforment la vie quotidienne en espace de surveillance.
En recourant massivement à ces interdictions et à ce harcèlement diffus, le pouvoir ne se contente pas de restreindre des libertés : il normalise l’arbitraire, installe une culture de la sanction sans droit et rappelle que, dans ce système, l’absence de procès n’est pas synonyme d’absence de punition.
La répression des hommes d’affaires : le secteur privé sous soupçon permanent sous couvert de lutte contre la corruption
La répression exercée par le pouvoir tunisien s’est progressivement étendue au champ économique, visant des hommes d’affaires dont le point commun n’est ni l’existence d’une infraction établie ni une condamnation définitive, mais une indépendance financière, relationnelle ou politique perçue comme incompatible avec l’exigence d’allégeance. Cette offensive est systématiquement habillée du discours officiel de la “lutte contre la corruption”, érigée en justification morale et politique globale, au point de devenir un prétexte commode pour la judiciarisation arbitraire de l’activité économique.
Dans les faits, cette rhétorique anticorruption sert moins à assainir la vie publique qu’à neutraliser des acteurs économiques jugés trop autonomes, en contournant les exigences élémentaires de légalité, de preuve et de proportionnalité. Des figures déjà documentées — telles que Kamel Eltaïef, Mehdi Ben Gharbia, Ridha Charfeddine ou Zammel — ont ainsi été arrêtées, poursuivies ou maintenues sous pression judiciaire dans des conditions soulevant de graves questions de droit : recours extensif et prolongé à la détention préventive, renouvellements successifs sans motivation individualisée, confusion volontaire entre responsabilité pénale et soupçon politique, et usage de qualifications pénales larges, extensibles et indéterminées (corruption, blanchiment, atteinte à la sûreté de l’État).
Dans plusieurs de ces dossiers, la détention préventive a cessé d’être une mesure exceptionnelle de garantie procédurale pour devenir une peine anticipée, en violation manifeste de la présomption d’innocence et des principes de nécessité et de proportionnalité consacrés par le droit interne comme par les engagements internationaux de la Tunisie. À cette dérive s’ajoute un mécanisme particulièrement révélateur de l’instrumentalisation de la justice : l’usage abusif des cautions financières, présentées comme des mesures techniques mais utilisées, dans la pratique, comme outils de pression et de ponction économique.
Ces cautions sont fréquemment fixées à des montants exorbitants, sans lien raisonnable avec les faits reprochés ni avec la capacité contributive des personnes concernées, et sans motivation juridique individualisée. Sous couvert de prévention de la corruption ou de garantie de représentation, elles fonctionnent comme une contrepartie financière imposée à la liberté provisoire, assimilable à une forme d’extorsion institutionnelle : payer pour sortir, ou rester détenu. La lutte proclamée contre la corruption se transforme ainsi en marchandisation de la liberté, profondément incompatible avec l’État de droit.
L’absence de proportion entre les faits allégués — lorsqu’ils sont établis —, la sévérité des mesures privatives de liberté et le niveau des garanties financières exigées révèle une judiciarisation punitive de l’économie, où l’enquête sert moins à établir la vérité qu’à affaiblir durablement des acteurs économiques indépendants, à fragiliser leurs entreprises et à dissuader toute autonomie future.
Ce basculement est encore confirmé par l’intégration d’hommes d’affaires dans l’affaire dite du « complot contre la sûreté de l’État », où des relations professionnelles, des échanges privés ou de simples capacités de financement sont requalifiés en indices de subversion. Le droit pénal y perd sa fonction première de lutte contre la criminalité économique pour devenir un instrument de gestion politique des rapports de force, dans lequel la lutte contre la corruption n’est plus une politique publique, mais un alibi répressif.
Le 10 décembre, en Tunisie : un test de vérité
C’est ici que la vitrine du 10 décembre se fissure définitivement.
Un État qui tolère la détention arbitraire, banalise l’abus de la détention préventive et vide le principe de proportionnalité de sa substance ne commémore pas les droits humains : il en organise la neutralisation. Et lorsqu’un pouvoir frappe simultanément journalistes, avocats, militants, islamistes, opposants laïcs et désormais hommes d’affaires, ce n’est pas la sécurité qu’il cherche à garantir, mais la fermeture totale de l’espace social, politique et économique.
Le 10 décembre, en Tunisie, n’est plus une célébration universelle : c’est une ligne de partage.
D’un côté, un discours diplomatique exportable ; de l’autre, un droit pénal domestiqué, utilisé pour rappeler une vérité simple et brutale : il n’y a plus de place pour l’autonomie — quelle qu’en soit la forme — dans un régime qui ne reconnaît que l’obéissance.
Le communiqué du ministère des Affaires étrangères s’adresse à l’extérieur ; la machine pénale et sécuritaire opère à l’intérieur. Les deux coexistent parce qu’ils poursuivent la même finalité : acheter une respectabilité internationale tout en neutralisant, sur le plan interne, celles et ceux qui incarnent les droits.
C’est précisément pour cela que la résistance — mobilisations, communiqués, coalitions, solidarités entre familles, avocats, journalistes et associations — demeure aujourd’hui le dernier espace où survit une idée simple : les droits humains ne sont pas une langue diplomatique. Ils sont des protections concrètes, ou ils ne sont rien.
C’est pour cela que le discours du 10 décembre sonne creux :
un État qui emprisonne des opposants de toutes sensibilités, y compris ceux qui ont gouverné par les urnes, ne protège pas les droits humains — il les viole.