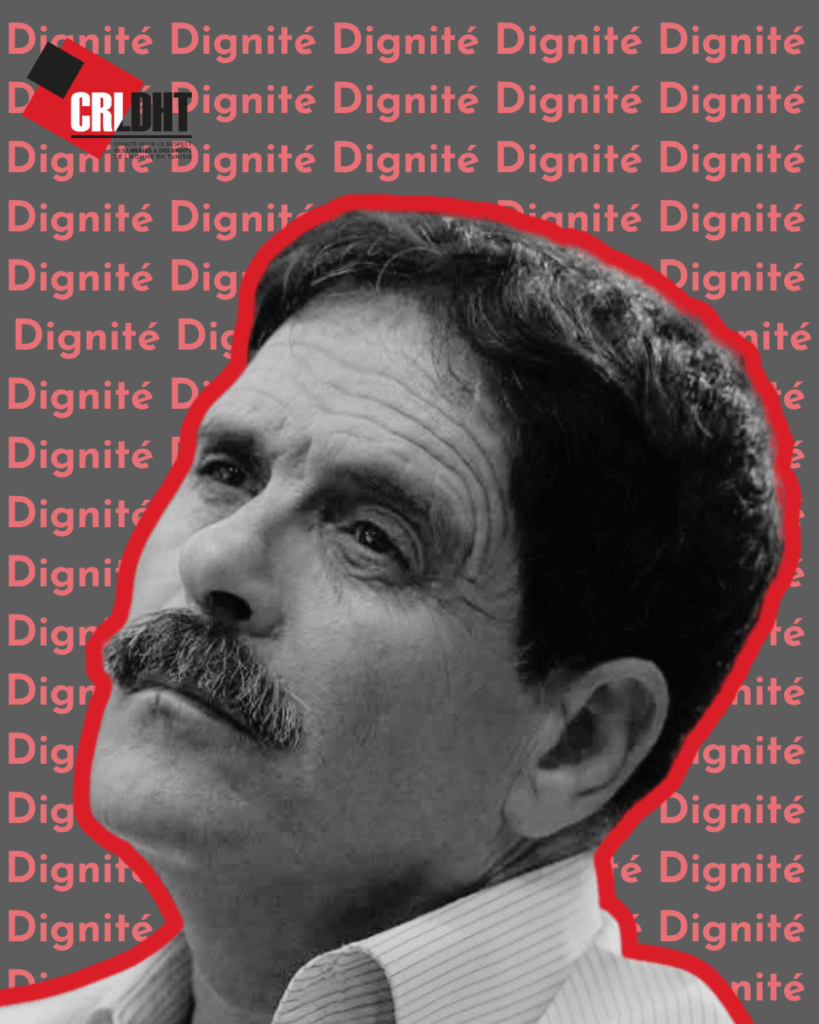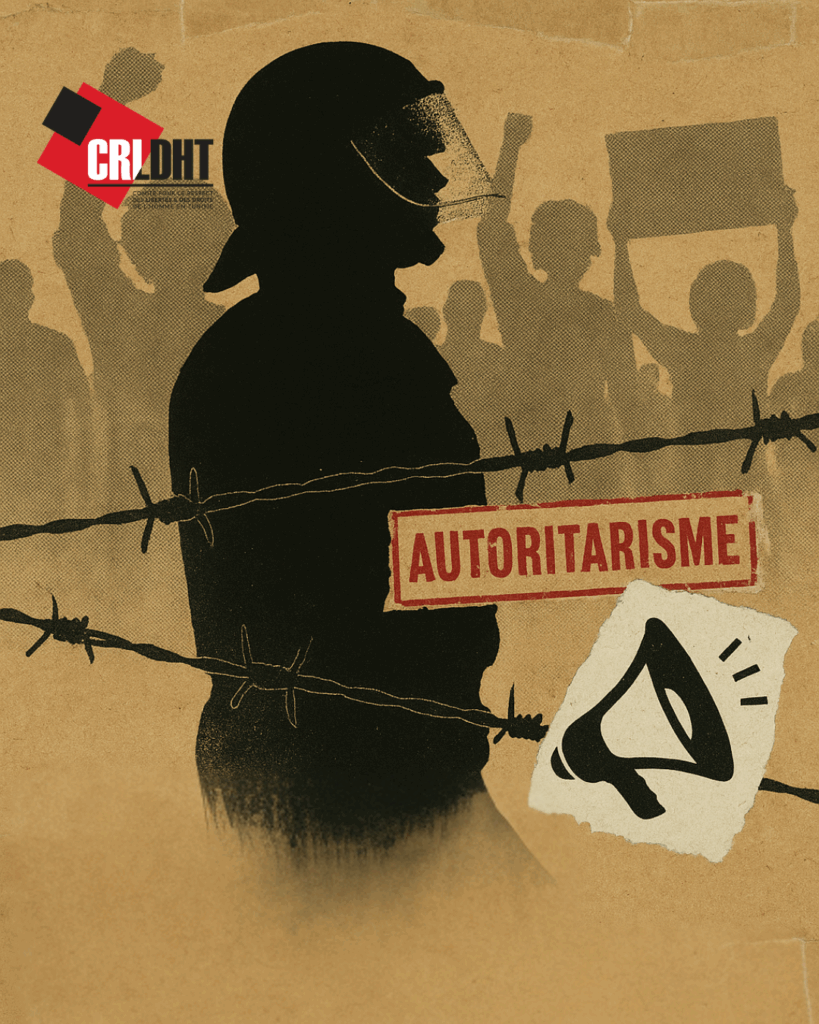Organisée dans un contexte d’asphyxie économique et de dérive autoritaire, la conférence Liqaet du 9 avril a réuni deux politistes, Hamza Meddeb et Michaël Ayari, autour de la crise budgétaire et de l’explosion de la dette publique en Tunisie. La discussion a visé à décrypter les ressorts économiques, politiques et sociaux de la crise actuelle, tout en interrogeant la gouvernance du président Kaïs Saied et la capacité de l’État tunisien à se réformer. Deux questions centrales ont structuré l’échange : comment expliquer la montée des difficultés économiques ? Et la Tunisie est-elle réformable face à ses impasses structurelles ?
Il ne s’agit pas seulement d’économie, mais de démocratie, de souveraineté populaire et de justice sociale. Les choix économiques opérés par les autorités actuelles, notamment Kaïs Saied, ne sont pas neutres. Ils reflètent une vision du monde – autoritaire, opaque, centralisée – et trahissent un mépris inquiétant des droits fondamentaux.
Quand la dette publique devient une arme politique contre le peuple
Hamza Meddeb rappelle que la dette n’est pas un mal en soi : elle est un instrument politique. Ce qui compte, c’est l’usage qu’on en fait. Endetter un pays pour construire des hôpitaux, renforcer l’éducation publique ou assurer la souveraineté alimentaire est un choix radicalement différent de l’endetter pour rembourser des créanciers privilégiés ou maintenir un régime en place. La dette est un choix de société, et aujourd’hui, ce choix est celui de la régression sociale, de la destruction des services publics et de la précarisation des plus pauvres.
Il est revenu sur l’évolution historique du modèle économique tunisien, marqué par un essoufflement à partir des années 2000. Après une période de croissance modérée dans les années 70, puis une embellie dans les années 90 (discours du « miracle économique »), les années 2000 ont été celles de la stagnation. La décennie 2010 a été marquée par une succession de chocs (terrorisme, Covid-19, guerre en Ukraine), aggravant les vulnérabilités structurelles : désindustrialisation, effondrement du tourisme, déclin de la production énergétique et chute des investissements publics comme privés.
Aujourd’hui, le pays s’enfonce dans une impasse. La croissance potentielle est extrêmement faible (1 % d’ici 2029), l’investissement s’effondre (11,2 % du PIB en 2024), et l’endettement explose. La dette publique centrale atteint 84 % du PIB, et la dette intérieure dépasse les 70 milliards de dinars. Le recours massif à la dette domestique reflète l’isolement financier international du pays, aggravé par l’échec des négociations avec le FMI.
Le capitalisme de connivence et la financiarisation du pouvoir
Meddeb a également souligné le rôle dysfonctionnel du système bancaire tunisien, où trois banques publiques soutiennent principalement des entreprises publiques déficitaires. Le secteur privé est dominé par quelques holdings familiaux, qui concentrent l’essentiel des flux économiques, contrôlent plusieurs banques, et profitent d’un accès privilégié au crédit. Plutôt que d’investir dans l’économie réelle, ces groupes préfèrent acheter de la dette publique, devenant les principaux créanciers d’un État qu’ils n’ont aucun intérêt à réformer. Ainsi depuis 2021, l’État tunisien, coupé du financement international et sans stratégie économique claire, s’endette auprès d’acteurs privés nationaux.
Cette financiarisation du pouvoir creuse un cercle vicieux : l’État s’endette pour contenir les effets sociaux de la crise (inflation, baisse des salaires réels, dégradation des services publics), tout en étranglant le secteur privé, ce qui freine toute relance économique.
Kaïs Saied et l’économie sans cap
Sous couvert de souverainisme, Kaïs Saied impose une vision autoritaire et technocratique du pouvoir, sans offrir la moindre alternative crédible. Il refuse les réformes, rejette les partenariats internationaux, mais ne propose aucune stratégie économique concrète.
En refusant le FMI sans proposer d’alternative crédible, il isole davantage la Tunisie tout en accentuant sa dépendance aux créanciers internes. Ce « souverainisme sans souveraineté » condamne le pays à l’isolement politique, incapable de financer son avenir, et voit croître un populisme qui nourrit la défiance.
La Tunisie, un État irréformable ?
Michaël Ayari a interrogé plus frontalement la question de la réformabilité de l’État tunisien. Si le régime a changé après 2011, l’État lui-même – ses structures, sa culture administrative, son rapport au droit – est resté figé. La bureaucratie verrouille toute tentative de décentralisation ou de participation citoyenne réelle. Le régime actuel n’est pas autoritaire au sens classique, mais fonctionne dans une logique de désinstitutionnalisation, affaiblissant encore la capacité de l’État à agir.
Le droit tunisien est instrumentalisé, utilisé pour faire taire, punir, bloquer, plutôt que pour garantir les libertés. Il entretient une insécurité juridique qui freine tout développement. L’ultra-centralisation, la bureaucratie lourde, et la persistance du clientélisme empêchent toute réforme d’émerger. Dans ce contexte, la gouvernance repose davantage sur la logique du contrôle que sur la production de biens publics.
Ayari critique une vision mercantiliste et rentière de l’économie, sans rupture avec les logiques d’exclusion régionale, d’endettement opaque et d’économie de rente. Il note l’absence d’un discours souverainiste cohérent et crédible, alors même que les besoins en matière de sécurité alimentaire, énergétique et sociale n’ont jamais été aussi pressants.
Conclusion : quelles alternatives ?
La conférence a mis en lumière l’ampleur de la crise économique tunisienne, mais aussi la nécessité de penser des alternatives qui soient à la fois durables et respectueuses des droits humains. Sortir de l’impasse actuelle implique non seulement une réforme structurelle de l’État, mais aussi un changement profond des priorités économiques, rompant avec les logiques de rente et de dépendance. Cela suppose de réorienter la dette vers des investissements utiles, de repenser les rapports entre État et citoyens, et de redonner du sens à la souveraineté économique dans une optique de justice sociale.