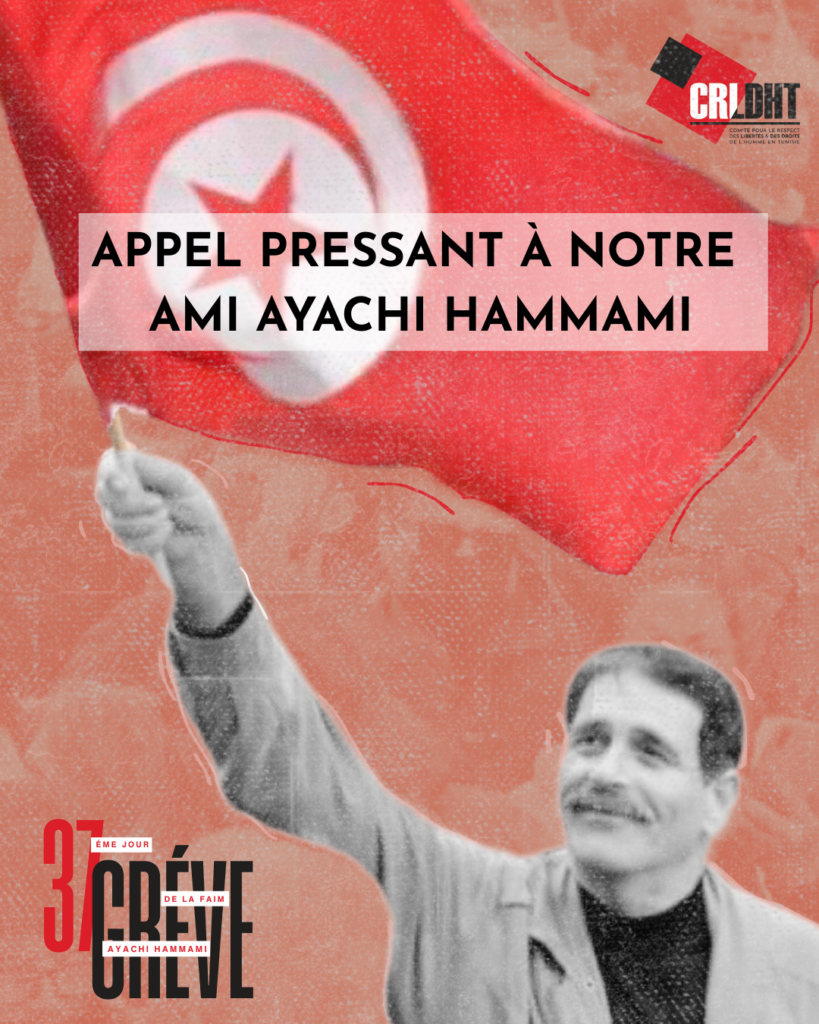Introduction
En mai 2024, Mustapha Jemmali, militant humanitaire tunisien et président du Conseil tunisien pour les réfugiés, est arrêté et inculpé pour des faits liés à l’assistance notamment l’hébergement de migrants subsahariens. Son interpellation, dans un contexte de répression croissante contre les défenseurs des droits humains, symbolise la criminalisation systématique de la solidarité en Tunisie depuis la dérive autoritaire enclenchée par le président Kaïs Saïd.
Un engagement au service des droits humains
Juriste de formation, Mustapha Jemmali est diplômé de l’Université de la Sorbonne à Paris. Il a dédié plus de deux décennies de sa vie professionnelle à la protection des réfugiés au sein des Nations unies. Officiel international du HCR pendant 24 ans, il y a occupé plusieurs fonctions de responsabilité à travers le monde, avant de devenir Directeur du Bureau pour l’Asie centrale, l’Asie du Sud-Ouest, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord jusqu’en 2004. Il a également été conseiller spécial du Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés.
Après avoir quitté les Nations unies, il poursuit son engagement en tant que Représentant régional pour le Maghreb du Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD). En 2016, il fonde le Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR), qu’il dirige depuis, avec pour mission de garantir protection, dignité et droits aux personnes exilées en Tunisie.
… devenu un délit…
Mustapha Jemmali est connu pour son action en faveur des personnes exilées, en particulier les réfugiés et demandeurs d’asile abandonnés aux marges de la société tunisienne. Son ONG fournissait un soutien vital : hébergement, accompagnement juridique, accès aux soins, soutien psychologique. C’est justement cette mission humanitaire qui lui a valu, le 3 mai 2024, une mise en détention préventive sur ordre du parquet, sous l’accusation de “constitution d’une entente pour faciliter l’entrée irrégulère de migrants en Tunisie”.
Selon les autorités tunisiennes, l’arrestation serait liée à la publication d’un appel d’offres par l’association pour la location d’une auberge au profit de demandeurs d’asile. Ce prétexte qui prouve que l’action associative était dans la légalité et la transparence (administratif) masque mal (la réalité ) la volonté manifeste de faire taire une voix dérangeante dans un pays où la défense des migrants est assimilée à une forme de subversion politique.
… dans un contexte de répression systémique
Depuis 2021, et plus particulièrement depuis le discours xénophobe prononcé par le président Kaïs Saïd en février 2023, la Tunisie est entrée dans une phase de répression systémique à l’égard des migrants subsahariens et de celles et ceux qui leur viennent en aide. Rafles, expulsions massives vers le désert libyen, agressions racistes et violences policières se sont multipliées, créant une situation humanitaire désastreuse, condamnée par les Nations unies, l’Union européenne et de nombreuses ONG internationales.
Mais au lieu d’entendre ces alertes, le pouvoir tunisien a renforcé la répression. Des figures de la société civile comme Saadia Mosbah, Abdallah Saïd, Mustapha Jemmali ou Cherifa Riahi ont été arrêtées. Certaines associations ont été contraintes à fermer.
Un double discours officiel à visée diplomatique
Parallèlement à cette politique de terreur, l’État tunisien continue de vanter, dans ses rapports aux instances internationales, son engagement pour les droits humains et sa coopération avec la société civile. Dans une communication officielle adressée aux Nations unies (HRC/NONE/2025/SP/3), les autorités prétendent que Mustapha Jemmali a bénéficié de toutes les garanties juridiques, et que son arrestation repose sur des faits dûment établis. Cette ligne de défense, purement formelle, occulte le contexte politique de répression et les objectifs de dissuasion envers les activistes.
Le silence complice de l’Union européenne
Ce climat liberticide est alimenté par le soutien inconditionnel de l’Union européenne, qui a versé à la Tunisie plus de 150 millions d’euros dans le cadre d’accords migratoires. Un rapport accablant, State Trafficking, a pourtant démontré que ces fonds ont servi à financer des expériences de “chasses aux migrants”, de déportations collectives vers la Libye, et même de ventes de migrants à des milices libyennes. Dans ce système, les ONG sont perçues comme des empêcheurs de tourner en rond.
Conclusion : la solidarité en procès
Mustapha Jemmali ne devrait pas être en prison. Il devrait être protégé, soutenu, reconnu pour son engagement. Son incarcération n’est pas un accident judiciaire, mais l’expression d’une stratégie politique de terreur visant à désarmer la solidarité.
Le juge d’instruction a refusé à maintes reprises sa libération provisoire, malgré son âge (plus de 80 ans), son état de santé (maladies chroniques) nécessitant des traitements médicaux appropriés que l’administration carcérale ne peut lui assurer, et le fait qu’il ne présente aucun danger pour la société.
Considérant l’absence d’éléments factuels à charge dans son dossier, on est amené à croire qu’il est réprimé pour l’ensemble de son œuvre humanitaire et pour sa carrière onusienne, qui font de lui une proie de choix pour un régime qui se vante de harceler les militants des droits de l’homme.
Rien d’autre qu’un acharnement inhumain ne peut expliquer que M. Jemmali soit privé de liberté, alors que l’expertise et l’ensemble du dossier attestent qu’aucune infraction ne peut raisonnablement lui être imputée. En revanche, il est privé de médicaments et de traitements adaptés à son état de santé, qui se dégrade notamment en raison de la torture morale qu’il subit. On lui a ainsi refusé des lunettes pour l’empêcher de lire.
Le juge d’instruction en charge du dossier persiste à refuser toute demande de libération provisoire et n’hésite pas à le menacer par des propos xénophobes et racistes, comme ce fut le cas le 25 mars 2025, afin d’accroître son supplice moral.
L’ajournement, non motivé, de l’audience de confrontation au 7 avril 2025 constitue une nouvelle manifestation de cet acharnement inouï contre les activistes des droits de l’homme.
Il est temps pour la communauté internationale d’exiger sa libération, de suspendre les aides qui alimentent la répression, et de reconnaître que ce qui se joue en Tunisie ne relève pas seulement du droit des étrangers, mais bien d’un combat universel pour la dignité humaine.