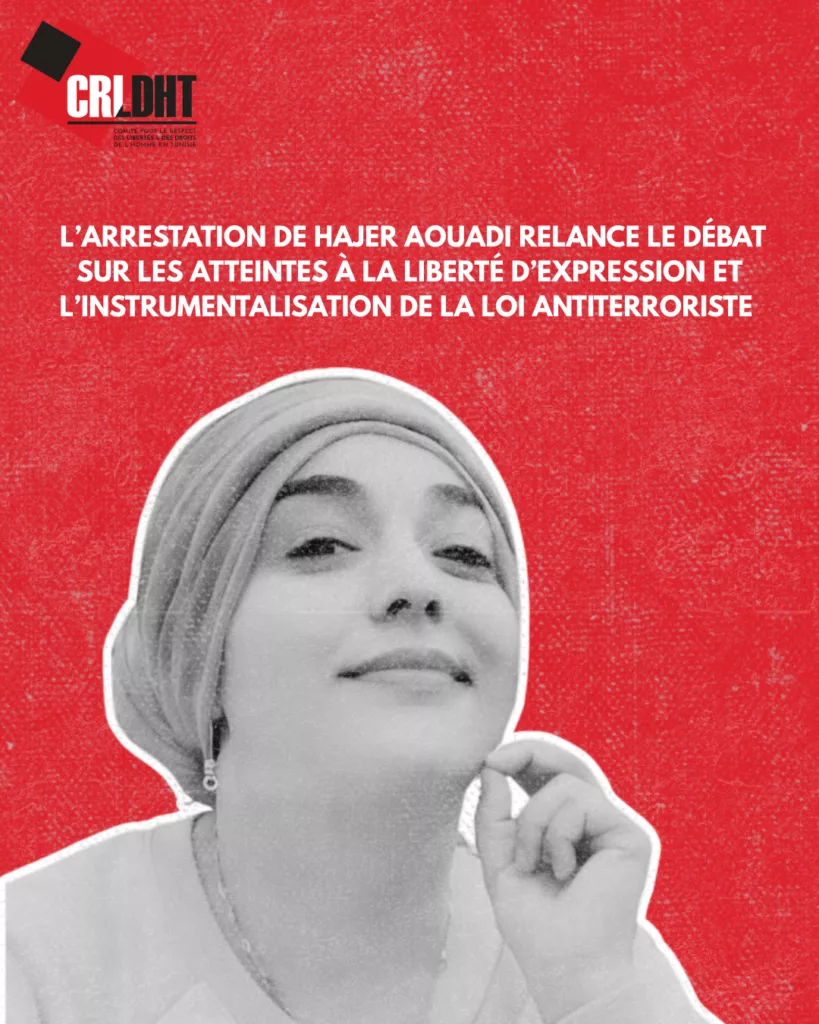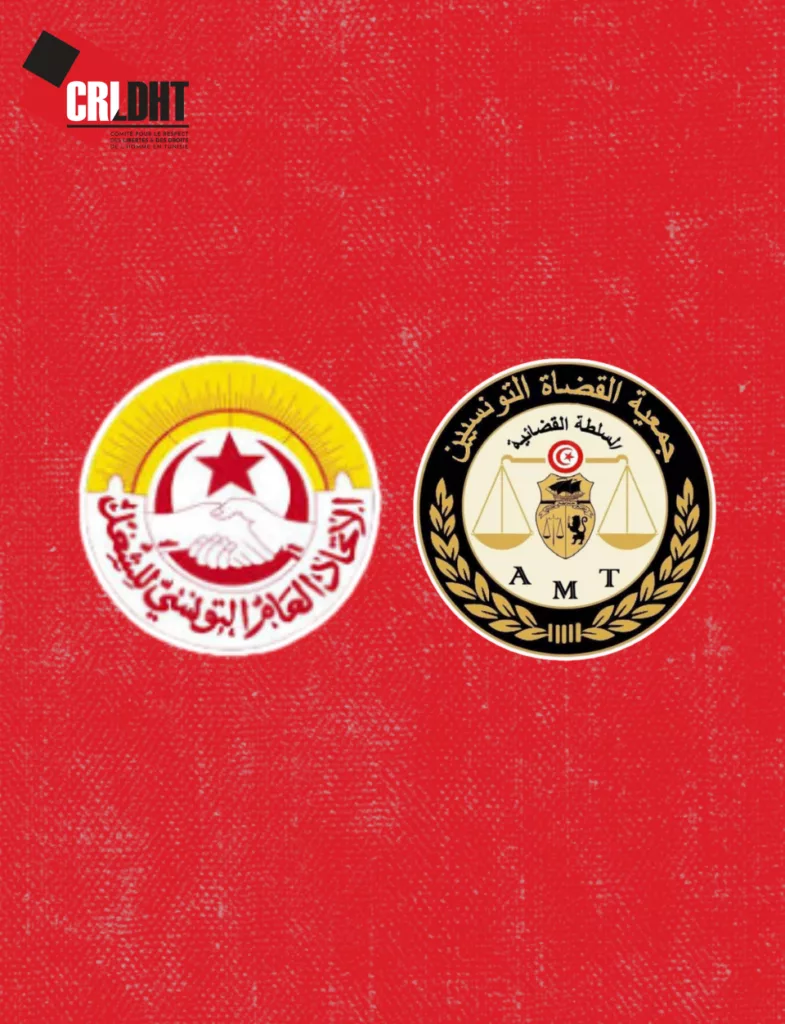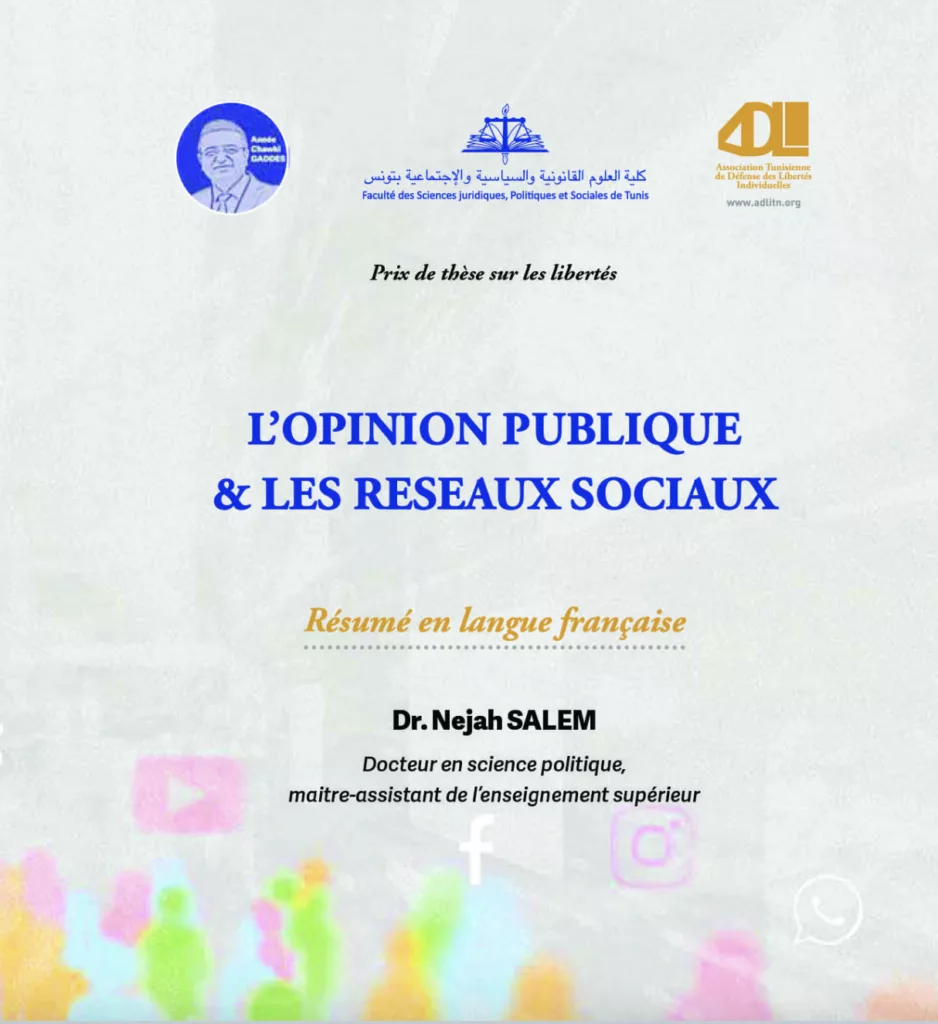Depuis 2021, la question migratoire est devenue un enjeu central non seulement dans les relations extérieures de la Tunisie, notamment avec l’Union européenne (UE), mais aussi dans ses dynamiques politiques internes. L’instrumentalisation de cette question par le pouvoir tunisien s’est traduite par la criminalisation de la solidarité envers les migrants et la répression des acteurs associatifs et critiques du gouvernement. À travers cette double lecture, la gestion des flux migratoires devient un baromètre de l’état des libertés fondamentales en Tunisie.
I. La migration : un axe central des relations Tunisie-UE
La coopération entre la Tunisie et l’UE s’est renforcée au cours des dernières années, centrée sur la migration comme point focal. L’UE a multiplié les initiatives pour externaliser le contrôle de ses frontières vers la Tunisie, à travers des accords de financement et des partenariats stratégiques. En juillet 2023, un mémorandum d’entente a été signé, allouant 150 millions d’euros pour renforcer les capacités de la Tunisie en matière de contrôle des frontières et de lutte contre la migration irrégulière. Toutefois, cet accord a suscité des critiques, notamment de la part du Parlement européen, qui a souligné l’absence d’évaluation de l’impact sur les droits humains (HRIA) avant sa mise en œuvre.
Cette coopération a renforcé la militarisation des frontières et l’externalisation des responsabilités en matière de gestion migratoire, mais elle s’est aussi traduite par des violations systématiques des droits fondamentaux des migrants. Les déplacements forcés, les expulsions arbitraires et les actes de violence contre les migrants subsahariens ont été documentés par de nombreuses ONG, comme Human Rights Watch et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES). Ces pratiques ont atteint leur paroxysme en 2023, lorsque plusieurs centaines de migrants ont été abandonnés dans des zones frontalières dangereuses avec la Libye et l’Algérie.
II. Discours xénophobes et politiques migratoires
Le tournant majeur dans la politique migratoire tunisienne est advenu en février 2023, avec un discours ouvertement xénophobe du président Kaïs Saïd. Lors d’une réunion du Conseil national de sécurité, il a affirmé que les migrants subsahariens faisaient partie d’un complot visant à altérer la composition démographique de la Tunisie. Ce discours, inspiré de la théorie complotiste du “grand remplacement”, a eu des conséquences immédiates et graves : multiplication des agressions racistes, expulsions forcées et renforcement des mesures sécuritaires.
Malgré la tentative de rétropédalage du président, affirmant en mars 2023 que ses propos avaient été mal compris, les violences contre les migrants ont continué. La création de milices, principalement dans des régions comme Sfax, a conduit à des campagnes de chasses aux migrants, souvent encouragées par des propos officiels. Parallèlement, les associations de la société civile, telles que Mnemty et Tunisie Terre d’Asile, ont condamné ces violences et dénoncé la politique raciste du gouvernement.
III. La criminalisation de la solidarité avec les migrants : un outil de répression
La lutte contre la migration irrégulière est également devenue un prétexte pour réprimer les opposants au régime. La criminalisation de la solidarité s’est manifestée par des arrestations arbitraires de militants et de responsables associatifs, sous des accusations fallacieuses telles qu’atteinte à la sûreté de l’État ou aide à l’immigration clandestine. Parmi les figures emblématiques touchées figurent Saadia Mosbah et Mohamed Jouou, ( tu peux citer d’autres noms comme Riahi …) qui ont été détenus pour avoir apporté un soutien humanitaire aux migrants subsahariens
Les lois tunisiennes, en particulier les dispositions pénales répressives comme le décret-loi 54 de 2022, ont été largement utilisées pour museler les voix dissidentes. Ce décret, initialement prévu pour lutter contre les fausses informations, est devenu un outil de répression massive contre les journalistes, les avocats et les militants. En 2024, plus de 1 700 personnes ont été poursuivies en vertu de l’article 24 de ce décret, y compris des activistes engagés dans des actions solidaires avec les migrants.
IV- Migration et régression des droits humains : une érosion systématique des libertés
La gestion autoritaire de la migration en Tunisie est étroitement liée à la régression des droits humains. Le coup d’état du 25 juillet 2021 par Kaïs Saïd a entraîné une série de mesures restrictives qui ont démantelé les institutions démocratiques et réduit les espaces de liberté. La dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en février 2022 et la concentration des pouvoirs judiciaire et législatif entre les mains du président ont rendu impossible tout contrôle des dérives autoritaires.
Dans ce contexte, la migration est devenue un indicateur du degré de liberté et de démocratie en Tunisie. L’absence de cadre juridique clair sur la protection des migrants, combinée à des lois pénales répressives, a créé un environnement propice aux violations systématiques des droits humains. Les migrants subsahariens, souvent contraints de vivre dans des conditions précaires et privés d’accès aux services essentiels tels que la santé et l’éducation, sont victimes d’une ségrégation de facto.
V- la réaction internationale : une mobilisation timide
Face aux dérives autoritaires et aux violations des droits humains, plusieurs organisations internationales ont réagi en appelant la Tunisie à respecter ses engagements internationaux. En 2023, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a dénoncé les pratiques racistes et discriminatoires du gouvernement tunisien, appelant à un arrêt immédiat des expulsions collectives et des violences contre les migrants. La Banque mondiale a temporairement suspendu sa coopération avec la Tunisie suite aux discours xénophobes de Kaïs Saïd.
Cependant, la mobilisation internationale reste insuffisante face à l’ampleur des violations. Les pressions diplomatiques doivent être renforcées en conditionnant les aides financières à un respect effectif des droits humains. De plus, l’UE doit évaluer l’impact de ses politiques migratoires sur la situation des droits humains et adopter des mécanismes de contrôle plus stricts pour éviter que ses partenariats n’encouragent les abus.
Conclusion : migrations et libertés, un combat interconnecté
La question migratoire en Tunisie dépasse largement le cadre des politiques de gestion des flux de personnes. Elle est devenue un enjeu des droits humains, un baromètre des libertés et un instrument de répression politique. L’érosion des libertés en Tunisie est aujourd’hui un phénomène global où la lutte contre la migration irrégulière sert de prétexte pour museler les voix critiques et renforcer le pouvoir autoritaire. Restaurer les acquis démocratiques en Tunisie nécessite donc une mobilisation à la fois nationale et internationale assorti d’un soutien accru aux défenseurs des droits humains et aux populations les plus vulnérables.