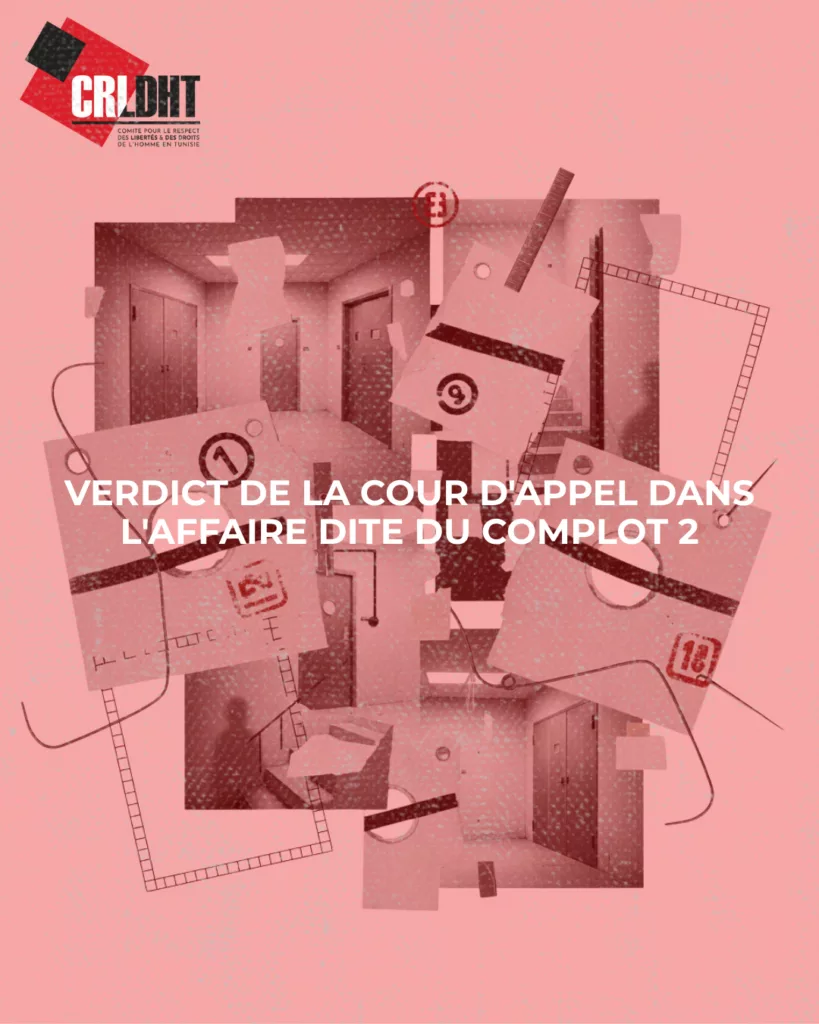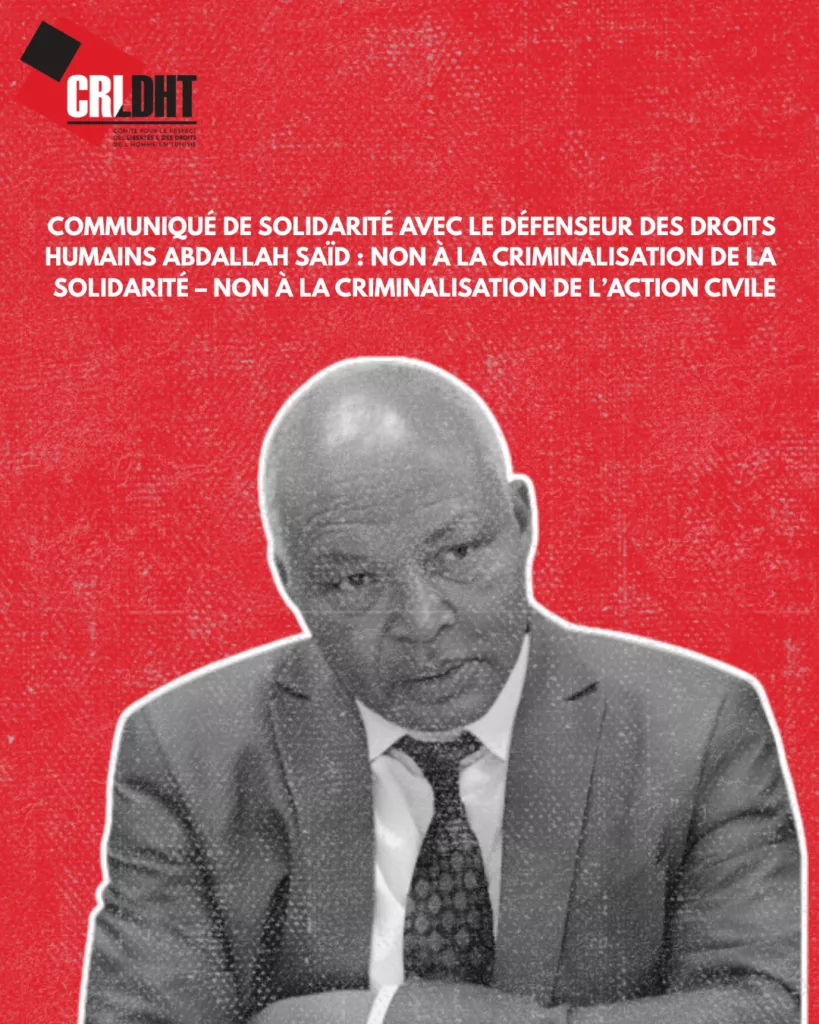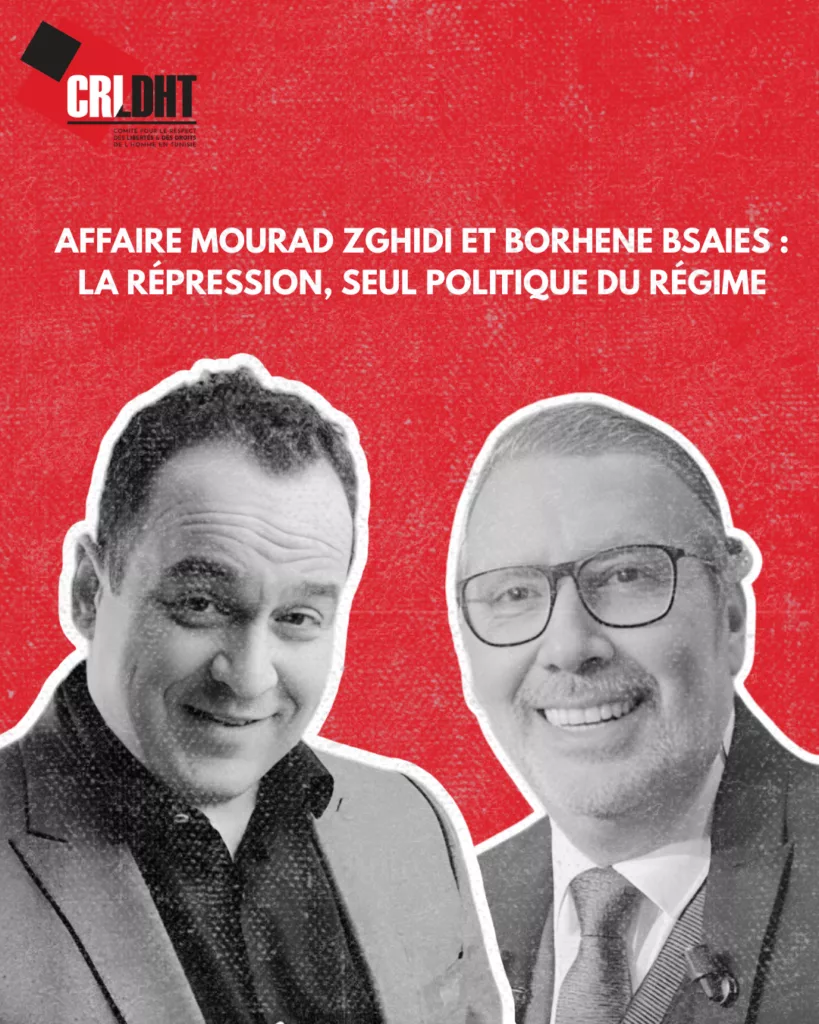- Contexte : un climat d’intimidation et de répression croissante
Alors que des annonces virales font état d’« enquêtes étendues » visant des dizaines d’associations et l’activation en chaîne de gels d’avoirs, les autorités tunisiennes affirment agir au nom de la transparence et de la souveraineté nationale.
Mais dans un État de droit, le contrôle des financements ne saurait se confondre ni avec la stigmatisation généralisée, ni avec la sanction sans juge.
Encore faut-il rappeler — textes à l’appui — ce que le droit autorise, ce qu’il encadre, et où commencent les dérives.
Depuis deux ans, chaque épisode de tension nationale — élections législatives à faible participation (2023), crise migratoire (2024), ou catastrophe environnementale à Gabès (2025) — s’accompagne d’une offensive contre l’espace civique : perquisitions spectaculaires, poursuites contre des défenseur·es, suspension administrative de l’ATFD (24 octobre 2025), pressions sur les médias, et campagnes publiques amalgamant financements étrangers et atteinte à la sécurité nationale.
Sur les réseaux et dans certains médias, listes nominatives et montants “chocs” sont publiés, attribués à des ONG et à des rédactions indépendantes. Ces chiffres, présentés comme extraits de rapports de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF/BCT) ou de la Cour des comptes, sont rarement vérifiables ou rendus publics dans les termes avancés. Ce climat de suspicion généralisée transforme progressivement la logique de prévention en une punition de facto.
Depuis la mi-octobre 2025, le ministère public a confirmé l’ouverture d’enquêtes judiciaires élargies visant plusieurs dizaines d’associations accusées d’avoir reçu des financements étrangers “suspects”, en particulier de la fondation américaine Open Society Foundations (OSF).
Des informations relayées par des canaux officiels et para-officiels évoquent déjà des gels d’avoirs, des suspensions d’activité, voire des poursuites pénales pour “atteinte à la sûreté de l’État” ou “blanchiment d’argent”.
Ces développements s’inscrivent dans un resserrement autoritaire plus large, marqué par :
- la suspension de l’ATFD (24 octobre 2025) ;
- la convocation en urgence de l’audience d’appel dans l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État ;
- la répression des mobilisations sociales à Gabès à la suite de la catastrophe environnementale d’octobre ;
- et la criminalisation croissante de la solidarité avec les migrant·es, les réfugié·es et les défenseur·es des droits humains.
Ces actions traduisent un durcissement du contrôle politique et judiciaire sur l’ensemble du tissu associatif, y compris à l’encontre d’organisations historiquement reconnues pour leur transparence, leur ancrage local et leur contribution au débat public — telles que le FTDES, I-Watch, Al-Bawsala, Solidar Tunisie, Inkyfada, Damj, Chouf ou Mourakiboun.
2. un rappel essentiel : le financement étranger des associations est légal
Le décret-loi n°2011-88 du 24 septembre 2011, qui régit le cadre associatif tunisien, autorise explicitement les associations à recevoir des financements de l’étranger.
Article 35 : « L’association peut recevoir des dons, aides et subventions provenant de l’intérieur ou de l’extérieur du pays, conformément à la législation en vigueur, à condition d’en informer le Secrétariat général du gouvernement. »
Ce texte, adopté après la révolution, repose sur une philosophie claire : liberté, transparence et responsabilité.
Il remplace le régime d’autorisation préalable par un régime déclaratif, fondé sur la bonne foi et la publication des informations financières.
Le législateur post-2011 a explicitement voulu normaliser la coopération internationale et encourager le développement de la société civile comme partenaire de l’État.
Assimiler le financement étranger à une “ingérence” ou à une “menace” contredit directement la lettre et l’esprit du décret-loi 88, et constitue une interprétation abusive de la loi.
3. La criminalisation de la solidarité avec les migrants
Depuis 2024, plusieurs associations travaillant sur les migrations et les droits humains font l’objet d’enquêtes pénales ou de poursuites arbitraires :
- Tunis Terre d’Asile (France Terre d’Asile Tunisie) : sa présidente Chérifa Riahi a été arrêtée pour “hébergement d’étrangers sans autorisation” (mai 2024).
- Conseil tunisien pour les réfugiés : son directeur Mustapha Jemali et son collaborateur Abderrazak Karimi sont détenus depuis mai 2024 ; leur audience est prévue le 24 novembre 2025.
- Association Manamti : sa fondatrice Saïdia Msibah a été arrêtée pour “blanchiment” et “enrichissement illicite”, sur la base de transferts provenant de bailleurs européens.
- Association Tafdil al-Haqq fi al-Ikhtilaf (Droit à la différence) : sa directrice Salwa Ghrissa est poursuivie sous la loi antiterroriste pour des activités de plaidoyer financées par des fonds européens.
Ces organisations, qui agissent dans les domaines humanitaire et social, remplissent des fonctions que l’État lui-même ne prend plus en charge : accueil, accompagnement, assistance juridique, documentation.
Les poursuivre pour “atteinte à la souveraineté” ou “blanchiment” constitue une violation manifeste du droit international et une criminalisation de la solidarité.
4. les obligations juridiques de la Tunisie
a- Droit interne
Le décret-loi n°2011-88 prévoit une graduation stricte des sanctions :
- Avertissement écrit et délai de mise en conformité ;
- Suspension temporaire (maximum 30 jours), motivée et notifiée ;
- Dissolution uniquement par décision judiciaire.
Le gel d’avoirs est encadré par la loi organique n°2015-26 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Cette mesure doit être individuelle, motivée, limitée dans le temps et faire l’objet d’un recours effectif.
Son utilisation massive et préventive, sans publication des motifs, détourne la loi de sa finalité.
b. Droit international
La Tunisie est partie à plusieurs instruments contraignants :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 22) : liberté d’association, restrictions uniquement légales, nécessaires et proportionnées.
- Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (art. 10) : interdiction des mesures arbitraires.
- Déclaration de l’ONU sur les défenseur·es des droits humains (1998) : obligation positive de l’État de protéger les associations et individus qui promeuvent les droits humains.
Les mesures actuelles — suspensions automatiques, gels d’avoirs non motivés, détentions prolongées — constituent des violations directes de ces obligations.
5. Une dérive politique et symbolique : « souveraineté » contre « société civile »
Le discours officiel revendique une “protection de la souveraineté nationale” contre des “financements extérieurs malveillants”.
Mais cette rhétorique masque une entreprise de neutralisation des contre-pouvoirs et d’étouffement du pluralisme.
La Tunisie dépend pourtant de la coopération internationale : Union européenne, FMI, Banque mondiale, coopération bilatérale.
L’argument souverainiste sert désormais à centraliser la légitimité politique et à affaiblir les acteurs indépendants — syndicats, médias, associations, défenseur·es des droits.
6. Les risques : un démantèlement progressif du cadre démocratique et de la légalité institutionnelle
- Risque juridique : remise en cause du décret-loi 88, fondement de la liberté associative.
- Risque politique : effacement des contre-pouvoirs et rétablissement d’un contrôle étatique total sur la société civile.
- Risque social : perte d’un réseau d’assistance vital dans les domaines humanitaire, sanitaire et environnemental.
- Risque international : isolement diplomatique et suspension de plusieurs programmes de coopération et d’appui institutionnel.
7. Recommandations du CRLDHT
A l’Etat tunisien
- Respecter intégralement les dispositions du décret-loi 2011-88 et ses garanties procédurales.
- Publier les rapports de la CTAF et de la Cour des comptes invoqués dans les enquêtes, et permettre le contradictoire.
- Lever immédiatement les mesures de gel et de suspension prises en dehors de tout contrôle judiciaire.
- Mettre fin aux poursuites contre les associations œuvrant dans le domaine humanitaire et des droits humains.
- Réaffirmer publiquement que le financement étranger des associations, déclaré et transparent, est un droit légal.
Aux partenaires internationaux
- Conditionner l’aide bilatérale à la garantie effective de la liberté d’association.
- Soutenir la création d’un mécanisme indépendant de régulation et de transparence du secteur associatif.
- Renforcer la protection des défenseur·es et des acteurs associatifs exposés à des représailles.
A la société civile tunisienne
- Renforcer les dispositifs de transparence et de reporting financier.
- Mutualiser les moyens juridiques et médiatiques pour assurer la défense collective du secteur.
- Coordonner les actions de plaidoyer auprès des instances internationales et des partenaires de la Tunisie.
8. conclusion
La Tunisie traverse une phase critique où le discours sur la souveraineté sert à restreindre les libertés publiques.
Pourtant, la liberté d’association et la coopération internationale sont des piliers de la souveraineté démocratique.
Le financement étranger déclaré, encadré par la loi, n’est ni une menace ni un crime — c’est un instrument de développement et d’ouverture.
Le CRLDHT appelle les autorités tunisiennes à cesser immédiatement la criminalisation du tissu associatif, à rétablir la légalité et à honorer les engagements internationaux du pays.
La souveraineté ne se défend pas contre la société civile : elle se construit avec elle.