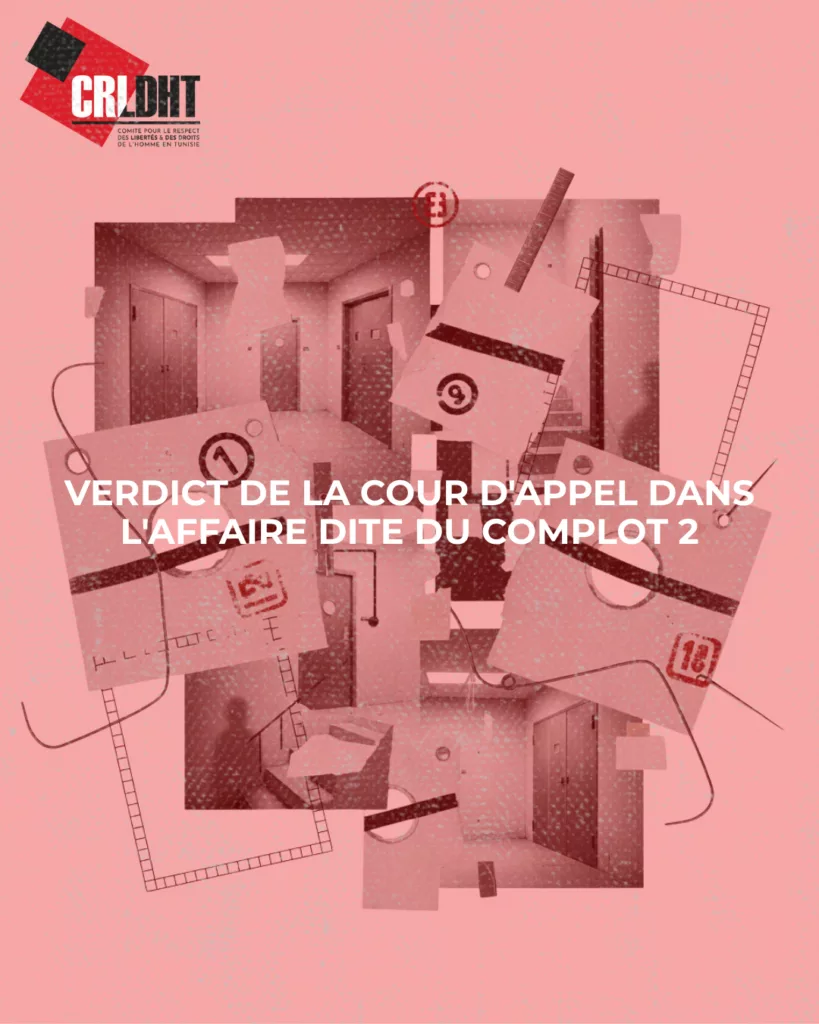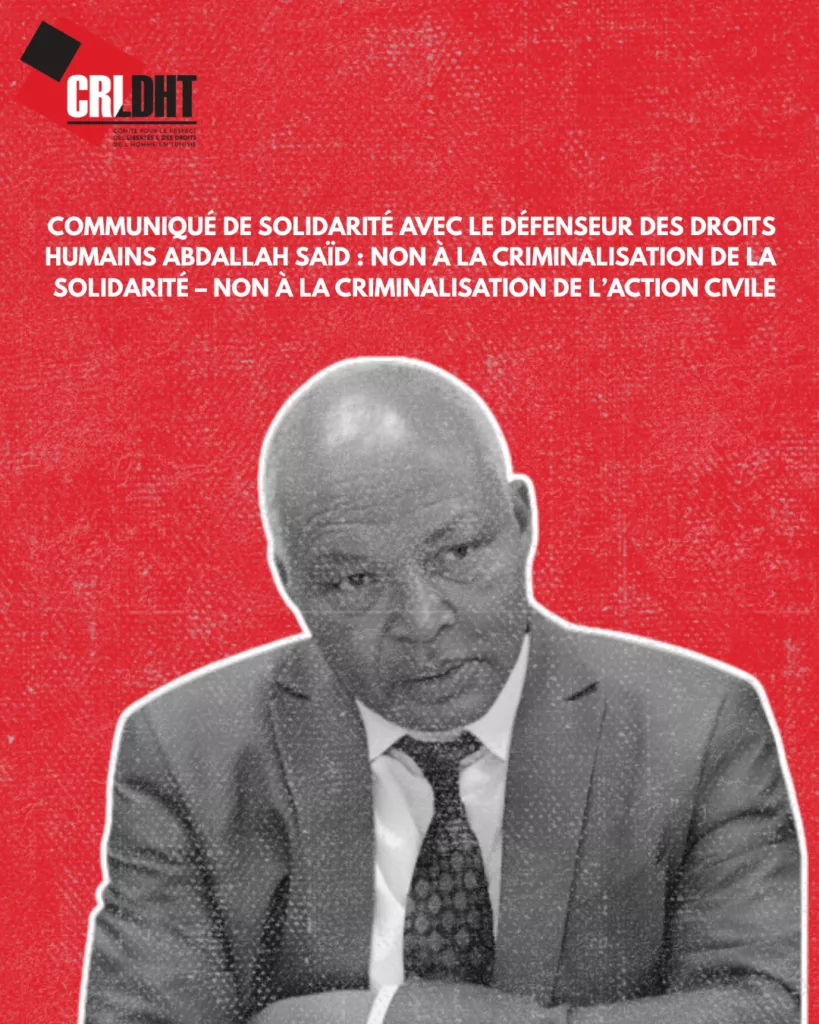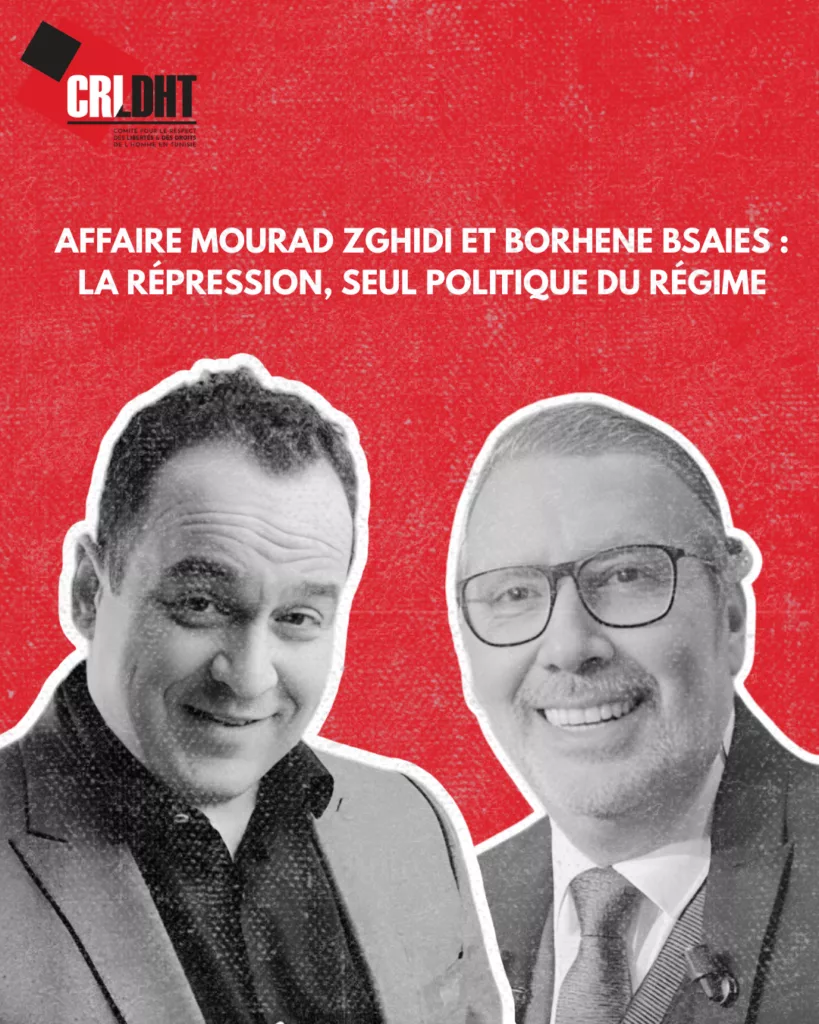Le 7 octobre 2025, à Alger, le général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’armée algérienne, a présidé la signature d’un accord de coopération militaire et sécuritaire entre l’Algérie et la Tunisie. La délégation tunisienne, conduite par le ministre de la Défense Khaled Shili, s’est rendue dans la capitale algérienne dans la plus grande discrétion.
Aucune communication officielle n’a suivi. C’est la presse algérienne qui a révélé l’information, confirmant ce que plusieurs observateurs pressentaient : un tournant stratégique dans la relation entre Alger et Tunis.
Une alliance conclue dans le silence
Ni Carthage ni le ministère tunisien de la Défense n’ont commenté la signature. Le texte n’a pas été publié au Journal officiel, ni soumis au Parlement. Ce silence inhabituel contraste avec l’ampleur du contenu supposé de l’accord.
D’après des éléments révélés dans la presse, celui-ci prévoirait notamment :
- un échange permanent d’informations militaires et de renseignement ;
- des patrouilles et manœuvres conjointes dans les zones frontalières ;
- un contrôle intégré des frontières, censé lutter contre la contrebande et la migration irrégulière ;
- la formation croisée des officiers des deux armées ;
- et surtout, un droit de poursuite limité, autorisant des unités algériennes à pénétrer jusqu’à 50 kilomètres à l’intérieur du territoire tunisien lors d’opérations conjointes contre des groupes terroristes.
Plus troublant encore : une clause d’exclusivité interdirait à la Tunisie de conclure des accords sécuritaires avec d’autres partenaires sans accord préalable d’Alger.
Si ces dispositions sont exactes, elles marquent une rupture sans précédent dans la doctrine de souveraineté tunisienne.
Un contexte explosif
Cette signature n’intervient pas dans le vide. Depuis 2022, Tunis et Alger resserrent leurs liens, sur fond d’instabilité régionale et d’isolement croissant de la Tunisie.
Au moment où l’accord est conclu, la région est secouée par les attaques de drones contre des la flottille Soumoud à Sidi Bou Saïd, la guerre génocidaire à Gaza et des raids israéliens au Liban et au Yémen.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, alarmé par ce qu’il qualifie de « ciblage militaire de l’Algérie », multiplie les alliances défensives de proximité.
De son côté, Kaïs Saïed, affaibli par une crise économique sans issue et privé d’appuis extérieurs solides après la réduction de moitié de l’aide américaine , cherche un partenaire régional capable de le soutenir sans condition politique.
L’Algérie apparaît dès lors comme le dernier recours : fournisseur d’énergie, de liquidités et de légitimité. Mais cette dépendance a un prix.
Les dessous d’un rapprochement inégal
Pour Alger, l’intérêt est clair :
- consolider une zone tampon à sa frontière est,
- s’assurer une présence opérationnelle dans le sud tunisien,
- et contourner l’influence européenne et américaine au Maghreb central.
L’accord lui permet aussi d’accéder à des infrastructures tunisiennes – ports du sud, routes énergétiques, réseaux de surveillance – et de renforcer sa posture de puissance tutélaire régionale, surtout après la déstabilisation du Sahel et le retrait français.
Pour Tunis, la logique est d’abord défensive : garantir un parapluie sécuritaire face à la fragilité de ses institutions et au risque d’instabilité dans les zones frontalières. Mais derrière cette recherche de protection, c’est une forme de vassalisation stratégique qui se profile.
L’Algérie fixe le rythme, définit les priorités, et impose les conditions. La Tunisie devient, de fait, un avant-poste de la défense algérienne.
Une dérive inquiétante : la sécurité contre la démocratie
Au-delà des calculs géopolitiques, cette coopération opaque soulève des questions institutionnelles et démocratiques majeures.
L’absence de publication officielle, le refus de tout débat parlementaire et le silence de la présidence traduisent un déficit de légitimité grave.
Ce type d’accord, qui touche directement à la souveraineté et à la sécurité nationale, ne peut être décidé dans le secret des états-majors.
L’histoire récente rappelle que la militarisation des affaires publiques et la concentration du pouvoir entre les mains de l’exécutif fragilisent encore davantage un État déjà affaibli par la crise économique et la désaffection citoyenne.
S’y ajoute le risque de dérive autoritaire : transfert d’informations sur des activistes, surveillance accrue des ONG, extension du champ antiterroriste à la contestation sociale.
La Tunisie dans le camp algérien ?
Cette alliance traduit également un repositionnement géopolitique profond.
Kaïs Saïed semble avoir rompu avec la politique traditionnelle de la Tunisie pour se recentrer sur un axe régional fermé, dominé par Alger et, en toile de fond, un rapprochement discret avec Téhéran.
Le Maghreb se trouve désormais divisé :
- d’un côté, l’axe Alger–Tunis–Téhéran, fondé sur le souverainisme et l’hostilité à l’OTAN ;
- de l’autre, Rabat, Le Caire et Tripoli Ouest, arrimés aux puissances occidentales.
Cette polarisation renforce l’isolement de Tunis, désormais perçue comme alignée sur le camp algérien, et fragilise encore ses relations avec l’Europe, notamment l’Italie, dont les accords migratoires risquent d’être remis en cause.
Souveraineté, sécurité et droits : un triangle fragile
Il serait illusoire de nier la nécessité d’une coopération sécuritaire régionale. Mais un tel partenariat doit être fondé sur l’équilibre, la transparence et la réciprocité.
S’il se confirme que la Tunisie a concédé à son voisin un droit d’ingérence opérationnelle et une exclusivité de défense, c’est non seulement sa souveraineté militaire qui est en jeu, mais aussi l’indépendance de son destin politique.
La sécurité n’est pas un argument pour effacer la démocratie.
Et la souveraineté ne peut se réduire à la survie d’un pouvoir affaibli : elle appartient à tout un peuple, pas à ceux qui la négocient dans le secret.
S’il s’agit d’une coopération classique, qu’on la publie.
S’il s’agit d’un engagement d’exception, qu’on en débatte.
Le silence ne protège pas la sécurité nationale – il mine la confiance publique.
Dans une région où les frontières de la légitimité et de la souveraineté se brouillent chaque jour un peu plus, la Tunisie ne peut pas se permettre d’être un territoire sous tutelle.
La sécurité ne se construit pas dans l’ombre : elle se fonde sur la confiance, la transparence et la dignité nationale.