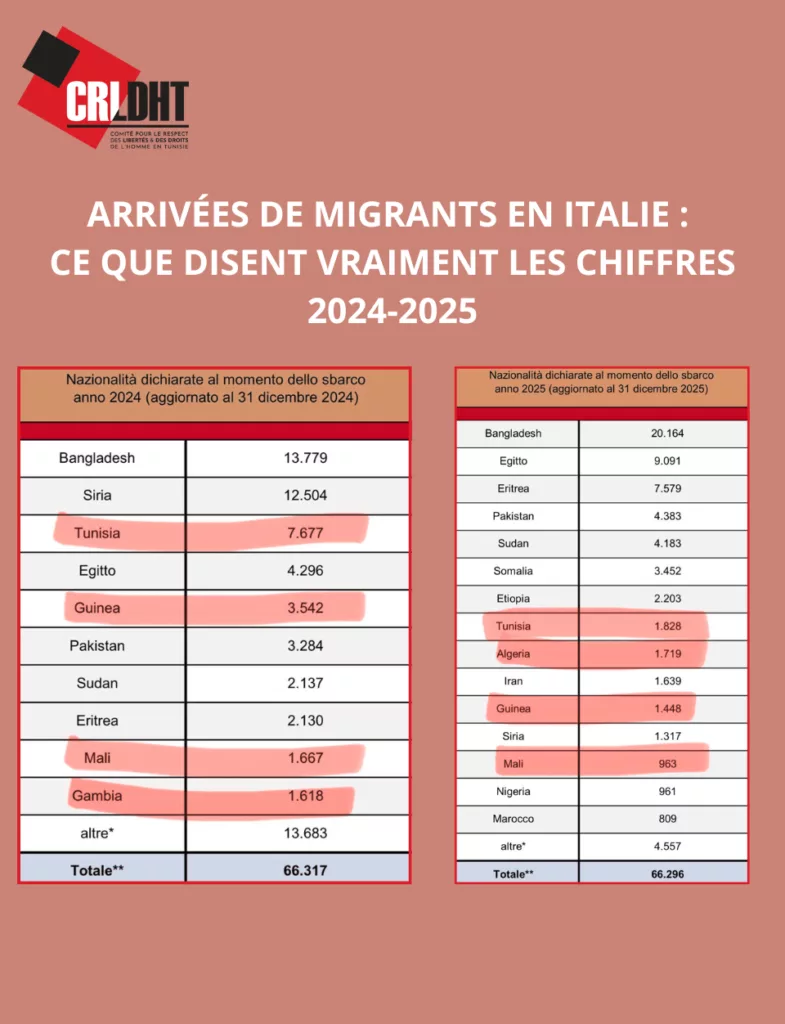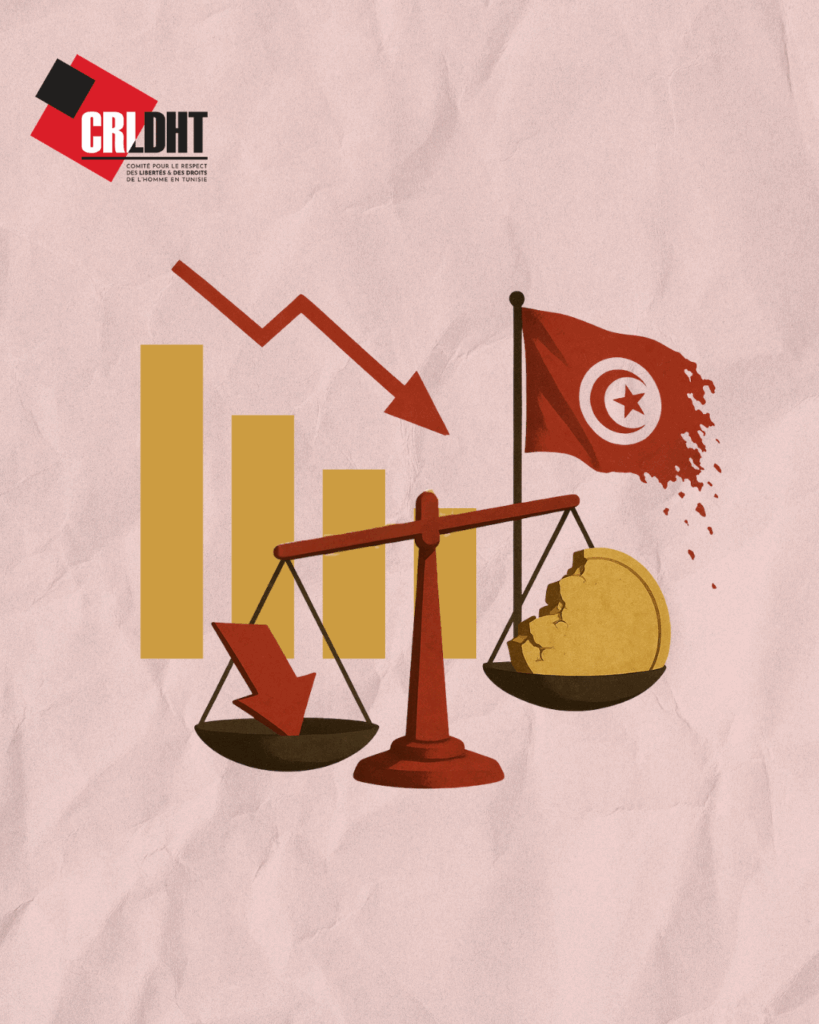La décision rendue vendredi 2 janvier 2026 par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis, confirmant la condamnation de Mohamed Boughaleb à deux ans de prison — fût‑ce avec sursis — constitue un acte grave, révélateur de l’état de délabrement avancé de la justice tunisienne et de sa soumission assumée au pouvoir exécutif.
En confirmant le principe même de la condamnation, la Cour d’appel entérine une logique de criminalisation de la parole journalistique et valide l’usage politique du décret‑loi 54 comme instrument de mise au pas des voix critiques. Le sursis ne change rien à la nature de la décision : il ne s’agit ni d’un acquittement, ni d’une correction d’une injustice manifeste, mais d’un message de menace permanente adressé à Mohamed Boughalleb et, à travers lui, à l’ensemble des journalistes, intellectuel·les et citoyen·nes qui refusent le silence.
Le dossier repose sur une plainte déposée par une enseignante universitaire, accusant le journaliste de diffamation et de menaces à partir d’une publication sur les réseaux sociaux. Une affaire ancienne, remontant à avril 2023, instruite sans expertise numérique sérieuse, sans démonstration rigoureuse de l’imputabilité des propos, et au mépris des principes les plus élémentaires du droit pénal et de la liberté d’expression. Malgré ces failles majeures, la justice a persisté, s’obstinant à qualifier pénalement ce qui relève, au pire, d’un débat public et d’une expression critique.
En juillet 2025, Mohamed Boughalleb avait déjà été condamné en première instance à deux ans de prison. La Cour d’appel aurait pu corriger une décision manifestement disproportionnée, juridiquement fragile et politiquement motivée. Elle a choisi de ne pas le faire. Elle a préféré confirmer la condamnation, tout en suspendant son exécution, maintenant ainsi le journaliste sous la menace constante d’une incarcération à tout moment.
Cette décision s’inscrit dans une trajectoire répressive continue. Mohamed Boughalleb a déjà payé de sa liberté son travail journalistique : condamné en avril 2024 à six mois de prison dans une affaire liée au ministère des Affaires religieuses — peine alourdie à huit mois en appel — il a intégralement purgé cette condamnation. Il a passé près de onze mois en détention, dans des conditions éprouvantes, qui ont durablement affecté sa santé physique et psychologique.
Depuis sa mise en liberté conditionnelle, le 20 février 2025, il restait soumis à des mesures restrictives lourdes : interdiction de quitter le territoire, contrôle judiciaire permanent, obligation de comparution. La décision de la Cour d’appel ne met pas fin à cet acharnement : elle le normalise, elle l’institutionnalise.
La justice tunisienne n’est plus ici un arbitre : elle est devenue un outil disciplinaire, chargé de rappeler aux journalistes que la critique a un prix, que la parole libre expose à la prison, et que le décret‑loi 54 demeure une épée de Damoclès prête à s’abattre sur quiconque refuse l’alignement.
Ce verdict n’est pas une décision isolée. Il s’inscrit dans une offensive plus large contre la liberté d’expression, marquée par les poursuites contre des journalistes, des avocat·es, des opposant·es et des militant·es, et par l’usage systématique de textes liberticides pour étouffer le débat public. La confirmation de la condamnation de Mohamed Boughalleb est une condamnation symbolique de la liberté de la presse en Tunisie.
L’histoire retiendra que, même sous couvert de sursis, cette justice aura choisi la peur plutôt que le droit, l’obéissance plutôt que l’indépendance et la répression plutôt que la liberté.
Soutenir Mohamed Boughalleb, Chadha Haj Mbarek, Sonia Dahmani, Borhen Bsaies, Mourad Zeghidi et tous les autres, c’est défendre un droit collectif essentiel : celui d’informer, de critiquer, de penser et de dire.