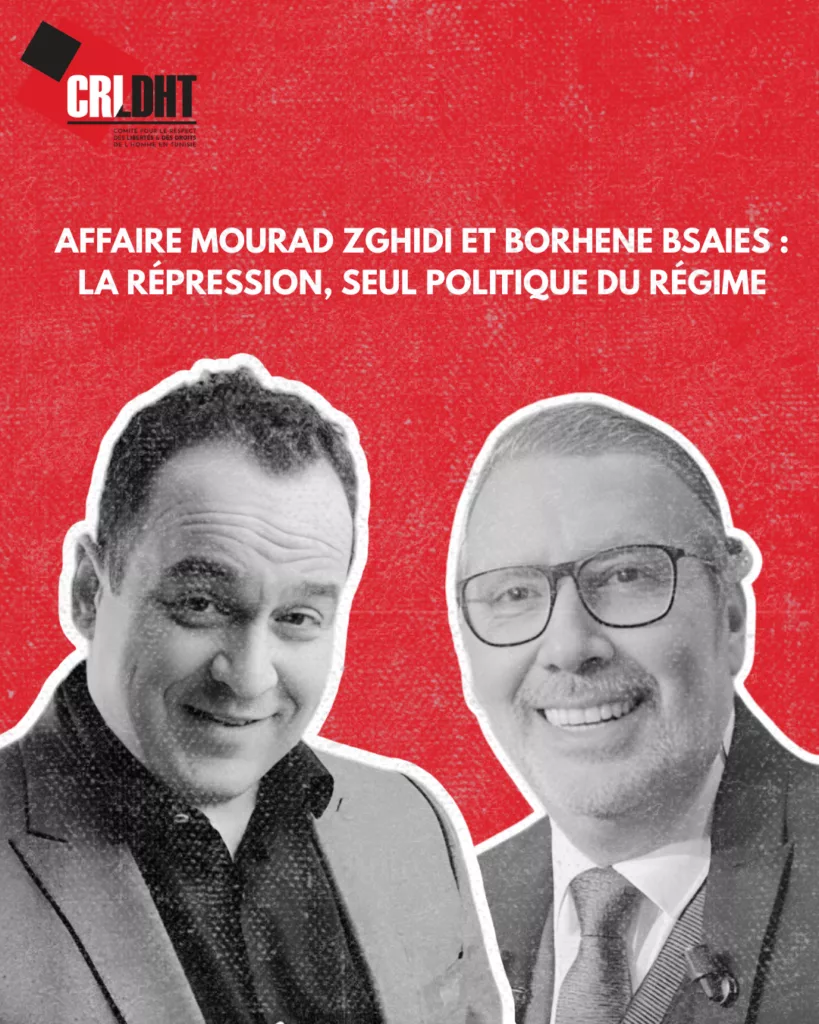Dans l’ombre des crises politique et économique, une autre lutte se mène en Tunisie : celle pour un environnement vivable et une transition écologique juste. Portées par une société civile dynamique mais fragilisée, les mobilisations environnementales s’affirment comme des formes de résistance citoyenne face à un régime de plus en plus autoritaire.
Par-delà les discours technocratiques sur la durabilité ou les annonces gouvernementales sur les énergies renouvelables, l’écologie tunisienne est aujourd’hui traversée par des revendications radicales et ancrées : pour la justice sociale, la souveraineté territoriale et la démocratie réelle. C’est le constat que dresse l’étude de Mohamed Ismail Sabry, Environmental Organizations and Mobilization in Tunisia, publiée en avril 2025 par l’Arab Reform Initiative.2025-04-ENGLISH-Environmental-Organizations-and-Mobilization-in-Tunisia-2.pdf
Une écologie forgée dans les luttes
L’étude couvre la période allant de 2011 à 2024, soit les années de la « transition tunisienne », marquées d’abord par un espoir démocratique, puis par une lente dérive autoritaire incarnée Kaïs Saïed. Dans ce contexte, les organisations de la société civile environnementale (ECSOs) se sont multipliées. Certaines sont nées dans l’effervescence post-révolutionnaire, d’autres sont issues d’un tissu militant plus ancien, souvent lié aux droits humains, aux luttes sociales ou aux syndicats.
Ces organisations ne se limitent pas à la protection de la nature : elles articulent systématiquement l’environnement au social, à l’économie et à la démocratie. Leurs terrains de lutte sont aussi bien les décharges illégales, les usines chimiques polluantes, la privatisation de l’eau, que les politiques énergétiques dictées par les bailleurs internationaux.
Parmi les cas étudiés : la pollution à Gabès causée par le Groupe Chimique Tunisien, les rejets toxiques de l’industrie textile dans le golfe de Monastir, ou encore les conflits d’accès à l’eau à Redeyef. Autant de luttes qui croisent inégalités territoriales, marginalisation socio-économique et inaction de l’État.
Entre sensibilisation, résistance et contentieux
Les tactiques des ECSOs sont variées. La sensibilisation (ateliers, campagnes de communication, production de savoirs critiques) reste la plus utilisée et jugée la plus efficace. Elle est portée notamment par des Fondations internationales (Heinrich Böll, Rosa Luxemburg, Friedrich Ebert) en partenariat avec des ONG tunisiennes. Mais les actions de protestation directe (sit-in, blocages, manifestations) se sont aussi multipliées, en particulier dans les régions du sud et de l’intérieur.
Certaines de ces mobilisations ont abouti à des victoires judiciaires, comme dans le cas de la fermeture d’une décharge à Agareb grâce à l’action du collectif Manich Msab (“Je ne suis pas une poubelle”). D’autres ont permis d’imposer des mesures temporaires (accès à l’eau, arrêt de projets) ou d’alerter l’opinion publique.
En revanche, le recours au contentieux reste limité en raison des lenteurs administratives, du manque de moyens juridiques et de la faiblesse de l’indépendance judiciaire — un problème qui est allée en s’aggravant depuis 2021.
Une transition verte… sans les citoyen-nes
Alors que la Tunisie affiche des ambitions en matière d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène vert (notamment pour l’exporter vers l’Europe), les ECSOs dénoncent une transition imposée, opaque et extractive. Des projets comme le parc éolien de Borj Essalhi ou les programmes pilotes d’hydrogène sont contestés pour leur impact social, leur accaparement de terres, les nuisances sonores et surtout l’absence de consultation des populations locales.
Le groupe de travail pour la démocratie énergétique, composé de syndicats affiliés à l’UGTT, propose une vision alternative de la transition, fondée sur les droits sociaux, la souveraineté énergétique et la justice territoriale. Il s’oppose à la privatisation du secteur et milite pour une gouvernance partagée de l’énergie
Un espace civique sous pression
Mais ces mobilisations se déroulent dans un contexte politique de plus en plus répressif. Depuis la concentration des pouvoirs opérée par Kaïs Saïed en juillet 2021, plusieurs projets de lois visent à restreindre l’activité des associations, notamment par le contrôle des financements étrangers et la possibilité de dissolution administrative sans recours judiciaire.
Si la loi n’est pas encore adoptée, son effet dissuasif est réel : plusieurs ECSOs ont réduit leurs activités ou rompu des partenariats, par crainte de représailles ou de stigmatisation publique. L’autoritarisme ne se manifeste pas seulement par la coercition, mais aussi par la désinformation, la délégitimation des ONG, et la criminalisation de la contestation — y compris environnementale.
Une écologie politique et populaire
L’un des apports majeurs de l’étude est de montrer que l’écologie en Tunisie n’est pas un luxe technocratique, ni un secteur dépolitisé. Elle est une réponse à l’injustice sociale, à la corruption, à l’accaparement des ressources et à l’absence de démocratie réelle. Elle est le lieu où s’inventent de nouvelles formes de participation politique : locales, décentralisées, autonomes, collectives.
Les collectifs environnementaux tunisiens démontrent que défendre l’environnement, c’est défendre le droit à la ville, à l’eau, à la santé, à l’information, à la souveraineté territoriale. C’est refuser la marginalisation des régions de l’intérieur. C’est exiger que la transition verte ne se fasse pas au détriment des plus vulnérables, mais à partir de leurs besoins, de leurs savoirs et de leurs luttes.
Conclusion : pour une transition juste, démocratique et populaire
Alors que l’espace civique tunisien se réduit et que les urgences écologiques s’intensifient, les ECSOs jouent un rôle crucial pour maintenir une vigilance citoyenne, défendre les droits collectifs et porter des alternatives au modèle de développement dominant.
L’écologie tunisienne est une écologie de résistance. Elle est l’un des rares espaces où les aspirations démocratiques de 2011 trouvent encore un écho. Elle mérite, plus que jamais, d’être soutenue, reconnue et relayée.