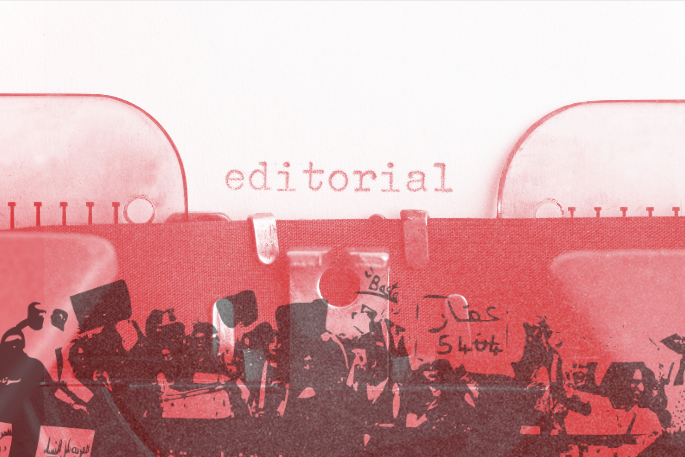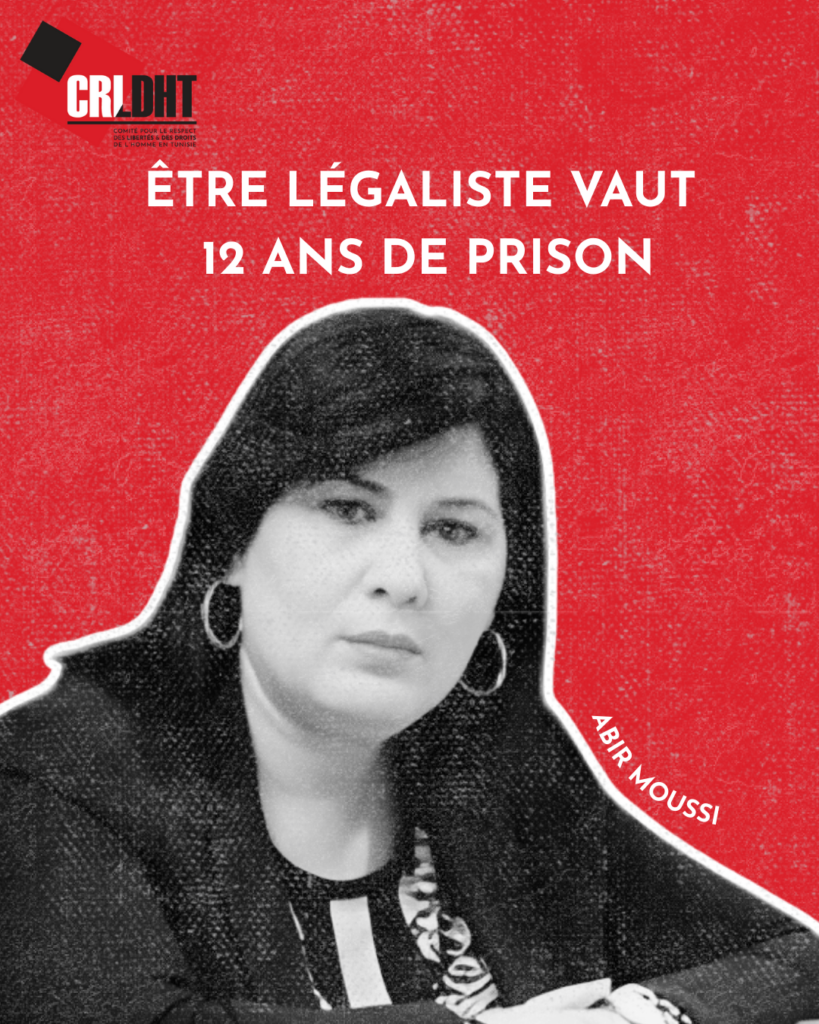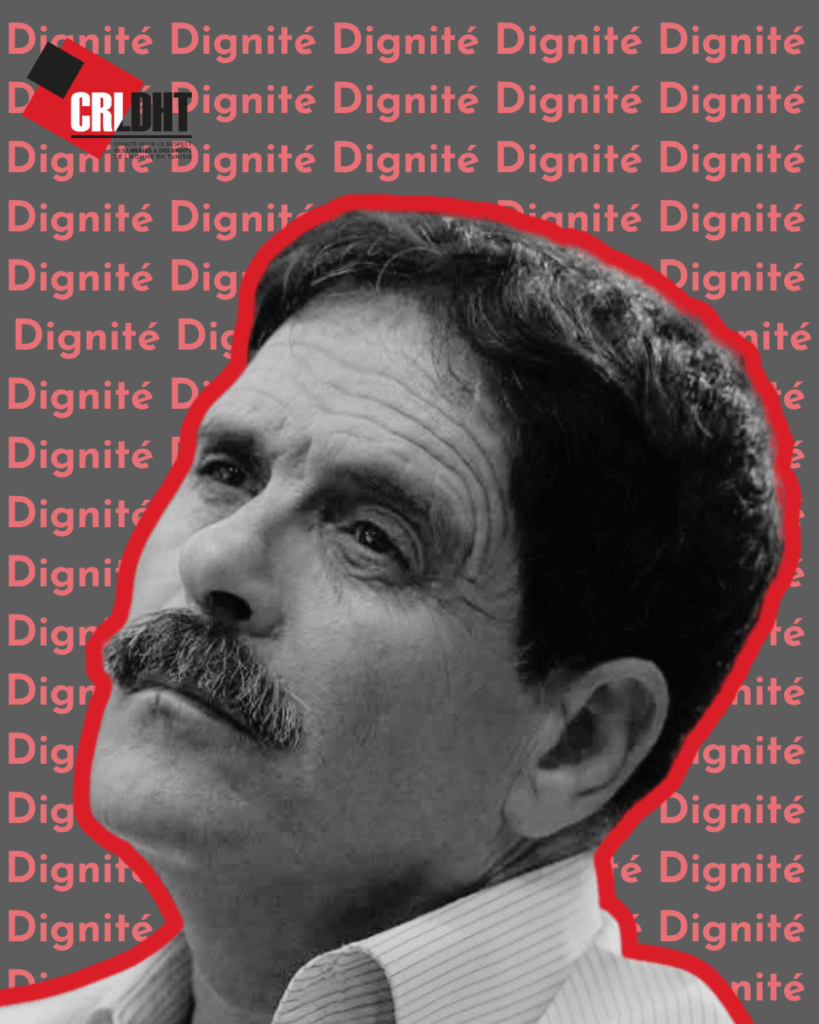Cela fait maintenant plus de deux années que l’affaire dite du complot contre la sûreté de l’État occupe l’opinion publique tunisienne et internationale. Malgré une interdiction émise par le juge d’instruction aux médias de traiter du dossier, cette affaire judiciaire a été la plus importante depuis le coup d’État de Kaïs Saïed vu les profils des inculpés, qui sont des leaders politiques de premier rang, des partis politiques qui se sont opposés à Kaïs Saïed, des activistes de la société civile, des hommes d’affaires et d’autres encore que rien ne réunit a priori. La justice tunisienne, mise au pas par Kaïs Saïed et sa ministre de la Justice Leila Jaffel, n’ont cessé de violer les principes et les règles de procédure pénale et les droits les plus fondamentaux des détenus comme l’a constaté la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans son arrêt de mesures provisoires dans le cadre de l’affaire 04/2023.
La détention arbitraire, comme l’a bien caractérisé le groupe de travail du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, et ce à tous les motifs, surtout après le dépassement du délai maximal de détention provisoire au sens de l’article 85 du Code de procédure pénale, n’a pas été rejetée par la chambre d’accusation ni par la Cour de cassation, malgré les oppositions de la défense, qui a crié au scandale face à l’absence de tout élément juridique ou factuel caractérisant les graves crimes terroristes imputés à leurs clients, ni d’ailleurs de preuves.
Un procès illégal ab initio
L’ouverture du procès devant la 5ème chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a été marquée par deux violations monumentales qui rendent le procès illégal et susceptible d’annulation au sens du Code de procédure pénale ab initio.
La première est l’illégalité de la composition de la 5e chambre criminelle, dont le président a été muté et remplacé par une simple note de service émanant de la ministre de la Justice, ce qui va à l’encontre des dispositions de la Constitution de 2022, que Kaïs Saïed lui-même a rédigée, et du décret-loi présidentiel n°11/2022 relatif au Conseil supérieur provisoire de la magistrature, qui accorde la prérogative de mutation ou de désignation des magistrats au Conseil compétent, en l’occurrence le Conseil de la magistrature judiciaire, en accord avec la loi organique anti-terroriste. La ministre de la Justice a préféré ressusciter un texte abrogé plusieurs fois — la loi organique n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l’organisation judiciaire, au Conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature —, abrogée par la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016 dans son article 78. Le décret-loi n°11/2022 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, qui abroge également ladite loi dans son article 30, en tout cas la prérogative de la ministre de la Justice de muter ou de désigner un magistrat puisqu’il la confie au Conseil compétent.
La seconde violation, qui déroge aussi aux garanties constitutionnelles de l’indépendance de la justice, est une décision prise par la présidente du tribunal de première instance de Tunis et le procureur de la République près le tribunal — qui est normalement une partie au procès —, qui ont argué de l’existence d’un danger imminent pour justifier la tenue de l’audience de la 5e chambre criminelle à distance pour les détenus. Cette décision se base sur l’article 141 bis du Code de procédure pénale, un texte problématique, que la présidente du tribunal a violé également.
Tout d’abord, ce texte a été promulgué durant la période exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 par décret-loi gouvernemental au sens de l’article 73 de la Constitution de 2014, qui exige que ces décrets-lois soient soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple une fois ses travaux repris. Or, ce décret-loi n’a jamais été soumis à aucun vote de l’Assemblée, ce qui le rend caduc.
Ensuite, l’article 141 bis confère à la chambre criminelle à laquelle l’affaire est confiée la compétence pour décider de la tenue de l’audience par téléconférence depuis l’espace carcéral pour les détenus. C’est une décision procédurale que la chambre doit prendre après observation des procédures énoncées dans l’article, notamment solliciter l’avis de chaque détenu et de son avocat ainsi que celui du ministère public, et ce, au cas par cas selon le dossier. Ce n’est pas une décision administrative. D’ailleurs, la défense a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision de la présidente du tribunal et du procureur, et a demandé la suspension et le sursis d’exécution en référé au premier président du tribunal administratif, qui n’a pas réagi plus d’un mois après de la demande, témoignant d’un silence complice avec l’exécutif.
Enfin, il ne faut pas oublier aussi que ce genre de format du procès n’est pas respectueux des normes d’un procès équitable. Cela peut être toléré pour le correctionnel, pour des crimes moins graves, à condition qu’il y ait un danger réel. Mais l’appliquer dans des crimes passibles de la peine capitale constitue une atteinte aux droits des inculpés à un procès équitable.
D’une audience à distance à une audience à huis clos
La troisième audience n’était pas comme les précédentes. En effet, les familles des détenus ont été harcelées et interdites d’assister, un seul membre de la famille étant autorisé pour chaque détenu. Les journalistes sont également interdits, à l’exception d’une journaliste dont la ligne éditoriale de son employeur explique ce traitement de faveur. Les observateurs de la société civile, les personnes solidaires et les représentants des délégations diplomatiques n’ont pas non plus pu assister cette fois. Quelques avocats ont même été harcelés et interdits d’entrer dans la salle d’audience, bouclée par les forces de l’ordre.
Les avocats de la défense, qui ont réitéré le refus de leurs clients d’assister à distance, ont dénoncé également l’absence de publicité de l’audience, alors que la chambre saisie n’a pas dûment décidé ni motivé cette décision sécuritaire qui porte atteinte au droit à l’information de tout le peuple tunisien, après la levée de l’interdiction du traitement médiatique de l’affaire.
La visioconférence mais à mauvais escient
La 5e chambre criminelle, bien qu’elle se soit obstinée à ignorer toutes les oppositions et les griefs de la défense contre la décision de la présidente du tribunal de première instance de Tunis et de son procureur — qui ont imposé à la chambre compétente et aux détenus la tenue des trois audiences par visioconférence —, a totalement ignoré la demande adressée par deux inculpés à l’étranger qui ont réclamé qu’ils soient auditionnés par visioconférence, en application de l’article 73 de la loi antiterroriste. Cet article permet au président de la chambre compétente d’auditionner les témoins et les inculpés par visioconférence quand l’intérêt de la justice le nécessite. Mais la 5e chambre n’a pas estimé qu’il y ait nécessité à entendre des inculpés qui n’ont pas été auditionnés par le juge d’instruction ou les officiers commis par lui, et qui pourraient encourir la peine capitale a regard des chefs d’accusation.