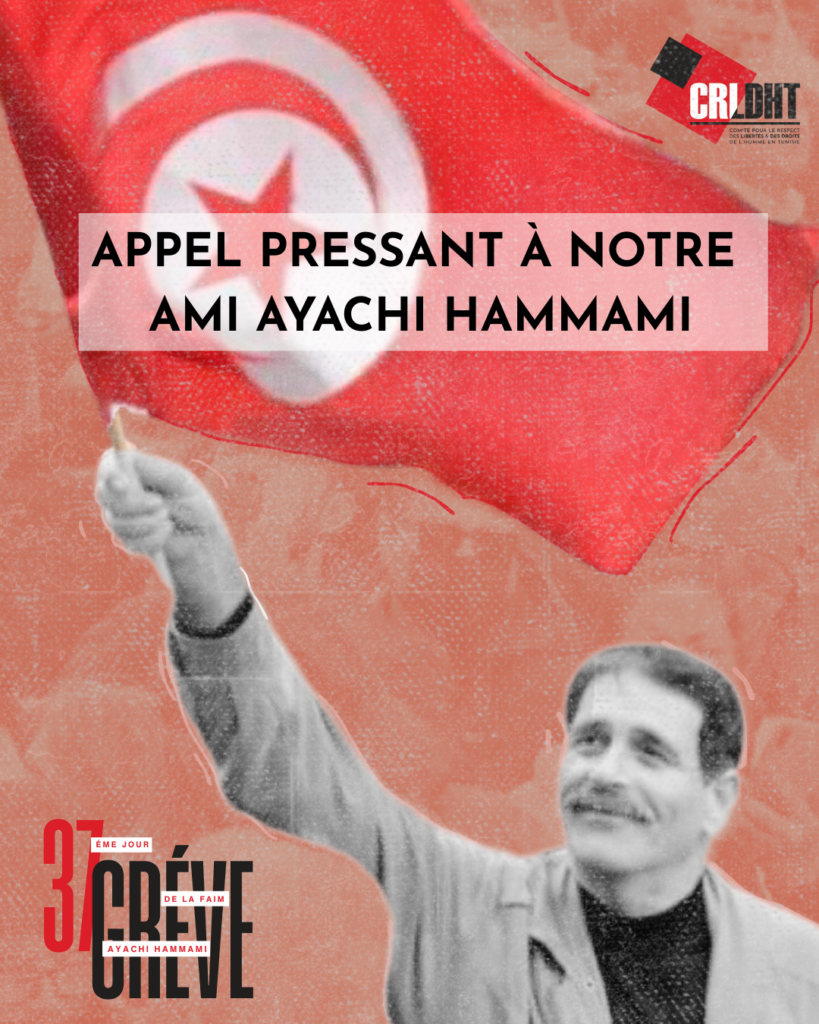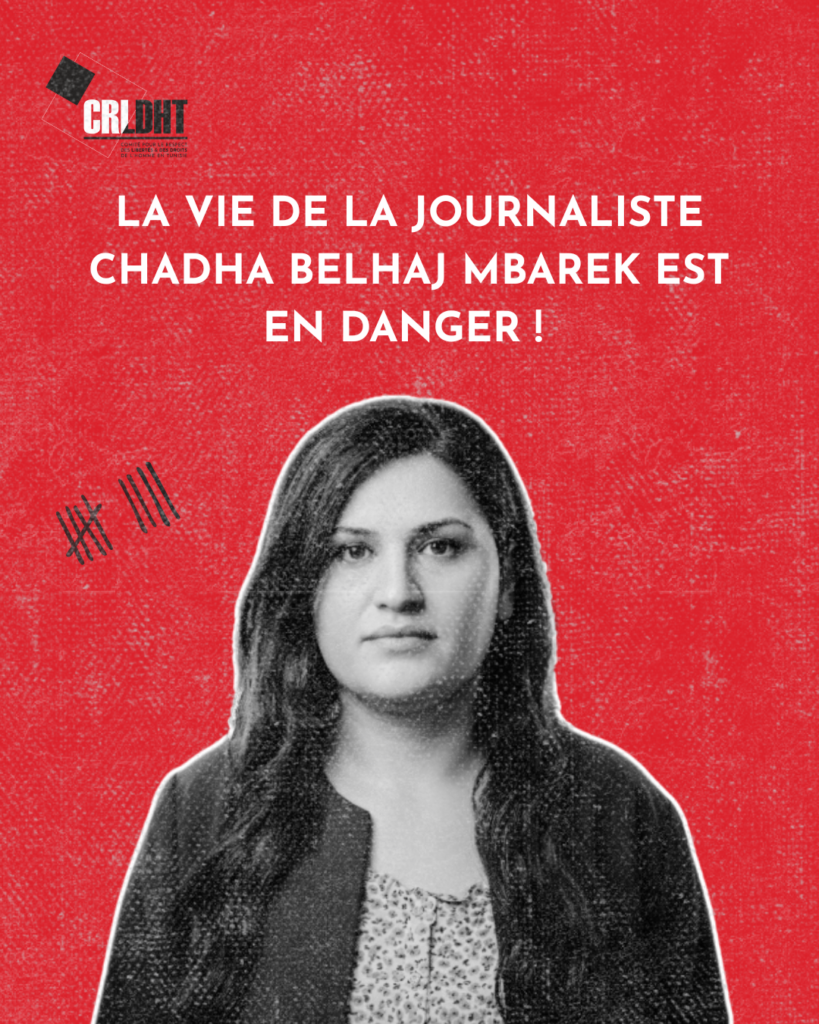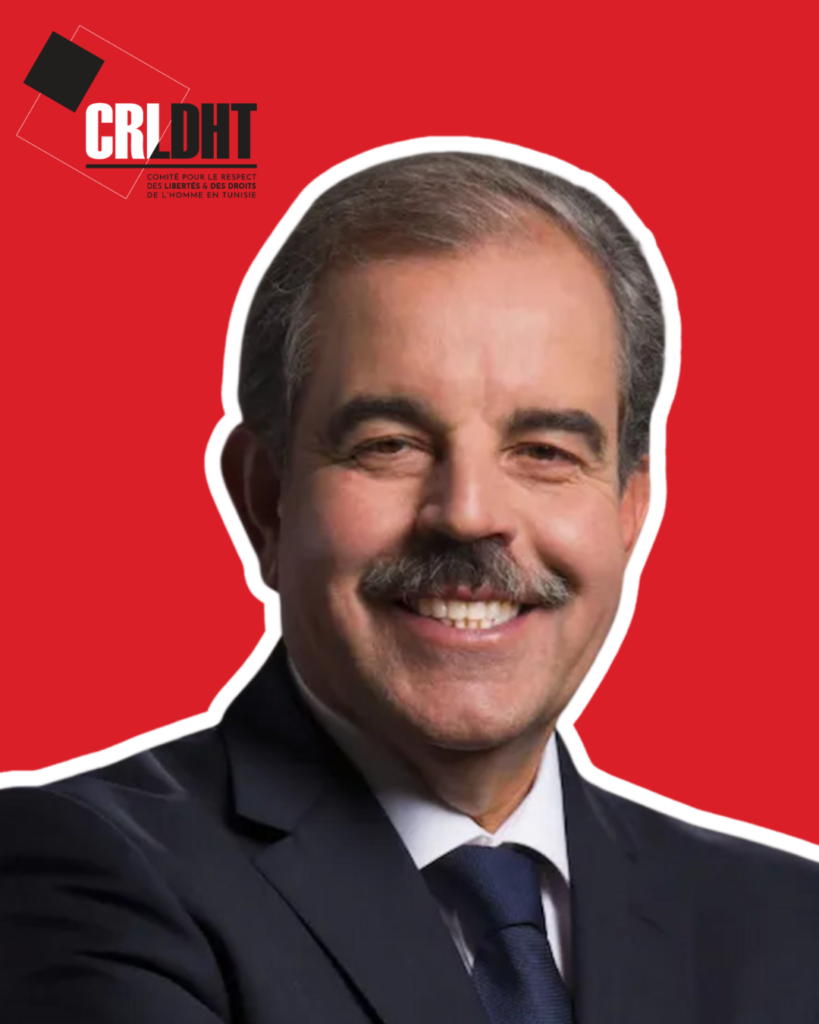Introduction
L’élection présidentielle du 6 octobre 2024 s’est tenue dans un climat de verrouillage institutionnel inédit depuis 2011. Le président sortant, Kaïs Saïed, candidat à sa propre succession, a mis en place un dispositif juridique et administratif sur mesure, taillé à ses ambitions politiques. Le rapport final publié par l’Instance Supérieure Indépendante des Élections (ISIE) le 26 mars 2025 au Journal Officiel (n°35 de la 168e année) offre une lecture institutionnelle d’un processus électoral profondément vicié. En apparence technique, ce document occulte les dérives, les abus et les décisions contraires au droit qui ont marqué toutes les étapes du scrutin, depuis la fixation arbitraire de la date jusqu’à l’exclusion de candidats et le mépris affiché pour les décisions de justice.
Ce texte propose une lecture critique et documentée de ce rapport, en structurant l’analyse autour de quatre axes : le contrôle présidentiel du processus électoral, les atteintes à l’État de droit dans l’organisation du scrutin, l’auto-attribution de pouvoirs juridictionnels par l’ISIE, et enfin le manque de transparence de cette instance censée garantir l’intégrité du processus démocratique.
I. Une élection sous contrôle présidentiel : mise en scène et verrouillage institutionnel
A. Une instance au service du président-candidat
Après avoir remis le rapport des élections présidentielles du 6 octobre 2024 au président de la République – heureux président-candidat –, le président de l’ISIE a publié ce rapport au Journal Officiel n°35 de la 168e année, en date du 26 mars 2025. Ce rapport n’a suscité aucun intérêt dans la presse ou les médias ; il est passé inaperçu, sans analyse ni débat. Pour les partisans du régime, l’essentiel est fait : le “comment” importe peu. D’ailleurs, c’est logique : il n’y a rien à louer ni de quoi être fier. Quant aux dissidents, les violations systémiques et nombreuses sont d’un tel rythme qu’ils ne savent plus où donner de la tête – comme pour confirmer le proverbe tunisien : « Qui vole l’emporte sur qui criaille. »
B. le cadre juridique façonné par le président-candidat
Le président Kaïs Saïed s’est même improvisé un pouvoir constituant en rédigeant, seul, un projet de Constitution qui reprend les démesures du décret 117/2021, et a fait passer ce texte par référendum après avoir défiguré la loi électorale, notamment la loi organique n°23/2021. Entre autres modifications, il devient la partie qui nomme les membres de l’ISIE, son président, et détient même la prérogative de les révoquer, ce qui anéantit la supériorité et l’indépendance de l’instance, ainsi que la loi n°16/2014 relative aux élections.
C. Une date d’élection imposée unilatéralement
Jusqu’au 2 juillet 2024, personne ne savait qu’il y aurait des élections présidentielles en octobre. La date du 6 octobre 2024 a été fixée directement par le président-candidat, sans consultation ni délibération. Le rapport de l’ISIE justifie cette pratique en affirmant que l’agenda électoral doit découler du décret de convocation des électeurs, alors que cette logique inverse le principe fondamental de neutralité de l’agenda. L’ISIE va jusqu’à suggérer une réforme des textes (page 45), bien qu’elle détienne déjà cette compétence. Toutes les précédentes compositions de l’ISIE avaient fixé les dates électorales sur la base des mêmes textes non modifiés.
II. Une ingénierie électoral orientée : exclusion, obstacles et filtres illégitimes
- La dénaturation du cadre légal de l’ISIE
Le rapport ignore complètement l’article 134 in fine de la Constitution de Kaïs Saïed :
« L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour un mandat de six ans non renouvelables. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient tous les deux ans. » Il se contente de mentionner le décret-loi n°22/2022, qui a réduit ce nombre à sept, sans faire aucune référence à la Constitution, ni au non-renouvellement biennal du tiers des membres. Le respect de la hiérarchie des normes s’est évaporé sur ce point : c’est une Constitution à la carte, un menu qu’on applique selon son bon vouloir.
Le rapport fait également état de la croissance du nombre de bureaux de vote et se vante de la proximité de ces bureaux pour les électeurs, alors que la recette est classique depuis l’ère de Bourguiba et de Ben Ali : la multiplication et l’éparpillement des bureaux de vote rendent plus difficile l’observation des élections. Cela est d’autant plus vrai que, dans ces élections, il s’agit de candidats formels, sans réelle machine électorale partisane bien rodée, ni l’effectif nécessaire pour couvrir tous les bureaux de vote.
B. l’ajout illégal de critères subjectifs
Pour ce qui est des conditions de candidature, l’ISIE a prétendu appliquer et respecter la Constitution de 2022 ainsi que la loi électorale, en amendant son arrêté réglementaire n°18/2024. En effet, l’ISIE avoue avoir violé l’article 75 de la Constitution, puisque la loi électorale ne peut avoir que la forme d’une loi organique. Les amendements apportés par l’ISIE à son arrêté réglementaire sont donc contraires à la loi organique n°16/2014, et donc à la Constitution de 2022.
Car même en prétendant appliquer la Constitution, notamment son article 89, l’ISIE a enfreint l’article 75. Et même le recours à l’article 134, qui confère à l’ISIE un pouvoir réglementaire, ne peut justifier — contrairement à ce que prétend l’ISIE (page 74) — la violation des dispositions de l’article 75 de la Constitution et de la norme de hiérarchie des textes.
Le pouvoir réglementaire, même expressément octroyé par la Constitution, n’autorise pas l’ISIE à ignorer les textes de rang supérieur. D’ailleurs, elle se place en nette contradiction : elle reconnaît la supériorité du décret présidentiel sur ses arrêtés réglementaires (page 9), mais se permet d’ignorer la supériorité de la loi organique (page 74), qui est pourtant d’un rang bien supérieur à celui d’un décret présidentiel.
L’ISIE va même, dans son amendement, jusqu’à violer la Constitution elle-même, en ajoutant des conditions qui ne sont pas édictées dans l’article 89 qu’elle prétend appliquer, en se basant sur l’article 134 (page 75), notamment la condition de présenter un bulletin n°3 (certificat du casier judiciaire). Elle motive cet « amendement constitutionnel de facto » d’une part par le fait que l’article 89 impose que le candidat jouisse de ses droits civils et politiques, ce qui, selon elle, lui donne le droit d’exiger la présentation du bulletin n°3 (page 77).
Or, ce raisonnement devrait conduire simplement à vérifier si le candidat est inscrit sur la liste électorale. D’ailleurs, l’ISIE semble consciente de l’absurdité de son propre argument puisqu’elle ajoute qu’il serait illogique qu’une personne ne jouissant pas de ses droits puisse être élue président de la République. Pour elle, il faudrait s’assurer de la bonne conduite du candidat potentiel, de son bon comportement, et garantir qu’il cumule l’aptitude mentale, morale et politique également (page 78).
C’est là un point très grave, car on ne sait pas quelles sont les conditions de ce critère d’aptitude politique que l’ISIE avoue appliquer. D’ailleurs, elle ne se limite pas à ces critères : elle y ajoute l’assurance que le potentiel candidat est apte à gérer ses droits et affaires, à supporter les contraintes de la fonction et à accomplir les tâches qui lui sont attribuées avec maîtrise et mérite.
L’ISIE n’a pas clarifié comment elle a appliqué ces critères subjectifs, incompatibles avec la nature de sa mission. Mais le plus important est qu’elle n’a pas spécifié le rapport entre ces critères et l’imposition inconstitutionnelle de la condition du bulletin n°3.
D’autre part, toujours dans l’argumentation relative à la condition de présentation du bulletin n°3, bien que l’ISIE reconnaisse que cette condition n’est pas énoncée dans l’article 89 de la Constitution, elle prétend que sa consécration était tacite dans l’article 74, premier paragraphe, de la Constitution de 2014, lequel dispose : « La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice ou tout électeur de nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane. » Le maintien de cette condition dans l’article 89 de la Constitution de 2022, comme condition essentielle, appuie selon elle l’ajout de cette exigence, d’autant plus que la loi électorale a édicté plusieurs cas d’interdiction de candidature.
Mais ce développement de l’ISIE n’est en réalité qu’une reformulation de son premier argument, et n’explique en rien comment l’imposition du bulletin n°3 permettrait de réaliser ses prétendues finalités. Elle ne mentionne bien sûr pas non plus la jurisprudence qui a écarté cette condition bien avant 2021.
Le plus frappant — voire le plus déroutant — c’est que dans ses propres suggestions (page 117, dernier paragraphe), l’ISIE avoue expressément que le bulletin n°3 ne reflète pas la situation réelle des personnes ni leur casier judiciaire.
C. Une stratégie d’obstacles à travers le formalisme
Pour le parrainage, notamment populaire, l’ISIE défend son hyper formalisme exagéré en s’appuyant sur l’historique et les précédentes expériences électorales (page 82). Mais les statistiques qu’elle a publiées démontrent plutôt l’inefficacité de ses mesures de prévention et le caractère inutile de ce formalisme, puisque le nombre de plaintes est passé de 50 lors des élections présidentielles de 2019 à 560 pour celles de 2024 — à moins que le but poursuivi par l’ISIE n’ait été, paradoxalement, d’accroître les fraudes, donc les plaintes.
L’ISIE a omis, dans son rapport, de mentionner les cas où elle a refusé de délivrer des formulaires de parrainage à des candidats potentiels, au motif qu’ils n’étaient pas dûment représentés. Ce fut le cas, par exemple, pour Ghazi Chaouachi, malgré le fait que son fils avait présenté une procuration légale, ou encore pour Abir Moussi, qui était représentée par son avocat — que l’ISIE a pourtant considéré comme un potentiel candidat, même dans son rapport (page 106).
Le rapport de l’ISIE n’a pas non plus traité de la question du refus du ministère de l’Intérieur de délivrer les bulletins n°3, opérant ainsi une présélection que l’ISIE a entérinée, au lieu d’intervenir pour exiger que l’administration fournisse ces documents, qui sont un droit pour les candidats. Il est opportun de rappeler que, dans les élections précédant 2021, l’ISIE se contentait des récépissés de dépôt de demande et contactait directement le ministère pour obtenir les bulletins.
III. Une instance juge et partie : contournement du droit et insubordination judiciaire
- L’exécution sélective des jugements administratifs
Pour ce qui est du contentieux de candidature, le rapport zappe le clou de ces élections : la question du respect des décisions de la justice, qui constituait la preuve ultime de la partialité de l’instance, nommée par le président-candidat — et surtout pour le président-candidat. Un bref paragraphe vient réitérer les alibis de l’instance électorale pour ne pas obtempérer aux décisions de justice et pour exclure trois candidats au profit du président-candidat.
L’ISIE reprend son argument, pourtant infondé, qui repose sur une interprétation abusive de l’article 47 de la loi organique n°16/2014, lequel dispose :
« Le greffe du tribunal notifie le jugement aux parties, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la date de son prononcé. »
L’ISIE reconnaît avoir reçu une notification des dispositifs des jugements, mais refuse de les appliquer au motif qu’elle n’a pas reçu les jugements complets, arguant que l’article précise qu’il s’agit de « jugement » et non de « dispositif », et que le texte procédural ne peut être interprété.
Cet alibi va pourtant à l’encontre de son propre arrêté réglementaire, qui explicite les procédures de l’article 47 précité. En effet, l’article 24 de l’arrêté de l’ISIE n°18/2014 relatif aux règles et procédures de la candidature à l’élection présidentielle dispose que l’ISIE doit exécuter les arrêts de l’Assemblée plénière juridictionnelle du Tribunal administratif, à condition que l’arrêt ou son dispositif lui soit notifié. L’article 25 du même arrêté définit l’exécution comme l’intégration d’un candidat dans la liste finale des candidats admis, ou sa radiation de la liste.
Rien n’est plus clair, d’autant plus que la finalité et tout l’intérêt de la procédure se résument dans le dispositif. L’ISIE n’a aucun intérêt légitime à exiger le texte intégral des jugements, qui ne sont susceptibles d’aucun recours, et elle ne dispose d’aucun droit de regard ou d’appréciation : elle ne peut qu’obtempérer — si, bien sûr, elle reste dans son rôle d’instance d’élections, ce que l’ISIE n’a évidemment pas respecté.
Elle n’a même pas mentionné, dans son rapport, le jugement d’interprétation de l’Assemblée juridictionnelle du Tribunal administratif, ni la correspondance adressée par le Premier président du Tribunal afin d’assister à son exécution.
L’ISIE a bien sûr aussi omis de préciser que l’article 47 n’énonce aucune sanction en cas de dépassement du délai de 48 heures, et qu’elle a déclaré la liste finale 24 heures avant le délai fixé dans l’agenda électoral qu’elle avait elle-même arrêté.
Le rapport de l’ISIE se permet même d’évaluer les jugements du Tribunal administratif et de les commenter, avançant qu’ils n’ont pas ordonné leur exécution immédiate et qu’ils ont omis de traiter certains points (page 114). Suite à cela, elle s’appuie sur l’article 134 de la Constitution (qu’elle a pourtant violé dans la composition même de l’ISIE), qui, selon elle, lui confère la responsabilité première de garantir l’intégrité des élections — et sur sa foi (oui, sa foi) qu’il faut interdire toute personne ayant participé à la falsification des parrainages ou ayant corrompu des électeurs, pour justifier l’exclusion des candidats, contrairement à ce qu’a décidé la juridiction compétente.
B. Des exclusions politiques décidées unilatéralement
L’ISIE ne s’est pas contentée d’ignorer les décisions juridictionnelles, mais elle s’est également érigée en tribunal dont les décisions seraient définitives et irrévocables, bien qu’elle ne respecte aucun des principes du procès pénal. En effet, dans son rapport (pages 111 et 112), l’ISIE explique qu’elle a écarté de sa liste finale des candidats ceux contre lesquels des jugements pénaux ont été prononcés pour falsification de parrainage, corruption ou escroquerie des parrains dans le cadre de l’élection présidentielle de 2024, et qui ont été condamnés à des peines assorties de sanctions complémentaires d’interdiction de candidature à vie.
Cet élément du rapport trahit l’absence totale de respect des droits de l’homme et du droit à un procès équitable. Tout d’abord, ces personnes condamnées jouissent toujours de la présomption d’innocence ; il ne s’agit pas de décisions définitives. Ce faisant, l’ISIE les a en réalité condamnées définitivement, en appliquant une sanction que la loi n°16/2014 ne prévoit que pour les élections législatives, et non pour les élections présidentielles — violant ainsi le sacro-saint principe de légalité des sanctions.
Mais le bulldozer de l’ISIE, avec l’impunité garantie, ose même avouer qu’il a sanctionné des candidats contre lesquels des poursuites sont encore en cours.
Toujours dans les causes de refus, l’ISIE mentionne la non-présentation du bulletin n°3 (page 112), sans dire un mot sur l’attitude de l’administration et son exclusion de facto de certains candidats par le refus de leur délivrer ce document. Elle prétend même que le Tribunal administratif n’a pas traité ce point et n’a pas émis de jugement avant-dire-droit à ce propos, alors que le Tribunal administratif a tout simplement annulé cette condition et l’a considérée comme non avenue.
L’ISIE va donc jusqu’à la torsion dans son déni de la réalité. Les textes des jugements sont publiés — peut-être mise-t-elle sur le fait que personne ne lira son rapport.
IV- Une instance sans transparence au service d’un régime autoritaire
- Le scandale des refus d’accréditation
Dans son rapport (page 223), l’ISIE explique avoir refusé l’accréditation d’associations locales ayant pour objet l’observation des élections, sur la base de soupçons de financement étranger « douteux » provenant de pays sans relations diplomatiques avec la Tunisie. Ces accusations n’ont été ni précisées, ni fondées sur des critères clairs. Aucune information sur les pays, les montants, ni les « parties officielles » à l’origine de ces révélations n’est fournie.
Cet article ne prétend pas traiter de toutes les violations et contradictions du rapport, mais on ne peut le conclure sans faire mention d’un autre problème — voire d’un scandale — révélateur de la foi de cette instance désignée par Kaïs Saïed. En abordant la question de l’accréditation, on peut lire dans le rapport (page 223, avant-dernier paragraphe) :
« À ce propos, l’instance a refusé d’accréditer des associations locales qui ont pour objet l’observation des élections, dont il a été établi qu’elles ont perçu des montants énormes, douteux, de l’étranger, de pays qui n’ont aucune relation diplomatique avec la Tunisie. L’instance a été informée par des parties officielles le 9 septembre 2024, à l’occasion du traitement des demandes d’accréditation… »
B. Une instance ni indépendante ni supérieure
L’ISIE n’attend toujours pas la justice : elle condamne ces associations avec des inculpations de crimes graves, lourdement sanctionnés par la loi pénale, en se basant uniquement sur le fait qu’elles auraient reçu des montants de l’étranger — alors que cela est très encadré par la loi tunisienne. Les associations ne peuvent accéder à ce type de financement qu’après intervention de la Banque centrale et de la CTAF (Commission tunisienne des analyses financières).
L’ISIE ne révèle ni les critères de qualification du terme « douteux », ni la base juridique lui permettant de porter une telle appréciation, ni les pays qui auraient envoyé ces fonds supposément suspects, ni même les « parties officielles » qui lui auraient fourni ces informations — ou plutôt ces instructions. Cela prouve, une fois encore, que l’ISIE n’est ni indépendante ni supérieure, et que son attitude n’était en rien conforme à la nature de sa mission, au sens de la Constitution de 2022 ou de la loi électorale, notamment au regard de l’article 75 de ladite Constitution.
Conclusion
Le rapport final de l’ISIE, loin de constituer un document neutre ou purement administratif, témoigne d’un alignement systématique sur les choix du président-candidat. À travers une série de décisions illégales, d’interprétations abusives, de mépris pour les décisions judiciaires et d’opacité sur des sujets majeurs comme l’accréditation des observateurs ou le financement étranger d’associations, l’ISIE a manqué à toutes ses obligations constitutionnelles.
Ce rapport est révélateur d’un processus électoral vidé de sa substance démocratique, où l’instance chargée de garantir l’équité du scrutin est devenue un instrument de légitimation d’un pouvoir sans contre-pouvoirs. Il appartient désormais à la société civile, aux juristes, aux observateurs indépendants et aux partenaires internationaux de dénoncer cette dérive et d’exiger une refondation profonde du cadre électoral tunisien sur la base du droit, de l’indépendance et du respect des libertés fondamentales.