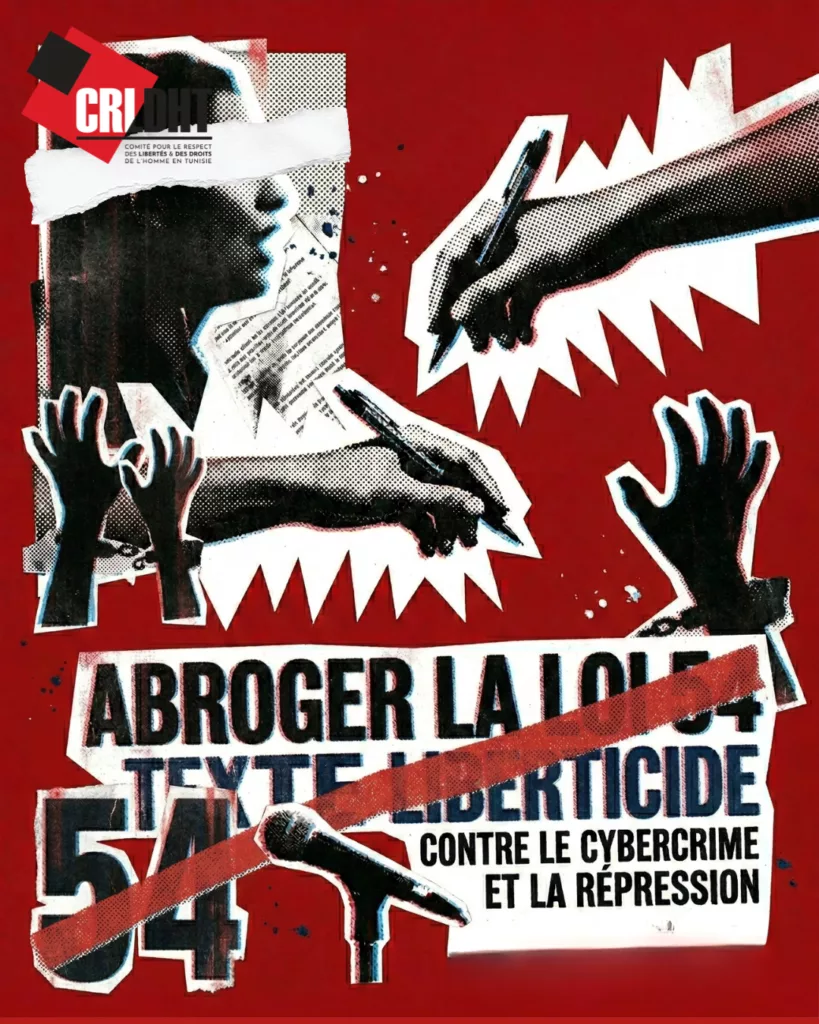Les numéros du Journal officiel des mois de février et de mars ne contiennent pratiquement aucune matière législative ; il s’agit plutôt d’arrêtés ministériels publiés pour annoncer l’ouverture de postes ou de concours, le plus souvent internes à l’administration, ainsi que des nominations. Bref, ce qui relève de la gestion administrative courante de l’État.
Au vu de la qualité et de l’impact des nouveaux textes — qu’il s’agisse de décrets-lois, de décrets présidentiels, ou de lois organiques ou ordinaires émanant de l’Assemblée des représentants du peuple — on pourrait dire, sans exagération d’ordre subjectif le pas de nouvelle, bonne nouvelle.
Révocations présidentielles et verticalité du pouvoir
Toutefois, certains décrets présidentiels parus au Journal officiel de la République tunisienne ont attiré notre attention quant à la conception de l’institution ministérielle dans ce nouveau régime, celui de Kaïs Saïed post-coup d’État du 25 juillet 2021.
Il s’agit du décret présidentiel n°08/2025 du 5 février 2025 relatif à la révocation de la ministre des Finances, ainsi que du décret présidentiel n°164/2025 du 20 mars 2025 relatif à la révocation du chef du gouvernement
Aux origines de la fonction ministérielle en Tunisie
L’institution de ministre, ou celle de Premier ministre, remonte à bien avant l’instauration de la République, voire avant la formation de l’État tunisien lui-même. Ainsi, le ministre — ou « wezir » — est connu depuis au moins la conquête arabo-musulmane, même si l’on peut reconnaître des institutions similaires dans les régimes carthaginois et romains, et même dans les royaumes amazighs.
Les diwenes, instaurés depuis la dynastie des Omeyyades, sont les ancêtres des ministères. Pendant le règne des Aghlabides en Tunisie, l’organisation de l’administration connaîtra un essor important durant une période prospère. Tout au long de l’histoire tunisienne, les régimes monarchiques qui se sont succédé ont connu cette fonction de ministre, qui désigne globalement une personne issue de la cour, nommée par le roi ou l’émir pour le seconder dans un domaine déterminé, ou avec des prérogatives plus étendues dans le cas du « grand vizir ».
C’est une haute fonction estimée, comme le traduit le folklore populaire — notamment à travers les contes sur Jaafar al-Barmaki, le ministre de Haroun al-Rachid, qui devait être à la fois rusé et loyal. La notoriété et la marge de manœuvre du ministre dépendaient de plusieurs facteurs : son appartenance et ses alliances tribales, religieuses ou courtisanes ; la confiance que lui portait le calife ou l’émir ; et la force ou la faiblesse de ce dernier en tant que détenteur du pouvoir central.
La fonction du vizir : entre loyauté et décapitation
L’État, dans son sens contemporain en Tunisie, instaurée avec le royaume husseinite, a connu cette haute fonction attribuée aux affranchis de l’armée des janissaires. Le ministre y est alors le conseiller du bey — d’où l’expression populaire : « Dabber ya wazir wela rassek ytir » (littéralement : « Propose un bon conseil, ô ministre, ou ta tête sera coupée »), ce qui révèle la précarité de cette fonction, suspendue au tempérament du souverain, détenteur exclusif des pouvoirs de l’État et perçu comme le khalif d’Allah.
On ne manque pas d’exemples de ministres ayant connu une fin tragique, y compris ceux dont l’œuvre a été louée, comme Youssef Saheb Ettabaa ou le réformateur Khaireddine Pacha. D’autres ministres avaient une réputation sulfureuse et étaient connus pour leur corruption, tels que Chedly Khaznadar, Ben Ayed ou Mustapha Ben Ismaïl.
C’est le souverain qui a le dernier mot quant à leur désignation ou à la fin de leur carrière, décision influencée bien sûr par ceux en qui il avait confiance, dans un processus de prise de décision aussi opaque que compliqué et instable.
La République et ses secrétaires d’État : continuité ou mutation ?
Avec la proclamation de la République en 1957 et l’adoption de la Constitution de 1959, on maintient la fonction ministérielle, mais sous l’appellation de secrétaire d’État. Ce changement de terminologie n’atténue en rien les prérogatives des ministres ou de ces secrétaires d’État qui, selon le portefeuille qui leur était confié, ont marqué leur domaine respectif.
Ainsi, on se souvient bien de Behi Ladgham et Hédi Nouira en tant que chefs de gouvernement, et de nombreux ministres comme Mohamed Masmoudi, Ahmed Ben Salah, Mohamed Mzali, Tahar Belkhodja, Mohamed Sayah, Habib Chatti, et tant d’autres qui ont laissé leur empreinte dans la vie politique tunisienne à travers leurs champs de compétence. Souvent, ils incarnaient une orientation politique à part entière ; et lorsque Bourguiba décidait de changer de cap, ils étaient révoqués.
A l’ère de Ben Ali, la marge de décision des ministres se rétrécit considérablement : tout ce qui est stratégique ou politique est, de facto, décidé à Carthage. Le ministre, tout comme le chef du gouvernement, ne fait qu’appliquer ces décisions. Comme c’était déjà le cas sous la monarchie, la pérennité de la fonction dépend exclusivement du président de la République, et le ministre devient un fusible, sacrifié à la moindre crise ou au moindre échec.
La constitution de 2022 : retour à l’exécutif présidentiel absolu
La Constitution de 2014 a été révolutionnaire dans la mesure où elle a consacré le chef du gouvernement comme le véritable chef de l’exécutif, faisant du pouvoir exécutif une institution bicéphale. De nouvelles règles inédites ont été introduites concernant la désignation du gouvernement, son contrôle et même sa révocation par une motion de censure.
Le coup d’État du 25 juillet 2021 est venu avorter l’expérience de transition démocratique, pour réinstaurer la présidence de la République comme pièce maîtresse de toute l’architecture du pouvoir. Le chef du gouvernement, tout comme les ministres, est désormais désigné par le président de la République (article 101 de la Constitution de 2022) et révocable par sa seule décision, sans même avoir à la motiver (article 102 de la Constitution de 2022).
Leur statut et leurs prérogatives les réduisent à de simples exécutants des stratégies, politiques et instructions du président, comme l’énonce clairement l’article 111 de la Constitution de 2022, qui fait écho au sinistre décret présidentiel 117/2021. D’ailleurs, l’article 112 confirme cette nouvelle – ou plutôt ancienne – soumission du gouvernement, en précisant qu’il n’est responsable que devant le président de la République.
L’illusion du contrôle parlementaire
Quant à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), l’article 67 ne lui confère qu’une fonction législative. L’article 115 laisse toutefois la possibilité pour l’ARP et le Conseil national des régions et des districts de voter une motion de censure :
« La motion de censure n’est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple et le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts. Le vote ne peut se tenir que quarante-huit heures après son dépôt. »
Mais les conditions posées ne sont pas seulement formelles : la motion ne peut être déposée que « s’ils constatent que les actions qu’il entreprend ne sont pas conformes à la politique générale de l’État et aux choix fondamentaux prévus par la Constitution ». Autrement dit, si elles ne sont pas conformes aux choix du président de la République, puisque c’est lui qui fixe la politique générale et les choix fondamentaux, conformément à la Constitution de 2022.
Le délai de 48 heures est, bien sûr, prévu pour laisser au président de la République une marge de manœuvre afin d’exercer des pressions, dans le cas théorique où le tiers des deux assemblées déciderait de déposer une motion de censure sans son accord ou sa permission.
La motion de censure doit être votée par les deux tiers de l’Assemblée et du Conseil, mais une dernière condition reste à remplir — et ce n’est pas la moindre : l’acceptation par le président de la République de la démission du gouvernement, comme le précise l’article 115.
Avec cette dernière condition, on revient in fine à la case départ : c’est le président qui décide. Les articles 114, 115, et même 116, ne constituent qu’un décor de façade, un trompe-l’œil institutionnel destiné à faire croire à l’existence d’un contre-pouvoir ou d’un mécanisme de contrôle formel.
La souveraineté confisquée
Il va sans dire que, même en cas de vote d’une motion de censure par les deux assemblées — que le président domine —, il peut refuser la démission du gouvernement, lequel peut aussi ne pas la présenter, sans encourir aucune sanction ni répondre d’aucune responsabilité.
Ce qui est sûr c’est que le peuple n’est plus souverain et n’a aucune incidence sur la nomination ou la révocation du gouvernement. Les révocations successives, non motivées, constituent une nouvelle manifestation de la violation du droit de chaque Tunisien de participer aux affaires publiques de son pays, pourtant garanti tant constitutionnellement que conventionnellement.
Le citoyen tunisien — ou plutôt, désormais, le sujet du président de la République — n’a même plus droit à être informé . Pendant ce temps, Kaïs Saïed semble bien parti pour consolider son record en tant que président ayant nommé le plus grand nombre de chefs de gouvernement dans l’histoire contemporaine de la République tunisienne, preuve que les mêmes conditions produisent inévitablement les mêmes effets.
Une gouvernance sans cap ni vision, une instabilité orchestrée
Faute de politiques et de stratégies présidentielles, aucun chef de gouvernement, et aucun gouvernement, ne peut remplir sa mission d’« assistance » au sens de l’article 87 de la Constitution de 2022. Nul ne peut en effet assister un président dépourvu de vision stratégique et d’initiatives de politiques publiques bien qu’il détienne le monopole de la définition des choix fondamentaux et des modes de leur mise en œuvre.
En attendant, le bal nocturne des révocations et des désignations ne semble pas près de prendre fin. D’ailleurs, Kaïs Saïed a même décidé unilatéralement de modifier le texte du serment ministériel, sans même promulguer un édit à cette fin.
Le paradoxe, c’est que Kaïs Saïed a fondé son coup d’État sur la volonté populaire de rompre avec l’instabilité gouvernementale, ainsi que sur la promesse de restaurer le prestige de l’État — prestige qu’il a lui-même bafoué en scénarisant les révocations de manière humiliante et irrespectueuse.
L’humiliation institutionnalisée comme méthode de gouvernement
Cette mise en scène dépasse la personne des responsables limogés : elle vise à humilier l’ensemble des responsables et collaborateurs du régime, qui se retrouvent tour à tour sacrifiés sur l’autel des échecs présidentiels, révoqués, interdits de voyager, en attendant d’éventuelles poursuites pénales pour complot contre la sûreté de l’État — si ce n’est pour corruption, les deux arguments passe-partout de Kaïs Saïed.