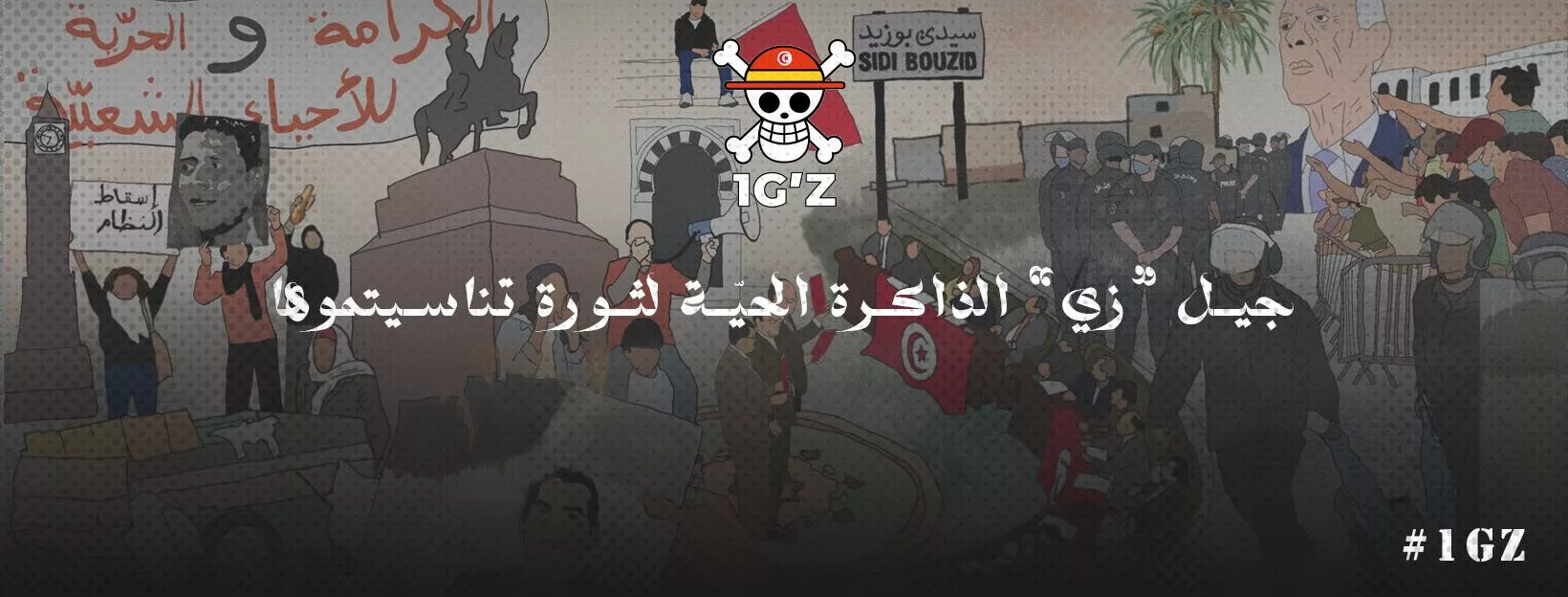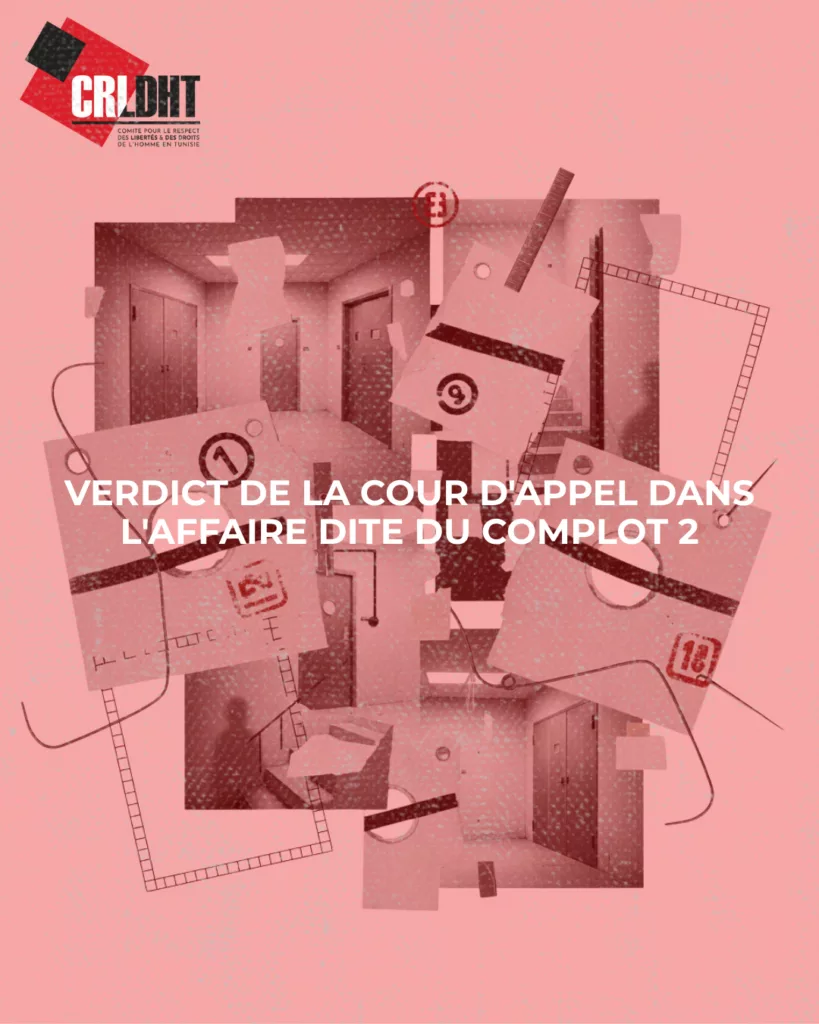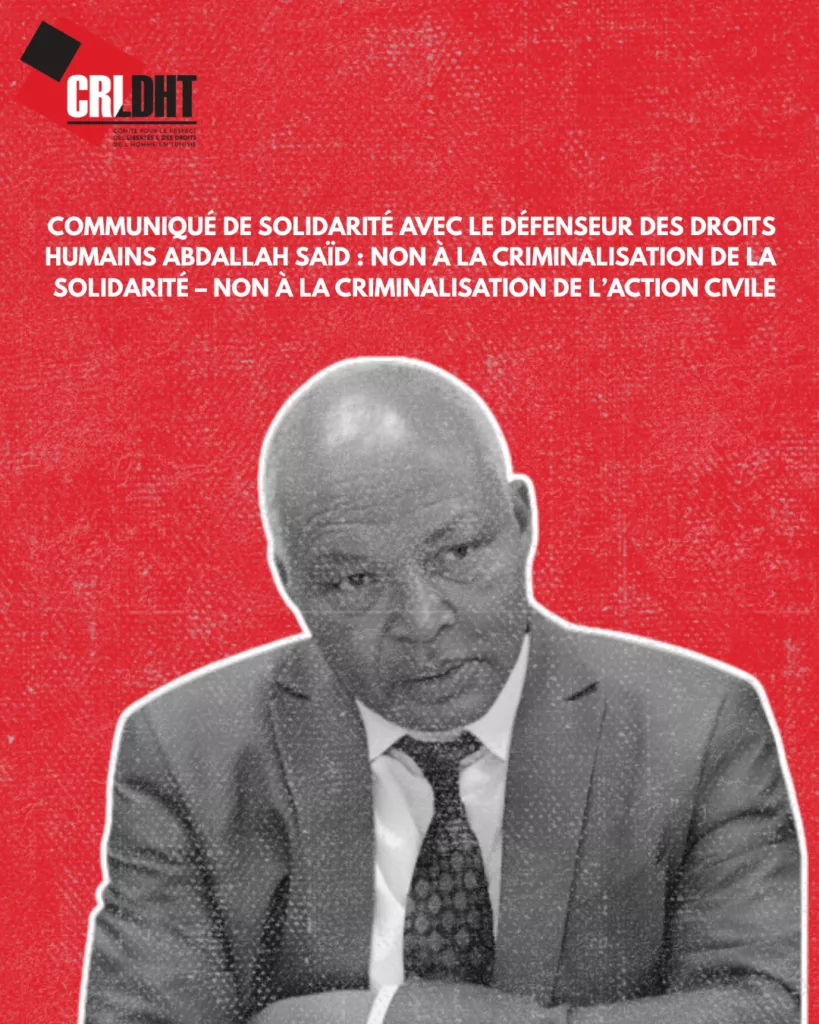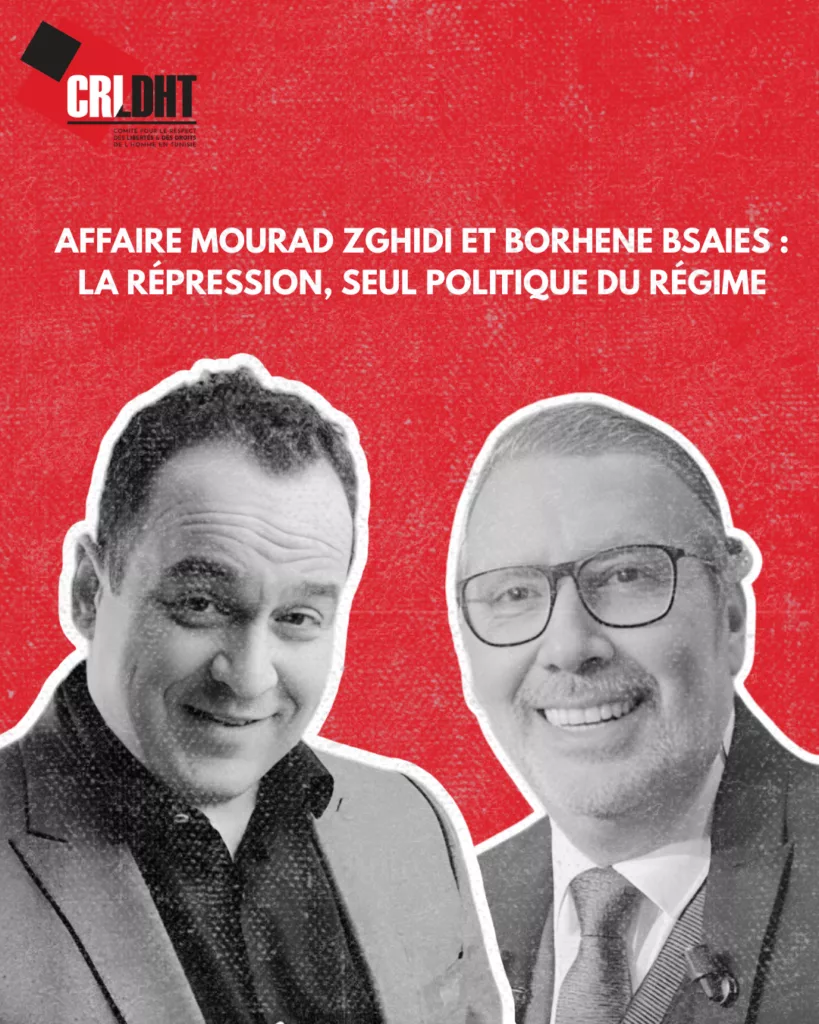Une vague traverse la planète, portée par des visages juvéniles, des smartphones levés, des cris mêlés à des éclats de rire.
Au Maroc, à Madagascar, au Pérou ou au Népal, la même jeunesse s’impose dans la rue : celle de la Génération Z, née à l’ère du numérique, du désenchantement politique et de l’urgence climatique.
En Tunisie, c’est à Gabès que cette colère s’est matérialisée. Une ville suffocante, malade de ses usines chimiques, devenue le symbole d’un pays qui étouffe entre promesses non tenues et précarité chronique.
Quand des milliers de jeunes descendent pour réclamer le droit de respirer, ce n’est pas seulement une revendication environnementale : c’est un cri existentiel, un appel à la dignité.
Face à cette génération connectée, le pouvoir répond par la suspicion, parfois par le mépris. Mais en tentant de la ridiculiser, il lui a offert la visibilité qu’elle attendait : celle d’un mouvement qui n’a pas besoin d’être organisé pour exister.
Un mouvement sans drapeau, mais avec des symboles
La génération Z n’a ni parti, ni hiérarchie, ni chef.
Son langage est celui de l’image, du rythme et de la viralité. Elle puise dans les codes culturels globaux — mangas, musiques urbaines, mèmes, vidéos — les signes de son identité collective.
Ce mélange de légèreté et de gravité, de dérision et de lucidité, donne à cette génération une puissance inédite : celle d’un refus joyeux.
Son drapeau n’est pas politique, c’est un dessin animé.
Son mot d’ordre n’est pas un programme, c’est une émotion partagée.
Et pourtant, derrière cette apparente désinvolture, se dessine une conscience politique aiguë : celle d’un monde qui ne répond plus à leurs besoins fondamentaux — emploi, santé, justice, environnement, liberté.
Une génération sans illusions mais pas sans convictions
Ces jeunes ont grandi dans le désordre du monde et l’instabilité du pays.
Ils ont vu les promesses de 2011 s’évaporer, les institutions se déliter, les libertés se restreindre. Ils ne croient plus aux sauveurs, mais à la solidarité horizontale.
Leur engagement n’est pas idéologique, il est vital.
Ils ne réclament pas le pouvoir, ils veulent qu’il soit responsable.
Ils sont à la fois connectés et isolés, lucides et fatigués. Mais surtout, ils refusent la résignation de leurs aînés.
Leur mode d’action est à l’image de leur époque : fragmenté, éphémère, mais contagieux. Un tweet, un clip, une marche, une image virale peuvent suffire à déclencher une vague d’indignation.
Cette jeunesse « liquide », pour reprendre la métaphore du sociologue Zygmunt Bauman, ne se laisse plus contenir dans les formes anciennes du politique.
Elle agit par effraction : là où on ne l’attend pas, avec des moyens que les anciens ne comprennent plus.
Une société à contretemps
Le décalage entre cette jeunesse et le pouvoir est abyssal.
Le discours officiel, saturé de moraline et de références archaïques, ne parle plus à des jeunes qui ont grandi dans le langage des émotions et de la liberté.
Tandis que les dirigeants invoquent la loyauté, la nation et l’obéissance, eux parlent de respiration, de créativité et d’égalité.
Ce fossé n’est pas seulement culturel, il est institutionnel : la Tunisie s’adresse encore à sa jeunesse comme à une menace, jamais comme à une ressource.
Les dispositifs publics restent marqués par la méfiance et la verticalité.
Résultat : l’État perd la bataille du sens. Et la génération Z, faute d’espace d’expression, investit la rue et le web comme derniers territoires de liberté.
Ce que cette jeunesse nous dit
Derrière les slogans et les hashtags, la génération Z adresse trois messages clairs :
- Le droit à la vie : respirer un air sain, accéder à des soins, vivre sans peur. Ce sont des revendications fondamentales, non négociables.
- La justice sociale et territoriale : l’exaspération contre un système qui concentre les richesses et abandonne l’intérieur du pays.
- La liberté d’expression et la reconnaissance : être entendus, non surveillés ; participer, non être suspectés.
Ce triple cri — santé, justice, liberté — révèle la faillite d’un modèle politique et économique incapable d’intégrer la jeunesse comme acteur à part entière.
Ecouter, coconstruire, relier
La génération Z tunisienne n’attend pas d’être encadrée. Elle veut être prise au sérieux.
Pour répondre à cette mutation profonde, plusieurs pistes concrètes se dessinent :
1. refonder les espaces de dialogue
Créer des forums citoyens hybrides, associant jeunes, chercheurs, acteurs locaux et décideurs publics. Ces espaces doivent exister à la fois en présentiel et en ligne, pour refléter les modes d’expression de cette génération.
2. soutenir l’engagement social et écologique
Mettre en place un fonds national d’initiatives citoyennes soutenant les micro-projets environnementaux, culturels et numériques portés par les jeunes, en priorité dans les régions marginalisées.
3. réinventer l’éducation civique
Introduire une éducation à la citoyenneté numérique et critique : apprendre à décoder les discours, à utiliser les réseaux comme outils de participation et non de manipulation, à exercer la liberté d’expression de manière responsable.
4. Assouplir les cadres de participation
Adapter les dispositifs de consultation publique à la culture numérique : sondages participatifs, plateformes délibératives, votes en ligne, hackathons citoyens. La jeunesse doit être associée aux politiques locales, pas seulement symboliquement.
5. Décriminaliser la parole
Abroger ou réviser les textes répressifs, notamment les lois utilisées contre les internautes. Le décret-loi 54 sur les communications numériques a instauré une peur qui tue le débat public. Or, une démocratie sans voix jeune est une démocratie sans avenir.
6. redonner confiance
Les institutions doivent apprendre à parler un autre langage : celui de la transparence, du respect, de la preuve.
La jeunesse n’attend pas des discours mais des gestes — l’application d’un jugement, la libération d’un innocent, la protection d’un lanceur d’alerte, la fermeture d’une usine toxique.
Le pari du futur
La Tunisie de demain ne se construira ni contre ni sans sa jeunesse.
Cette génération ne rêve pas d’un retour en arrière, mais d’un pays où la liberté n’est pas un souvenir, et la justice, un privilège.
Elle ne cherche pas à imiter l’Occident ni à ressusciter un passé idéalisé : elle veut inventer son propre modèle.
Les aînés ont leurs cicatrices, la génération Z a sa foi.
Ce n’est pas une foi naïve : c’est celle de ceux qui ont tout vu, tout compris, et qui refusent malgré tout de renoncer.
Ils ne demandent plus la permission d’exister — ils existent déjà.
Et dans leurs rires, leurs colères et leurs écrans, se lit peut-être le visage d’un pays qui, lui aussi, cherche à renaître.